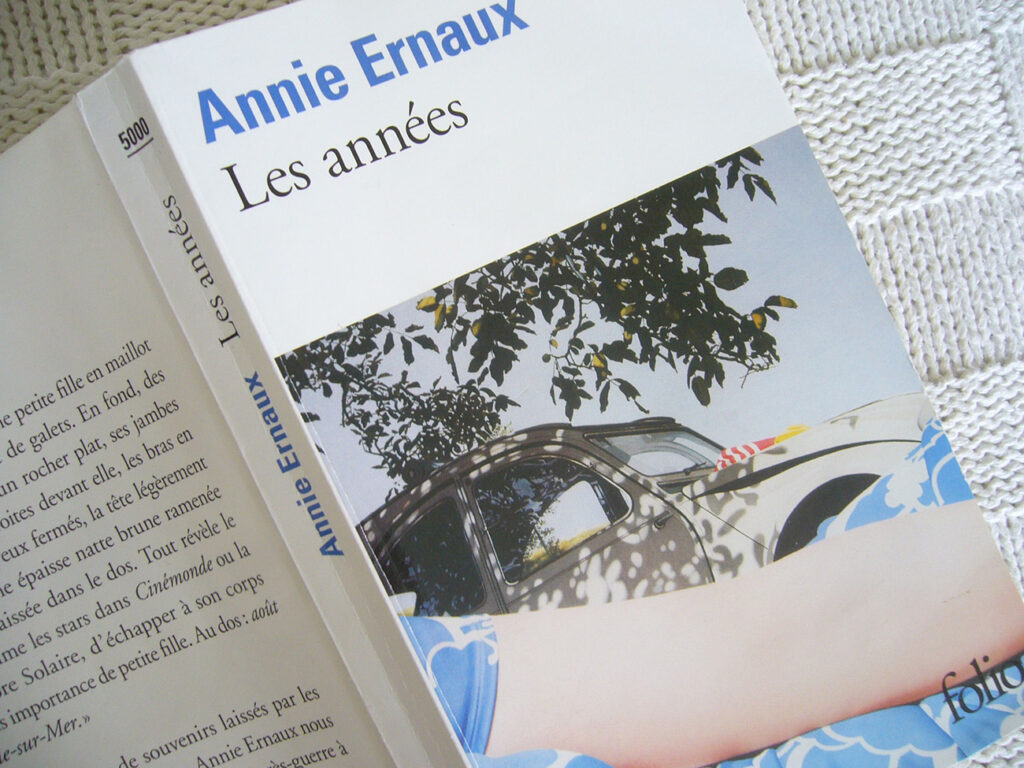Dans cet article au titre quelque peu mystérieux, je voudrais recenser et interroger toutes les parts de son identité sur lesquelles Annie Ernaux, dans Les Années, observe un silence plus ou moins complet, ou en tout cas qu’elle traite avec une certaine discrétion. Car la première chose qui vient à l’esprit quand on réfléchit à la construction identitaire de la protagoniste des Années, c’est le phénomène d’expansion du « je » dans un « elles », un « on », un « nous », c’est son ouverture à des identités multiples. Mais cette expansion et cette ouverture ont aussi leur envers, qui est l’atténuation voire l’amputation de certaines dimensions du « je ». Il va donc s’agir ici d’envisager ces appauvrissements qui sont la condition de possibilité des enrichissements sur d’autres plans – et d’analyser, brièvement, leurs raisons d’être et les effets littéraires qu’ils produisent.
J’insisterai avec Fabrice Thumerel sur l’idée qu’Ernaux, dans Les Années, s’inclut « dans un “on” non pas général mais communautaire1 », et, poursuivrai-je, quadruplement communautaire. Je rappellerai d’abord les quatre dimensions identitaires au nom desquelles se produit cet adossement du « elle » singulier au « on » pluriel ; puis j’envisagerai trois autres identités collectives possibles et pourtant partiellement éludées. Enfin, je commenterai la manière dont sont traitées dans Les Années les parties les plus idiosyncrasiques de l’identité du sujet.
Ce travail a surtout une ambition de synthèse. Il cherche moins à ouvrir des percées théoriques vraiment nouvelles sur l’œuvre d’Annie Ernaux, qu’à rassembler et clarifier des points qui se trouvent déjà, de manière plus ou moins éparse, dans la critique ernalienne. Je dois signaler, à l’orée de mon propos, que j’ai rencontré récemment un article d’Anne Strasser intitulé « L’énonciation dans Les Années », paru en 2012, qui se pose certaines questions semblables aux miennes et qui arrive, ce qui est plutôt rassurant, à des conclusions proches2. Je ne signalerai pas systématiquement les points de contact et les points de séparation entre ses analyses et les miennes, mais je note que cette étude existe, et je me permets d’y renvoyer.
Quatre identités d’Annie Ernaux
Si l’on essaie d’abord d’énumérer les différentes identités au croisement desquelles Ernaux se situe dans Les Années, c’est-à-dire celles auxquelles renvoient le plus souvent le « on », le « nous » ou le « elles » dans lesquels elle s’inclut, il me semble que l’on peut en relever quatre.
Il y a d’abord – c’est le plus évident – une identité de genre, une identité féminine. C’est souvent le groupe des femmes qui est désigné par le pronom « on » ; c’est évidemment lui, aussi, qui est désigné par le pronom « elles » au pluriel. Le fait de parler de soi-même, au singulier, à la troisième personne, permet du reste de remplacer un pronom non marqué en genre (« je ») par un pronom marqué en genre (« elle »).
Il y a ensuite une identité générationnelle. Anne Strasser parle d’un « nous » qui « au fil du récit évoquera les adolescents, les jeunes3 », mais plus généralement ce « nous » ou ce « on » évoquent à chaque époque les gens qui appartiennent à une certaine classe d’âge, qui vivent donc des expériences communes, mais qui ont aussi une manière commune de se rapporter aux choses du passé – la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation, la guerre d’Algérie, etc. : autant de souvenirs activés dans les repas de famille et dont l’évocation, tout en donnant de l’épaisseur au temps historique, permet de cimenter les identités générationnelles. Le « on » d’Annie Ernaux n’est pas tant celui des enfants, des jeunes, des adultes, etc., que celui des gens qui sont nés en 1940 et qui ont été adolescents pendant la guerre d’Algérie, quarantenaires au moment de l’élection de Mitterrand, cinquantenaires au moment de l’irruption de l’informatique dans les foyers.
Il y a également une identité de classe (ou plutôt plusieurs, successivement, j’y reviendrai) : évoquant sa jeunesse, Ernaux parle au nom des classes populaires ; évoquant son âge adulte, c’est-à-dire à partir du début ou du milieu des années soixante, elle parle au nom des classes moyennes intellectuelles. C’est ce groupe un peu vague des classes moyennes intellectuelles que désigne le « on » quand le texte en fait le sujet de certaines pratiques culturelles (le tourisme en Espagne, la visite de musées…) ou de certaines pratiques de consommation.
Il y a enfin une identité politique : le « on » ou le « nous » d’Annie Ernaux désignent le groupe des gens de gauche. Le parcours d’Ernaux est celui d’une sympathisante de gauche, qui n’est pas particulièrement militante (sauf au moment du combat pour la libéralisation de l’avortement), et dont les prises de position successives sont tout à fait attendues : soutien à Mai 68, progressisme culturel dans les années 1970, enthousiasme (suivi de déception) lors de l’élection de Mitterrand, colère et tristesse lors de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle, etc.
Avec ces quatre dimensions identitaires, on a à peu près cartographié l’usage de ces pronoms morphologiquement ou sémantiquement pluriels que sont « on », « nous » voire « elles » au pluriel. Ces quatre « communaut[és] » que sont les femmes, les personnes nées vers 1940, les personnes de gauche et les membres des classes moyennes intellectuelles sont celles vers lesquelles le « elle » individuel d’Ernaux s’ouvre et s’élargit, donnant ainsi à son texte, comme elle l’écrit, sa dimension d’« autobiographie impersonnelle4 ». Ces quatre identités sont aussi celles, notons-le, qui favorisent une certaine connivence avec le lecteur ou la lectrice : celui-ci, celle-ci, sera d’autant plus enclin ou encline à s’approprier ce « on », ce « nous », ce « elles », qu’il ou elle partage un ou plusieurs de ces traits identitaires avec la protagoniste des Années.
Trois identités effacées ou estompées
Inversement, il faut s’interroger sur les aspects de son identité qu’Annie Ernaux estompe voire dissimule – j’en vois trois –, et réfléchir aux effets esthétiques de ces choix.
Le phénomène le plus remarquable à cet égard est l’effacement quasi-total du statut d’écrivaine d’Annie Ernaux. Les seules allusions qui y sont faites concernent, vers la fin du livre, la maturation du projet même des Années, mais cette réduction du thème de l’écriture à ce seul livre donne la fausse impression que celui-ci n’a été précédé d’aucune carrière littéraire. Il s’agit là, pour Ernaux, de prendre le contrepied du modèle traditionnel de l’autobiographie d’écrivain, dont le paradigme au XXe siècle pourrait être Les Mots de Sartre (1964), et qui fait du récit autobiographique l’archéologie d’une vocation professionnelle ou intellectuelle. Mais plus fondamentalement, il s’agit aussi de refuser la mise en scène des identités trop particulières, trop spécifiques, auxquelles il serait difficile d’adosser ce processus de généralisation qui se trouve à l’œuvre dans Les Années – et ce pour deux raisons, une sociologique, une idéologique. La raison sociologique, c’est que l’état d’écrivain est trop peu partagé, trop exclusif voire excluant, pour que le « nous » ou le « on » qui y renverrait puisse concerner le lecteur. La raison idéologique, c’est que le régime moderne de la littérature fait reposer sa valeur sur une exigence d’originalité : parler de soi comme écrivaine, c’est presque inévitablement parler d’une activité qui engage sa distinction, et ses distinctions, y compris au sens très concret du terme (le prix Renaudot, en 1984, pour La Place).
Deuxièmement, il me semble qu’Annie Ernaux estompe assez largement, dans Les Années, son identité professionnelle : cette autobiographie de femme, de femme de gauche, de classe moyenne, née en 1940, n’est pas vraiment une autobiographie de « prof ». Certes, cette identité-là n’est pas aussi effacée que l’identité d’écrivaine, mais il en est somme toute, dans l’ensemble du livre, assez peu question – et c’est souvent au détour d’un paragraphe, ou d’une phrase, que les allusions à ce métier apparaissent. Par exemple, il est question à la page 147 de l’édition Folio du « souci multiforme dont son agenda porte les traces elliptiques – changer draps, commander rôti, conseil de classe, etc. » Dix pages plus haut (p. 137), c’était au détour d’un paragraphe sur un autre sujet (en l’occurrence l’immigration) qu’était évoquée une pratique pédagogique (en l’occurrence le « débat annuel et vertueux en classe »). Il s’agit d’un estompement plutôt que d’un véritable effacement. Les raisons de cet estompement ne peuvent pas être tout à fait les mêmes que celles de l’effacement du statut d’écrivain, car les enseignants du secondaire constituent une corporation nombreuse – et ce sont des fonctionnaires, des agents de l’État, recrutés sur concours, dont l’éthique professionnelle ne repose pas sur la valeur d’originalité. Malgré tout, le « on » renvoie assez rarement à ce groupe professionnel, qui risquait sans doute, lui aussi, d’être trop particularisant et de faire obstacle à la généralisation impersonnelle qui est le projet des Années. Autrement dit, l’identité de classe est une chose, l’identité professionnelle en est une autre, et Annie Ernaux insiste toujours sur la première au détriment de la seconde – ce qui revient à définir la classe par le niveau de vie et les pratiques de consommation, plus que par les pratiques de travail. Du reste, pour des raisons techniquement compréhensibles, c’est la vie privée (et les pratiques de consommation), non la vie professionnelle, qui a l’honneur des films et photographies qui ponctuent l’ouvrage.
Troisièmement, on peut remarquer que l’autobiographie d’Annie Ernaux n’est pas exactement une autobiographie de transfuge de classe. Ce n’est pas, en ce sens, une réécriture de La Place (1983), et ce n’est pas non plus une anticipation de Retour à Reims (de Didier Eribon, paru en 2009) ou de Changer : méthode (d’Édouard Louis, paru en 2021). En général, le texte saisit un certain mode de vie de manière assez présentiste, sans jouir du surplomb que lui donne son caractère rétrospectif pour accuser l’écart avec les modes de vie passés ou les modes de vie futurs. Il semble en particulier que les plongées dans le passé de la mémoire familiale, à l’occasion des repas de famille, servent beaucoup plus à asseoir cette identité générationnelle que j’ai déjà évoquée, qu’à mettre en lumière une trajectoire de classe. Le « on » d’Ernaux commence par désigner les classes populaires ; plus tard il désignera les classes moyennes intellectuelles ; mais la transition n’est guère racontée. Là encore, il faut sans doute voir dans ce choix un refus volontaire de tout ce qu’il y a de trop singulier dans l’expérience d’Annie Ernaux. Mais on peut aussi y voir une réticence à la mise en forme de l’expérience dans un récit téléologique, tel que le commande l’autobiographie traditionnelle5.
Du moins cela est-il vrai des passages mobilisant l’usage des pronoms « on », « elles », « nous ». Les arrêts sur image en quoi consistent les descriptions de photographies et de films sont parfois l’occasion de la réinscription du sujet individuel dans une trajectoire sociale ; mais c’est quelque chose qui concerne essentiellement le « elle » singulier et qu’Ernaux ne fait pas résonner avec l’expérience collective. Et par ailleurs, comme cette expérience de transfuge est évoquée à l’occasion des descriptions de photographie, elle est saisie, paradoxalement, de manière statique. Considérons ainsi cet extrait de la page 90 : « Elle est la fille du milieu, aux cheveux coiffés en bandeau à l’imitation de George Sand… » ; la suite du paragraphe évoque « les deux filles qui l’entourent » et qui « appartiennent à la bourgeoisie », alors qu’Annie Ernaux « ne se sent pas des leurs » ; puis il est précisé qu’« elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance ». Nelly Wolf, dans une récente discussion avec l’autrice lors d’un colloque à la BnF, proposait à juste titre de donner un caractère symbolique à cette « fille du milieu », prise entre deux classes6. Mais ce moment de suture entre l’enfance ouvrière et l’entrée dans la petite bourgeoisie intellectuelle est pensé et raconté de manière à la fois statique et individuelle, non de manière dynamique et collective.
Trois effacements ou estompements, donc : Annie Ernaux observe un silence quasi-complet sur son statut d’écrivaine ; elle observe un silence relatif sur son activité professionnelle ; elle ne se montre pas – sinon de manière statique et singulière – comme transfuge de classe.
Un livre sans événement
De manière peut-être plus nette encore, Les Années font très peu de place à ce qui peut apparaître comme les éléments les plus idiosyncrasiques de la vie de l’autrice. On est frappé par la faible place qu’occupent dans l’ouvrage les histoires amoureuses, les relations amicales : tout au plus y est-il fait de très lapidaires allusions. Annie Ernaux renonce en quelque sorte à exposer tous ces éléments de sa vie qui ne peuvent adéquatement se dire qu’au singulier, parce que le sens qu’ils acquièrent dans la conscience de celui ou celle qui les vit garde obstinément, irréductiblement, quelque chose d’individuel. C’est d’ailleurs pourquoi, dans Les Années, la vie de l’autrice n’est traversée que de fantômes : ses parents, son mari, ses compagnons, ses enfants ne sauraient en aucun cas avoir la moindre épaisseur. De même, le texte résiste à ce que l’on pourrait appeler l’événementialité : tous ces événements, tous ces épisodes affectivement forts, que par ailleurs d’autres œuvres d’Ernaux racontent, ne sont évoquées dans Les Années qu’en quelques mots ou par allusion7. Pour reprendre deux exemples mobilisés par Anne Strasser, « quand [Ernaux] évoque la nécessité pour les filles de “ ‘faire passer’ d’une façon […] ou d’une autre” […], le lecteur pense à L’Événement » ; « Passion simple est à l’horizon de la lecture quand elle explique qu’elle se pense “comme une femme qui a vécu il y a trois ans une passion violente avec un Russe” »8. Et rétrospectivement, on peut aussi lire dans Les Années des anticipations d’œuvres à venir : lue en 2022, l’évocation de sa première expérience sexuelle évoque Mémoire de fille, paru en 2016. On peut faire deux lectures, presque opposées et complémentaires, de ces allusions dont le livre Les Années est tissé : d’une part, en s’appuyant sur la mémoire des lecteurs familiers de l’œuvre ernalienne, elles restaurent de manière compensatoire cette événementialité dont le livre même est privé ; d’autre part, elles renforcent par contraste l’effet d’effacement, pour ne pas dire de censure, à l’œuvre dans Les Années.
Cet effacement n’est pas total. Il arrive que certains événements personnels particulièrement saillants et marquants soient évoqués dans Les Années d’une manière qui fasse impression sur l’imagination du lecteur. C’est le cas, me semble-t-il, de l’épisode de la première expérience sexuelle, d’abord évoquée sous couvert d’un « on » à la page 75 (« C’est à cause de cette sensation éperdue qu’on se retrouvait après un slow sur un lit de camp ou sur la plage avec un sexe d’homme […] et du sperme dans la bouche pour avoir refusé d’ouvrir les cuisses, se souvenant in extremis du calendrier Ogino ») puis repris avec un « elle », au détour d’une description de photographie, trois pages plus loin (« Aucun signe sur sa figure de l’envahissement de tout son être par le garçon qui l’a déflorée à moitié cet été, comme l’atteste le slip taché de sang qu’elle conserve secrètement entre des livres dans un placard »). Mais cet épisode n’est ici évoqué que pour être inséré dans une cartographie mentale ; il est un élément d’une situation ; il est privé de tout ce qui pourrait le constituer en événement, et notamment, d’un avant, d’un après, bref, de tout élément de mise en récit. L’expression « on se retrouvait avec » dit bien cela : aucun enchaînement de causes n’est capable d’expliquer ce sexe d’homme dans la bouche. L’épisode se réduit à une série de sensations visuelles et tactiles, d’émotions envahissantes ; bref, quand bien même il ne s’agit évidemment pas d’un fait immortalisé par la photographie, il est décrit – plutôt que raconté – d’une manière qui emprunte encore certains de ses codes à la description photographique, notamment le statisme et la fulgurance.
Il y a donc en somme deux procédés complémentaires qui annulent l’événementialité potentielle des Années, d’une part l’élision, d’autre part le figement photographique. Cette double modalité correspond à cette alternance qui organise l’ensemble du livre entre, d’une part, des descriptions de photographies (ou, plus rarement, de films, mais ceux-ci figurent des scènes et ne racontent pas d’histoires), et, d’autre part, de longues pages où le temps s’englue.
Faute de véritables événements, faute d’épisodes réellement narrativisés qui viendraient donner du relief à cette vie, il est difficile de ne pas se dire, en lisant Les Années, qu’Annie Ernaux a eu une existence ennuyeuse. C’est une impression de lecture à laquelle il faut faire droit, quand bien même on sait qu’elle est fausse – il suffit de lire ses autres livres pour savoir qu’elle est fausse – mais qui répond à un travail conscient d’évidement du texte. Cet ennui est d’ailleurs plusieurs fois thématisé dans l’œuvre, en particulier à propos de séquences historiques particulièrement engourdissantes : on éprouve dans les années 1960 la « durée indéfinie et morne9 » des étés qui se ressemblent ; on sort en 1980 d’une « léthargie10 » qui caractérise la fin des années soixante-dix. Ernaux cite, pour la valider, la phrase de Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde à la veille de Mai 68, « La France s’ennuie11 ! » : on peut presque dire en tout cas qu’« Annie Ernaux s’ennuie » est un sous-titre possible des Années. Bien sûr, ce sentiment déconcertant que l’on peut éprouver est le résultat d’une démarche à la fois littéraire et éthique : il s’agit, par ce travail d’humilité, de se défaire du modèle de l’autobiographie glorieuse, toujours soupçonnée de nourrir la complaisance à soi. Il y a une part d’oubli du « je », dans cette autobiographie, et ce n’est pas qu’une question de pronom : l’écriture n’est pas seulement « transpersonnelle » (adjectif qu’Ernaux utilise pour décrire certaines de ses œuvres12), elle est pleinement impersonnelle.
Conclusion
La construction littéraire de l’identité du sujet dans Les Années est donc fondée sur un travail très concerté d’ouverture et d’élargissement d’une part, d’effacement et d’estompement d’autre part – travail qui s’appuie sur des procédés stylistiques et narratifs dont on pourrait poursuivre l’étude de manière plus détaillée que je ne l’ai fait. Mais je voudrais profiter de cette conclusion pour soulever un point de nature épistémologique et même, pourrait-on dire, éthique – un problème qu’Italo Calvino touche du doigt dans son texte Ermite à Paris : pages autobiographiques, publié de manière posthume en 1996. Voici ce qu’écrit Calvino :
À présent je dois me garder d’une autre erreur ou d’une autre mauvaise habitude propre à ceux qui écrivent des souvenirs autobiographiques, c’est-à-dire à la tendance à présenter sa propre expérience comme l’expérience « moyenne » d’une génération et d’un milieu donnés, en faisant ressortir les aspects les plus communs et en laissant dans l’ombre ceux qui sont plus particuliers et plus personnels. À la différence de ce que j’ai fait en d’autres occasions, je voudrais à présent mettre l’accent sur les aspects qui s’écartent le plus de la « moyenne » italienne, parce que je suis convaincu que l’on peut tirer toujours plus de vérité de l’état d’exception que de la règle13.
Revenons aux Années à la lumière de cette réflexion. Si le projet est de se prendre soi-même comme miroir du monde, si le but est, à partir de soi, de capter et de restituer des expériences communes, alors voici ce que l’on peut dire : ces effacements/estompements sont à la fois ce qui autorise cette démarche (en écartant le particulier et l’idiosyncrasique) et ce qui l’empêche ou le compromet. Si la vie d’Annie Ernaux semble consonner avec celles des femmes de sa génération et de sa classe, si donc l’autobiographie peut se muer en autosociobiographie14, ce n’est qu’à condition de faire silence sur ces conditions personnelles qui, pour particulières ou idiosyncrasiques qu’elles soient, n’en rejaillissent pas moins sur la perception du monde que se forme le sujet. Autrement dit, et plus concrètement, la manière dont Annie Ernaux se rapporte à son travail, à ses pratiques de consommation, aux coordonnées de sa vie privée, etc., ne peut pas être indifférente à tout ceci qui fait sa vie à elle, et dont elle ne parle guère ou ne parle pas : par exemple, sa célébrité d’écrivaine. Ce sentiment d’ennui, de léthargie, de temps distendu, qu’elle attribue à un « on », n’existe en réalité qu’autant qu’il n’y a rien dans sa vie personnelle qui fasse relief, ce dont Les Années donne l’impression, mais ce que l’on sait par ailleurs être faux. Ernaux postule que son expérience est généralisable, elle ne retient donc de son identité que les traits qui sont le plus facilement généralisables (par exemple, femme de classe moyenne et de gauche, plutôt qu’écrivaine, enseignante et transfuge de classe), et produit l’illusion d’un « elle » transpersonnel ou impersonnel ; mais le rapport au monde ainsi mis en évidence est artificiel, car aucune conscience ne se réduit à une série de traits aussi généraux : toute conscience incorpore aussi des traits plus spécifiques ou idiosyncrasiques, qui colorent l’ensemble de son rapport au monde. Ainsi, en voulant restituer une expérience qui serait celle de tous les membres d’un certain groupe, Ernaux se retrouve à restituer une expérience qui n’est en réalité celle de personne. Autrement dit encore, et c’est bien une réticence (littéraire et éthique) que je formule ici, il y a quelque chose d’un peu truqué dans cette manière de vouloir faire une « autosociobiographie » en omettant de prendre en compte un certain nombre de déterminations sociales et individuelles – comme si l’on pouvait avoir une approche aussi analytique de l’identité d’un être humain, comme si l’on pouvait choisir quelles parts de son identité on retient, à l’exclusion des autres, pour reconstituer son rapport au monde, et comme si les expériences psychologiques qui sont parfois restituées dans le livre (l’ennui, donc, mais aussi la joie, la peur, l’optimisme, etc.) n’étaient pas le fait d’une conscience unifiée. Sans aller jusqu’à dire, comme Calvino, qu’il y a plus de vérité dans l’état d’exception que dans la règle, on peut peut-être au moins dire qu’il y en a autant, et que la vérité d’un être et d’une situation ne se constitue qu’à la conjonction des deux registres. Derrière cette « autosociobiographie », il y a donc non seulement une conception du social (une sociologie), mais aussi une conception implicite de ce qui fait ou non l’unité d’une conscience et d’une vie – conception implicite qu’il faut au moins mettre au jour, et éventuellement discuter.
==================
NOTES
- Fabrice Thumerel, « Écrire contre pour écrire la vie : Les Années (texte, métatexte, intertexte et avant-texte) » dans Robert Kahn et al. (dir.), Annie Ernaux : l’intertexualité, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 164.[↩]
- Anne Strasser, « L’énonciation dans Les Années : quand les pronoms conjuguent mémoire individuelle et mémoire collective », Roman 20-50, 2012/2, n° 54, p. 165-175.[↩]
- Ibid., p. 167.[↩]
- Annie Ernaux, Les Années (2008), Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2009, p. 252.[↩]
- Je renvoie sur ce point à Aurélie Adler, « Les Années, livre-somme retissant les fils de l’œuvre », dans Francine Best et al. (dir.), Annie Ernaux : le temps et la mémoire, Paris, Stock, 2014, p. 73.[↩]
- Annie Ernaux & Nelly Wolf, « L’autobiographie au risque de la sociologie », discussion lors de la journée d’études Écrire sa vie, raconter la société : l’autobiographie au risque de la sociologie, vidéo en ligne sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=m5qk5uHg7HU, à partir de 33’30 (consultée le 22 décembre 2022). L’interprétation de Nelly Wolf suscite d’ailleurs la réticence d’Annie Ernaux, mais en l’occurrence, l’interprétation de Nelly Wolf me semble parfaitement corroborée par le texte.[↩]
- Je pense là surtout aux événements de la vie privée, mais on pourrait aussi élargir le propos à l’événementialité historique, ce qui déborderait mon sujet – notons tout de même qu’à plusieurs reprises Ernaux insiste sur le fait que telle ou telle séquence historique n’acquiert pas le statut d’événement : les manifestations contre la loi Devaquet sont un Mai 68 manqué (Annie Ernaux, op. cit., p. 171), la Première Guerre du Golfe est une Troisième Guerre mondiale qui n’a pas lieu (ibid., p. 178), etc. Comme le signale Aurélie Adler dans son article « Les Années d’Annie Ernaux : se raconter (d’) après Proust, Beauvoir, Perec », qui figure dans ce dossier, Mai 68 occupe une place particulière : il s’agit bien là d’un événement historique, raconté sur une dizaine de pages. Mais cet événement, il se trouve qu’Annie Ernaux a le sentiment de l’avoir raté (ibid., p. 126). [↩]
- Anne Strasser, art. cit., p. 173. Rappelons que L’Événement est paru en 2000 et Passion simple en 1992.[↩]
- Annie Ernaux, op. cit., p. 96.[↩]
- Ibid., p. 149.[↩]
- Ibid., p. 106.[↩]
- Annie Ernaux, « Vers un je transpersonnel » (1993), site Annie Ernaux, s. d., https://www.annie-ernaux.org/fr/textes/vers-un-je-transpersonnel/ (consulté le 22 décembre 2022).[↩]
- Italo Calvino, Ermite à Paris : pages autobiographiques (1996), trad. Jean-Paul Manganaro, Paris, Éd. du Seuil, 2001, p. 41, cité dans Sabina Loriga, Le Petit x : de la biographie à l’histoire, Paris, Éd. du Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2010, p. 262. Je remercie Vincent Heimendinger d’avoir attiré mon attention sur ce passage.[↩]
- Terme forgé par Ernaux elle-même dans son entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, publié sous le titre L’Écriture comme un couteau (Paris, Gallimard, 2003). Voir Philipp Lammers & Marcus Twellmann, « L’autosociobiographie, une forme itinérante », COnTEXTES, varia, 2001, https://journals.openedition.org/contextes/10515, consulté le 22 décembre 2022.[↩]