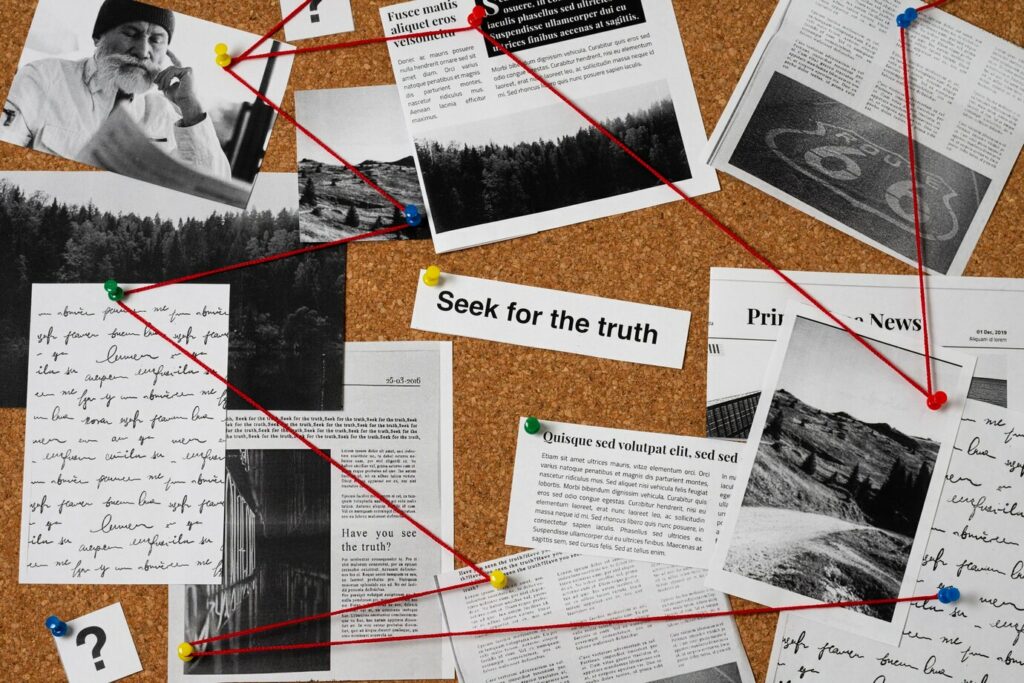Chloé Chaudet est maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l’Université Clermont Auvergne et membre de l’IUF. Dans Fictions du grand complot (Hermann, 2024), elle montre comment les narrations complotistes, en particulier dans leurs déclinaisons fictionnelles, contribuent à nourrir un « grand récit » qui perdure depuis des siècles en multipliant ses supports et en élargissant sans cesse ses cibles. Un entretien avec Maxime Decout.
Maxime Decout : L’ouvrage Fictions du grand complot aborde tant le « complot » que le « complotisme ». Comment définissez-vous ces termes ? Pouvez-vous revenir rapidement sur les problèmes terminologiques et leurs enjeux dans l’étude de ces phénomènes ?
Chloé Chaudet : Je vous remercie de commencer par cette question car à l’heure actuelle, les termes de « complot » et plus encore de « complotisme » sont employés de manière si récurrente qu’ils semblent parfois faire immédiatement sens, dans les discours médiatiques mais aussi au sein d’analyses plus académiques. Or, quand on y regarde d’un peu plus près, on se rend compte que les propos qualifiés de « complotistes » ou de « conspirationnistes » englobent en règle générale des types d’énoncés qui ne sont pas équivalents, allant des fausses nouvelles aux critiques des gouvernements en passant par les délires paranoïaques (entre autres). En regroupant tout cela sous une même étiquette, il devient difficile de réagir de manière pertinente lorsque l’on est confronté à un mode de représentation – c’est ainsi que j’envisage le complotisme – qui est déjà complexe en tant que tel.
D’où mon insistance sur l’idée que, pour qu’il y ait « complotisme », il faut qu’il y ait figuration d’un complot, c’est-à-dire d’un dessein secret concerté entre plusieurs individus visant à infléchir le devenir socio-historique. C’est du moins dans ce cadre notionnel que je m’inscris. La figuration seule d’un complot ne suffit pas toutefois à définir le phénomène en jeu : de nombreux historiens ont figuré dans leurs écrits des complots avérés en se fondant sur des méthodes reconnues par leurs pairs, et il importe aussi de distinguer ce type de reconstitution des mal nommées « théories du complot ». Je propose donc d’associer les discours complotistes relevant du complotisme à toutes les formes d’exposition pseudo-factuelle d’un complot non avéré, par un énonciateur ou une énonciatrice souvent réfractaire à la critique (comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux durant l’épidémie de Covid-19, lorsque divers dirigeants politiques et/ou détenteurs d’un pouvoir économique se sont vus accusés de vouloir manipuler la population mondiale via les vaccins qui commençaient à être administrés). Les discours concernés forment un ensemble très hétérogène où des attitudes hyper-suspicieuses, des représentations xénophobes et des perceptions crépusculaires de l’histoire alternent avec des ambitions émancipatrices voire des allusions parodiques, entre autres. Mais ces éléments de définition excluent d’affilier aux discours complotistes chaque soupçon de manipulation, chaque rumeur, chaque fausse nouvelle, chaque critique d’un propos ou d’un pouvoir officiel. Ils permettent aussi de distinguer le complotisme des suspicions de machinations intrinsèquement liées à l’exercice du pouvoir.
MD : Comment avez-vous constitué votre corpus d’étude ?
CC : Sa spécificité est qu’il est issu d’un projet d’enseignement en lycée, qui a ensuite essaimé dans mes recherches pendant environ sept ans pour devenir, finalement, un inédit d’HDR (Habilitation à Diriger des Recherches). Ses débuts ont été déterminants. En 2015, j’ai commencé à travailler sur des fictions traitant de complots dans le cadre d’un projet pédagogique interdisciplinaire que je co-encadrais dans un lycée classé en « zone sensible » (le lycée Gaston Bachelard, à Chelles : j’aurais dû me douter que la notion d’« imaginaire » m’intéresserait par la suite !) Il s’agissait en particulier d’étudier en cours de Lettres des œuvres centrées sur des complots, en les mettant en relation avec des discours complotistes analysés dans d’autres disciplines (notamment en histoire). J’ai alors été frappée par les articulations entre de célèbres pamphlets complotistes contre-révolutionnaires du tournant du XIXe siècle (telles les Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme d’Augustin Barruel) et l’œuvre romanesque de George Sand et d’Alexandre Dumas, qui reprend des éléments centraux dans ces pamphlets en inversant leur charge critique (dans La Comtesse de Rudolstadt et Joseph Balsamo, ce ne sont pas les actions des comploteurs révolutionnaires, mais celles des monarques qui sont fustigées). Par ailleurs, des structures, des topiques et des éléments lexicaux récurrents dans ces romans me faisaient songer à des fictions plus récentes traitant de complots, croisées çà et là au fil de mes lectures (de Thomas Pynchon et d’Umberto Eco, mais aussi du romancier argentin Ernesto Sábato ou de l’écrivain malien Yambo Ouologuem) : toutes déclinaient un imaginaire transterritorial du complot – imaginaire dont le développement se dessine précisément à partir de la fin du XVIIIe siècle.
Je suis ensuite partie à la recherche des chaînons intertextuels et interdiscursifs susceptibles de relier ces deux ensembles d’œuvres – la fiction française du début du XIXe siècle et la fiction en langues ouest-européennes du tournant (final) du XXe siècle – en tentant de comprendre comment on avait pu passer d’une connotation positive des conspirateurs fictifs, fréquente au XIXe siècle dans les romans historiques, à leur déconsidération récurrente (à l’instar de celle, bien connue, qui affecte les membres du gouvernement états-unien ourdissant de sombres desseins avec les extra-terrestres dans la série X-Files). A donc débuté un long parcours de lectures, d’interventions dans des colloques, de discussions et de séjours de recherche qui m’ont permis d’aboutir peu à peu à un corpus d’une centaine d’œuvres de fiction (littéraires, mais aussi audiovisuelles) créées et/ou éditées dans l’ensemble des continents bordant l’Atlantique. La prise en compte de cet espace pluriterritorial s’est avérée essentielle pour mieux saisir ce qui se joue dans les déclinaisons fictionnelles de l’imaginaire du complot à l’ère contemporaine, dont les trajectoires et les évolutions impliquent souvent des « mouvements de ping-pong entre les rives de l’Atlantique » (selon une formule de Wu Ming 1 dans Q comme Qomplot). Ces mouvements transcontinentaux étant indissociables de ceux des discours complotistes, j’ai intégré dans mon livre paru en 2024, Fictions du grand complot, une sélection représentative de textes et films pseudo-factuels, dont j’interroge les relations complexes avec les fictions que j’étudie à titre principal : des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles informées de manière frappante par les représentations sociales du complot qui circulent à leurs époques, qu’elles contribuent tantôt à alimenter, tantôt à faire vaciller.
MD : Vous insistez sur le fait pour qu’il y ait discours complotiste, il faut un projet secret indissociable d’une visée politique. Pourquoi est-ce important de le souligner ? Comment cela nous aide-t-il à distinguer le complotisme d’autres types de discours ?
CC : Il me semble en effet que pour qu’il y ait discours complotiste (vraiment) centré sur un complot, il faut qu’il y ait simultanément secret, concertation entre plusieurs individus et volonté de modeler la vie de la cité. Sans l’association de ces trois éléments, il n’est plus question d’une concertation secrète menée à des fins politiques, mais juste d’un secret, ou, au mieux, d’une concertation secrète, comme dans le cas d’un anniversaire surprise (je reprends cet exemple à Sylvain Delouvée et Sebastian Dieguez, auteurs de l’une des rares synthèses interdisciplinaires en langue française sur le sujet : Le Complotisme. Cognition, culture, société). En reliant le « complot » et les termes qui en sont dérivés à des stratégies ourdies pour modeler la vie de la cité, on évite à la fois de dépolitiser les notions en jeu et de basculer dans une approche « pancomplotiste », qui consisterait à voir du complotisme partout – et donc nulle part.
MD : Vous mentionnez la « dimension fabulatrice » des textes et énoncés « pseudo-factuels ». Comment faire la différence entre ce qui relève de l’imaginaire et ce qui se présente comme factuel dans ces récits ? Pouvez-vous revenir sur ces deux catégories et expliquer comment vous les abordez ?
En employant l’expression « ce qui se présente comme factuel », vous rejoignez exactement mon point de vue. Le problème, me semble-t-il, dans les discours complotistes n’est pas qu’ils mêlent éléments factuels et éléments imaginaires ; bien d’autres types d’énoncés jouent sur les frictions entre faits et inventions – y compris les énoncés fictionnels, au sens restreint et esthétique du terme. En revanche, je juge très problématique que les discours complotistes se fondent sur des constructions imaginaires tout en se présentant comme factuels (même s’ils ne sont pas toujours reçus comme tels). C’est là ce qui les distingue des inventions se présentant et étant reçues comme des fictions (ou des « feintises ludiques partagées », selon la formule désormais canonique de Jean-Marie Schaeffer).
On peut tenter de pointer la dimension imaginaire des discours complotistes en usant de différentes stratégies : par une mise à l’épreuve empirique menant à une réfutation, par une discussion critique (traits définitoires d’une « théorie » au sens scientifique du terme), par l’application de ce que ces discours affirment à un autre domaine révélant leur absurdité, etc. On peut aussi – c’est ce que je cherche à faire dans mes travaux – les passer au crible d’une approche sociocritique attentive aux relations entre discours sociaux et productions esthétiques. S’il faut distinguer les fictions qui m’intéressent des énoncés pseudo-factuels (qui renvoient à des situations d’énonciation distinctes), il faut aussi reconnaître que tous deux procèdent de logiques créatives, qu’il s’agit donc de faire émerger pour afficher la dimension fabulatrice des discours complotistes, et, partant, exhiber le caractère hautement problématique de leur prétention à la factualité. L’analyse des chaînes intertextuelles est par exemple édifiante, comme j’ai pu le constater avec des étudiant·es de Licence qui tendaient à réduire les discours complotistes à de sèches constructions argumentatives : en montrant que les sinistres Protocoles des sages de Sion (texte pseudo-factuel du début du XXe siècle) sont informés par des représentations qui ont d’abord été façonnées dans des romans-feuilletons allemands et français du siècle précédent, on peut exposer de manière flagrante l’élaboration créatrice qui innerve les discours complotistes, et les exclure ainsi du domaine des énoncés factuels.
MD : Vous indiquez que la représentation d’un complot implique des processus narratifs spécifiques. Pouvez-vous expliquer comment les éléments d’un complot – comme la concertation, le secret, l’ambition de modeler l’ordre établi – influencent la construction narrative ?
CC : C’est un autre point commun entre les productions fictionnelles et les énoncés pseudo-factuels centrés sur des complots (telle la série de pseudo-documentaires Loose Change réalisée par Dylan Avery, relecture complotiste des attentats du 11 septembre 2001 dont la diffusion internationale est comparable, mutadis mutandis, à celle des Protocoles des sages de Sion). À l’instar du terme anglais « plot », qui renvoie à la fois au complot et à l’intrigue ou à la mise en récit, complot et narration sont indissociables. Qu’il soit avéré, pseudo-factuel ou fictionnel, tout complot nécessite un récit pour être représenté. On le note assez facilement en se penchant sur les représentations picturales de complots : même les plus vivantes d’entre elles (je pense en particulier à La Conspiration de Claudius Civilis peinte par Rembrandt) peinent à figurer l’ensemble des éléments constitutifs du complot que vous rappelez ici. Les ressorts et les effets des processus narratifs qui définissent le complot peuvent être étudiés à partir de micro-narrations, l’une des formes récurrentes des discours complotistes. Mais ils sont davantage mis en valeur par les (longues) fictions – celles d’un Alexandre Dumas, d’un Roberto Arlt, d’un Thomas Pynchon –, qui se distinguent par des stratégies narratives plus variées, se conjuguant parfois à une réflexivité affichée, propre aux récits fictionnels. D’où l’intérêt de les prendre en considération quand on s’intéresse aux figurations du complot.
MD : Est-ce que la dimension dynamique de la mise en intrigue (suspense, tension, révélation) fait partie intégrante de ces figurations du complot dans la fiction ? Pourquoi ces éléments sont-ils importants à prendre en considération ?
CC : Oui ! Même quand les fictions du complot s’achèvent par des révélations tronquées, ne vont pas jusqu’au bout du processus de dévoilement qui les caractérise (c’est par exemple le cas dans Vente à la criée du lot 49 ou L’Arc-en-ciel de la gravité de Thomas Pynchon – toujours Pynchon !), ou mettent en relation suspense narratif et suspicion critique (comme dans Le Pendule de Foucault d’Umberto Eco ou certaines nouvelles de Borges), elles en appellent aux affects. Pour le dire avec le narratologue Raphaël Baroni, ces fictions sont structurées par des effets « thymiques », visant à réguler les dispositions affectives (thumos) de leurs récepteurs et réceptrices. On pourrait probablement l’observer dans n’importe quelle intrigue fondée sur une dynamique de révélation. Mais en étudier les ressorts et les effets à partir de fictions du complot est l’occasion, par ricochet, de souligner la pertinence d’une narratologie pragmatique dans l’analyse de différents types de constructions imaginaires évoquant des complots, qu’elles soient fictionnelles ou pseudo-factuelles. Pour en donner un exemple rapide à partir d’un corpus (très) resserré : des effets de curiosité et de surprise assez semblables sont cultivés dans le roman Manuscrit trouvé à Saragosse (1810) de l’écrivain polonais de langue française Jean Potocki et dans l’essai Eurabia : l’axe euro-arabe (2005) de la Franco-Britannique Bat Ye’or, soit deux textes qui, en dépit de leur distance temporelle, convoquent le motif du « Grand Remplacement » en l’associant à la révélation d’un complot musulman. Les dévoilements en jeu, aussi problématiques soient-ils, ne tendent pas seulement à susciter une satisfaction d’ordre intellectuel. Ils impliquent aussi des dispositifs affectifs visant à nous tenir en haleine, à nous captiver voire à nous fasciner : le reconnaître permet de mieux comprendre leur succès auprès de publics très variés, qui tient en partie à la profondeur socio-anthropologique de notre appétence pour l’intrigue. La puissance de la mise en intrigue dont procèdent les narrations complotistes contribue en tout cas à expliquer l’impuissance du « fact-checking », du « debunking » et d’autres stratégies rationnelles visant à réfuter les énoncés concernés : les spécialistes du complotisme gagneraient à en prendre acte en s’intéressant sérieusement à la narratologie, dont les évolutions actuelles sont passionnantes à ce titre.
MD : Vous expliquez que les complots fictifs ont souvent une portée transterritoriale en tant que tels, au sein des narrations. Pourquoi est-ce important de l’envisager et en quoi cela nous aide-t-il à mieux comprendre l’évolution de nos représentations collectives ?
CC : J’ai mentionné au début de notre entretien l’extension concrète des manifestations de l’imaginaire du complot en langues ouest-européennes, qui se créent sur les deux rives nord de l’Atlantique dès la fin du XVIIIe siècle avant de se développer en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique. Mais c’est aussi à un niveau plus symbolique que j’ai travaillé sur les représentations transterritoriales qui innervent les narrations complotistes. Me concentrer sur le motif du grand complot m’a permis de constituer un corpus d’une taille raisonnable, mais m’a aussi offert une occasion remarquable d’envisager les évolutions des représentations du monde que ses variations invitent à mettre au jour. C’est la raison pour laquelle je définis le « grand complot » de manière assez ouverte. En l’associant, comme je le propose, à un complot dont les visées excèdent une seule zone géographique et linguistique, on s’autorise à penser les projets maximalistes qui lui sont liés autrement que dans leurs enjeux globaux, au sens planétaire et actuel du terme. L’étude en diachronie des récits du grand complot souligne ainsi que les secousses de l’histoire n’empêchent en rien l’affirmation progressive de représentations du monde qui s’avèrent de plus en plus concrètes et polycentriques à mesure que l’on se rapproche de l’époque actuelle. Celles-ci vont de pair avec une dynamique de totalisation qui contribue à contredire (ou a minima à nuancer) la célèbre thèse de Jean-François Lyotard associant la « postmodernité » à la « fin des grands récits ».
MD : Les fictions du complot peuvent refléter ou manipuler des stéréotypes et des pensées raciales. Pourriez-vous revenir sur ce point essentiel de l’analyse ?
CC : Comme toute production culturelle, les fictions du complot sont informées par le meilleur comme par le pire de ce qui circule dans la société. Mais davantage, peut-être, que d’autres formes narratives concernant à la fois des fictions de genre et des œuvres plus élaborées, les fictions du complot participent régulièrement à la diabolisation des prétendus conspirateurs qu’elles mettent en scène – par des moyens qui ne leur sont pas toujours propres, mais que leur cadre fictionnel leur donne la liberté de cultiver pour déployer des images saisissantes, plus à même d’être (re)mises en circulation. On le constate en envisageant les liens entre les figures de jésuites démoniaques qui, des fictions de Friedrich Schiller à celles d’Eugène Sue, peuplent en masse le roman européen du tournant et de la première moitié du XIXe siècle, et les personnages de comploteurs juifs, que l’on retrouve de plus en plus fréquemment dans les narrations complotistes à partir de la fin du même siècle (par exemple chez l’écrivain prussien Hermann Goedsche ou le romancier britannique Guy Thorne) – soit deux ensembles de figures associées à un cosmopolitisme déjà fustigé, à l’époque, par une partie du champ politique. Les diabolisations qui affectent, à des degrés divers, ces deux types de conspirateurs fictifs reposent en particulier sur la déshumanisation des figures participant aux complots et sur ce que je nomme « l’amalgame des malheurs », qui consiste à attribuer l’entière responsabilité de fléaux divers et variés aux figures conspiratrices au cœur du propos. On peut alors observer que le récit fictionnel n’a pas besoin d’être réaliste pour avoir des effets plus ou moins directs sur le réel. L’étude des circulations interdiscursives de l’imaginaire du grand complot juif permet à ce titre de retracer les manières dont des éthopées antisémites intégrées dans des fictions ont ensuite proliféré via des narrations pseudo-factuelles (tel le film de propagande Der Ewige Jude de Fritz Hippler, sorti en 1940 sous la supervision de Joseph Goebbels, exemple glaçant de pseudo-documentaire fondé sur un récit antisémite) – les deux formes narratives ayant en partage une même « gnoséologie romanesque », selon une formule de Marc Angenot dans son indispensable Ce que l’on dit des Juifs en 1889. Il existe par ailleurs des fictions qui se ressaisissent de l’imaginaire du grand complot juif pour le déconstruire, à l’instar du Cimetière de Prague d’Umberto Eco : en l’occurrence, la manipulation des stéréotypes s’inscrit dans une critique qui cible l’antisémitisme – avec le risque, inhérent à la réception de toute fiction, que cette ambition critique soit interprétée à rebours des souhaits de l’écrivain·e.
MD : Est-ce que l’étude de la fiction nous aide à mieux comprendre les ressorts psychologiques et sociaux qui sous-tendent le complotisme ?
CC : J’en suis convaincue, pour deux raisons au moins. La première est que les fictions du complot possèdent plusieurs points communs avec les discours complotistes. Outre leur narrativité, dont il a déjà été question, les fictions centrées sur des complots convoquent fréquemment des mêmes figures conspiratrices que celles qui apparaissent dans les discours complotistes, et soulignent en ce sens qu’elles sont informées par les représentations collectives qui orientent, à des degrés divers, notre perception du devenir socio-historique. La multiplication assez récente des fictions mettant en scène des complots visant à réaffirmer la place de diverses figures chrétiennes peut par exemple être analysée comme une réponse indirecte à une (relative) perte d’influence du catholicisme (le succès planétaire des romans Anges et Démons et Da Vinci Code de Dan Brown et de leurs adaptations filmiques est ici assez emblématique) ; on peut aussi songer aux accusations anti-occidentales formulées en Afrique dans le contexte de la propagation du VIH, qui imprègnent en tout ou partie des fictions récentes traitant de complots occidentaux ciblant des États africains (par exemple dans Le Vol du flamant de Mia Couto ou Mathématiques congolaises d’In Koli Jean Bofane). Sans nécessairement considérer la fiction du complot comme une instance de modélisation de premier plan, il faut reconnaître qu’elle configure à sa manière les antagonismes qui structurent la vie psychique et sociale, qu’elle donne forme aux doutes, craintes et espoirs qui alimentent nos modes de pensée et nos interactions.
Or, précisément, elle le fait à sa manière, qui diffère de la perception du réel encouragée par les discours pseudo-factuels – en tout cas pour ce qui concerne les fictions sur lesquelles j’ai travaillé, dont les paratextes suffisent à indiquer la nature fictionnelle. (Que le roman climatosceptique État d’urgence de Michael Crichton, plus connu pour être l’auteur de Jurassic Park, s’ouvre par une note précisant que « les références à des personnes, institutions et organisations figurant en note de bas de page sont exactes », n’a ainsi pas grande influence sur le cadrage éditorial effectué par HarperCollins.) C’est là une deuxième raison de souligner l’intérêt d’une étude de la fiction : parce qu’elle signale, contrairement aux discours pseudo-factuels, qu’elle crée un univers qui n’est pas (tout à fait) le nôtre (ce qui est très visible dans les œuvres frayant avec la dystopie, à l’instar de La Grève d’Ayn Rand ou des Sorcières de la République de Chloé Delaume), la fiction du complot propose une expérience de pensée nous invitant à envisager sans les accréditer les logiques, les effets et les ambivalences de l’imaginaire du complot dans son ensemble. L’intérêt de cette position oblique gagnerait à être davantage reconnu dans l’enseignement secondaire et supérieur, où les cours consacrés au complotisme accordent rarement une vraie place à la fiction.
MD : Au vu de tout ceci, qu’apporte l’analyse littéraire à une réflexion sur le complotisme ?
CC : La réponse pourrait tenir en trois formules : une meilleure compréhension, des jugements plus nuancés, des réactions mieux adaptées. Les raisons en sont à chaque fois multiples mais on peut expliciter chacune de ces trois formules en partant d’un aspect du complotisme dont il est généralement assez peu question dans les analyses qui s’y consacrent. (1) En montrant qu’œuvres littéraires et discours conspirationnistes alimentent ensemble un imaginaire pluriséculaire du complot, on permet de mieux comprendre la profondeur historique et socio-anthropologique du complotisme, qui participe de son efficacité. (2) En expliquant que la littérature fictionnelle est peuplée de conspirateurs magnanimes et met en scène nombre de complots émancipateurs (de La Comtesse de Rudolstadt de George Sand à la trilogie Les Falsificateurs d’Antoine Bello, en passant par Le Royaume de ce monde d’Alejo Carpentier et l’Histoire abrégée de la littérature portative d’Enrique Vila-Matas, sans oublier le récent film Bacurau, réalisé par les Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles), on invite à nuancer l’association fréquente de la notion de complot à des machinations néfastes – par exemple au prisme d’une réflexion sur les évolutions des conceptions de l’opacité. (3) En mettant en évidence le fait que les logiques narratives liées au motif du complot, que la fiction aide à identifier, impliquent des dispositifs affectifs caractérisant aussi les narrations pseudo-factuelles, on engage à réfléchir à d’autres méthodes que la réfutation, souvent peu efficace, pour communiquer avec un·e complotiste. Ce ne sont là que trois exemples de ce que peut apporter dans ce domaine l’analyse littéraire.
Mais cela n’est envisageable qu’à certaines conditions, qui sont loin, en France, d’être toutes remplies chez les représentant·es des études littéraires. L’une d’entre elles est de concevoir la littérature et l’analyse littéraire de manière ouverte, à rebours d’un réflexe assez répandu consistant à parler de « littérature » ou de « théorie littéraire » en se restreignant au domaine linguistique français et, souvent, aux manifestations jugées prestigieuses de la littérature et de la pensée hexagonales (que ce prestige relève d’une validation institutionnelle, médiatique ou militante). Sans mettre en relation des littératures issues de différents domaines linguistiques et sans articuler les études littéraires aux études culturelles, pour ne citer qu’elles, on comprend mal comment se construit et se diffuse un imaginaire dont on trouve des traces flagrantes à la fois dans des fictions non éditées qui circulent dans certains marchés d’Afrique subsaharienne, dans des œuvres françaises publiées par les Éditions Verticales et dans les best-sellers du romancier états-unien Dan Brown. Il ne s’agit pas de prôner un arasement relativiste ni de céder aux sirènes du néolibéralisme, mais de considérer dans toute leur ampleur et leur hétérogénéité les configurations imaginaires de nos représentations collectives du complot – en n’oubliant pas l’adjectif « collectives ».