Itinéraire posthume de l’antilibéralisme schmittien. Un héritage incontournable

A propos de Jan-Werner Müller, Carl Schmitt : Un esprit dangereux (2003), trad. par Sylvie Taussig, Paris, Armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2007, 400 p.
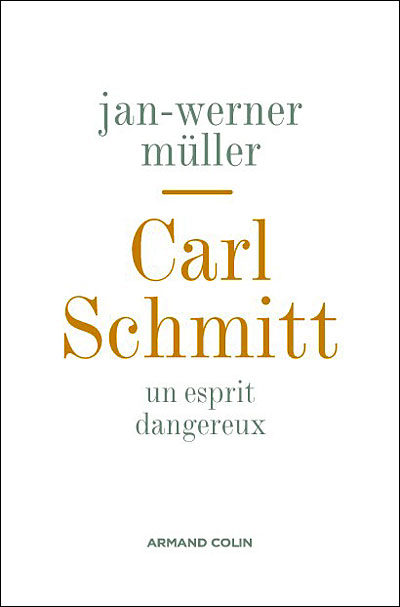
Publié à l’origine en anglais en 2003, l’ouvrage de Jan-Werner Müller, Carl Schmitt : Un esprit dangereux, a été traduit en français dans la collection « Le temps des idées » dirigée par Guy Hermet. Il tombait à point nommé dans le monde universitaire et intellectuel francophone, où il n’était pas rare d’entendre que ce « Hobbes du vingtième siècle1 » n’aurait plus rien à nous livrer. Schmitt, un esprit à la fois brillant et dangereux — ou, pourrait-on dire, dangereux en raison de son talent indéniable — a connu la crise de la république de Weimar, les deux guerres mondiales, la séparation de l’Allemagne et la Guerre froide ; son œuvre vieille de soixante-dix ans est, quelque part, le parangon des meurtrissures que porta le siècle récemment écoulé2. En mai 1933, le juriste rhénan adhérait à la NSDAP, donnant du crédit au régime hitlérien au travers de nombreux textes rédigés durant cette période. S’il prend néanmoins ses distances à l’égard du Führer dès 1936, il ne reniera jamais son antisémitisme philosophique, comme l’atteste avec virulence le recueil de ses journaux publié après sa mort, en 1991. C’est cette compromission qui fait d’ailleurs question ; les commentateurs se sont demandés jusqu’à quel point un tel ralliement se répercuta sur les écrits schmittiens ultérieurs. Certains exégètes ont aussi pris le parti d’affirmer que les prémisses analytiques de l’adhésion de Schmitt au nazisme se découvraient à la lecture de ses livres de jeunesse. Depuis quelques années, semblables questionnements ont été au cœur des débats français. Mais force est de reconnaître qu’en dépit de son passé funeste, Carl Schmitt semble avoir suscité l’intérêt d’auteurs très différents et joué un rôle particulièrement influent dans l’évolution des discussions politico-philosophiques contemporaines. Dans son ouvrage, Jan-Werner Müller, professeur à l’université de Princeton, s’attèle à examiner de près la réception essentiellement européenne (surtout allemande) de l’œuvre du juriste rhénan ou, comme il le dit si bien lui-même, à « constituer une histoire critique de « ce que Schmitt a signifié » pour le vingtième siècle3.
Dans une première partie, intitulée « Un juriste allemand au vingtième siècle », Müller retrace chronologiquement, et avec érudition, le parcours biographique et intellectuel de Carl Schmitt, depuis la rédaction de ses deux thèses de doctorat jusqu’au retranchement du savant dans son village natal du Sauerland, au lendemain du procès de Nuremberg. Pointant du doigt les contradictions et les arguments forts de la pensée de Schmitt, l’auteur compose le portrait d’un jeune publiciste qui, dès l’amorce de sa carrière, s’employa à forger et à affûter un arsenal théorique destiné à mettre à mal le libéralisme bourgeois, le parlementarisme dominé par les intérêts d’une frange sociétale non représentative. La doctrine libérale, qui refuse de discerner ses ennemis et de reconnaître le primat de la décision, participerait du phénomène d’envahissement de l’État par la société dont serait responsable la prolifération des associations économiques. À la lecture des premiers chapitres, on comprend rapidement qu’aux yeux de Müller, l’antilibéralisme constitue la pierre angulaire, le motif central de la pensée politique de Schmitt, telle qu’elle s’est déployée durant les années vingt. Le philosophe de Weimar s’est évertué à rendre la mass democracy compatible avec l’autoritarisme, par l’intermédiaire d’une théorie de la représentation à même de rendre publiquement présent le peuple rassemblé. Il oppose sa définition particulière de la démocratie aux conceptions libérales de la notion qui l’identifient à une simple addition des voix des individus esseulés dans l’isoloir. Müller n’aurait pas pu procéder autrement qu’en restituant le contexte d’énonciation des philosophèmes schmittiens, dans la mesure où l’examen de l’impact de cette pensée représente le centre névralgique de son étude. Puisqu’il opère de la sorte, il peut éminemment tenter, dans la suite du récit, de répondre à la question de savoir ce qui, en dehors de la conjoncture contextuelle, est susceptible d’être extirpé et de survivre à son fondateur.
Depuis les travaux de Dirk van Laak4, Carl Schmitt : Un esprit dangereux est certainement, à ce jour, l’examen le plus exhaustif qui a trait à la réception allemande, et plus largement européenne, des idées schmittiennes. Müller sillonne l’héritage du juriste, auteur par auteur, tout en évitant soigneusement le travers qui consisterait à débusquer des « schmittiens » partout, au détour de la moindre citation ; il rapporte en substance les nombreux débats pointus et spécialisés qui animèrent l’histoire des idées politiques de l’après-guerre, livrant des tendances, des filiations qu’il ne cherche nullement à plaquer sur une typologie embarrassante. Les arguments des successeurs et des interlocuteurs intellectuels de Carl Schmitt sont livrés dans toute leur singularité discursive. Si bien qu’il est difficile qu’échappe au lecteur le fait que Schmitt ait pesé de manière considérable sur les raisonnements de nombre de ses contemporains. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quoique privé d’enseignement et écarté des universités, Carl Schmitt, ayant refusé de se soumettre à la dénazification, reçoit furtivement dans sa demeure à Plettenberg une minorité influente de penseurs qui participèrent à la mise sur pied de la nouvelle structure étatique ouest-allemande : Nicolaus Sombart, Hanno Kesting, Reinhart Koselleck, Roman Schnur, Armin Mohler ou encore Ernst-Wolfgang Böckenförde, pour ne citer que quelques noms. Il n’est donc pas faux d’affirmer, avec Habermas, que « l’histoire de cette influence a[urait] une valeur fondatrice pour l’État allemand5. » L’ombre de l’auteur de La notion de politique a effectivement plané sur les controverses d’après la guerre et accompagné le façonnage théorique du paysage juridico-polititque de la RFA. Devant le triomphe de l’adversaire américain, Schmitt, qui refusa de faire contrition et de consacrer la mise au ban de l’unité politique allemande, a permis d’assurer « la continuité d’une tradition allemande qui aurait été mise en cause6. » Tenu en dehors du « système », à l’écart des lieux déterminants, il est devenu une figure d’inspiration emblématique pour toute une série de jeunes théoriciens qui n’hésitèrent aucunement à puiser, dans son œuvre, des conceptions plutôt mal perçues à l’époque. Ses réflexions, conservatrices et autoritaires, furent relayées ; elles alimentèrent les discussions relatives à la rédaction d’une Constitution pour l’Allemagne de l’Ouest, exhumant l’option d’une protection de la démocratie renaissante contre ses ennemis antidémocratiques. L’idéal d’un État fort fut puissamment reconduit dans les écrits d’Ernst Forsthoff, schmittien devant l’Éternel, bien décidé à remettre l’État au-dessus de la société et des intérêts conflictuels qui animeraient cette dernière.
Mais l’œuvre du publiciste de Weimar n’a pas seulement eu écho à travers les travaux d’auteurs plus ou moins conservateurs : la réception de la pensée du juriste a pour spécificité d’être étonnamment polarisée. Jürgen Habermas lui-même, l’un des plus farouches contempteurs du théoricien du politique, n’a pas manqué de reconnaître l’exactitude du constat de Schmitt qui conclut à une déliquescence de la logique parlementaire. L’histoire de l’ « espace public » suit, en effet, à la lettre l’analyse que soumet Carl Schmitt de la transformation progressive du parlementarisme7. Dans son ouvrage, Müller rapporte que Henning Ritter, le fils de Joachim Ritter, avait déjà laissé sous-entendre qu’il existerait « une relation entre la pensée de Habermas et celle de Schmitt8 » ; plus récemment, et en France qui plus est, Philippe Raynaud a défendu la thèse suivant laquelle la pensée du défenseur du patriotisme constitutionnel serait particulièrement redevable de celle du juriste allemand, « dans la mesure même où elle s’est constituée contre le décisionnisme de Schmitt9 ». Phénomène plus curieux encore, une partie des doctrinaires libéraux prit l’initiative de libéraliser la pensée « du plus brillant ennemi du libéralisme qu’ait vu le siècle10. » Certains envisagèrent de composer un libéralisme amendé, capable de répliquer aux défis lancés par le juriste rhénan. Schmitt aurait diagnostiqué avec précision et acuité les failles et les faiblesses de la doctrine libérale, formulant des « questions percutantes » qui tourmentèrent les orthodoxies libérales ; il demeurerait entièrement envisageable de remédier aux problèmes de la neutralité et de la stabilité politique, deux béances qui fragiliseraient les théories libérales, en redéployant différemment les concepts du juriste — à se confronter aux anamnèses du philosophe conservateur, le libéralisme en ressortirait grandi. Parmi d’autres, Odo Marquard et Hermann Lübbe « s’efforcèrent de libéraliser des pans entiers de sa pensée pour la mettre au service de la démocratie libérale, c’est-à-dire pour la fortifier et lui donner de meilleurs outils pour qu’elle soit à même de relever des défis antilibéraux11. » Il en résulte « un mélange instable de priorités libérales et de moyens non libéraux12. » Lübbe s’est notamment risqué à prélever la méthode décisionniste chez Schmitt, dans l’optique assumée de renforcer la démocratie libérale. Cependant, comme l’indique Müller, une pareille entreprise dévoile avec clarté les limites d’une compatibilité des concepts schmittiens avec la pensée libérale, vu que Lübbe, par exemple, se voit contraint de délier la stabilité politique du principe de justification publique. Mais l’extrême droite ne demeure pas en reste ; elle s’est, elle aussi, penchée sur les arguments avancés par le juriste. En effet, sur une autre case de l’échiquier politique, la Nouvelle Droite française, menée par Alain de Benoist, a pour sa part multiplié les références à Schmitt afin de préserver la particularité des peuples contre l’universalisme libéral abstrait13.
Au bout de chaque avenue, détaillée par Müller, qu’empruntèrent les nombreux « héritiers » de Carl Schmitt, aussi divers fussent-ils, émerge l’antilibéralisme pérenne du savant de Plettenberg. D’autres exégètes ont également émis une semblable hypothèse, sans toutefois l’étayer avec force détails comme l’a fait Jan-Werner Müller14. La tangibilité patente de la mondialisation socio-économique qui, d’autre part, s’étend au nom de principes éthiques (l’exportation des Droits de l’Homme), « ranime en permanence la tentation de reprendre la critique que Schmitt a dirigé contre un libéralisme tour à tour impuissant ou hypocrite15 » — de la reprendre ou de s’en inspirer, de l’amender et de la prolonger. Les questions posées par le penseur conservateur ainsi que les diagnostics qu’il énonce ont connu une prorogation considérable au vu de la chronologie qu’a bâtie Müller. Il y a d’ailleurs fort à parier que les thèses et les outils conceptuels forgés par Schmitt en son temps n’ont pas terminé de nous livrer leurs vertus heuristiques, qu’elles demeurent susceptibles de nous révéler leur « actualité » potentielle.
En filigrane, Müller met le doigt sur deux phénomènes majeurs, qu’il analyse pour partie, et qui touchent de très près à l’héritage des théories politiques de Carl Schmitt. Ces deux questions ont trait à l’usage on ne saurait plus actuel — souvent polémique — des idées du juriste rhénan. Incontestablement, elles attestent de l’actualité manifeste de certains pans importants de la pensée de Schmitt, elles témoignent du caractère indéniable de l’héritage schmittien. D’un côté, à l’heure de la mondialisation, le post-marxisme semble éprouver toutes les difficultés du monde à se (re)définir : pour pallier un « manque » conceptuel, des théoriciens de la gauche radicale ont vu en Schmitt une formidable source d’inspiration disposée à redorer un blason obsolescent. D’autre part, bien qu’il est (ou qu’il fût) coutumier de dépeindre l’auteur du Nomos de la Terre comme le héraut de la cause statonationale, il semblerait que celui-ci ait pu léguer un attirail systématique habilité à penser positivement l’intégration macro-régionale, et plus particulièrement européenne, ainsi que moult arguments à même de souligner les faiblesses potentielles de toute construction continentale.
Les tourments théoriques du post-marxisme : le conflit en guise de politisation
Après la chute du mur de Berlin, Müller le répète à plusieurs endroits de son livre, une certaine gauche post-marxiste devait redécouvrir la pensée politique de Carl Schmitt. Les accointances de la gauche avec les concepts du théoricien conservateur ne relèvent toutefois pas d’une situation entièrement inédite. Depuis les années soixante, plusieurs auteurs ou mouvements radicaux se sont intéressés de près aux écrits du juriste, à commencer par Joachim Schickel, maoïste de son état. La Théorie du partisan, publiée en 1962, et l’optimisme général que purent inspirer à Schmitt les luttes anticoloniales n’y sont pas pour rien dans l’intérêt de la gauche qui essaie de penser le rôle de la guérilla dans les limites d’une idéologie révolutionnaire16. Peu de temps plus tard, toujours en Allemagne, Johannes Agnoli ressuscitait la critique schmittienne du parlementarisme, arguant que l’organe représentatif aurait développé une structure profondément oligarchique qui, de fait, ne représenterait plus le peuple mais l’État17. À la même période, en Italie, Mario Tronti et les « Marxisti Schmittiani » empruntaient le syntagme de l’ami et de l’ennemi — critère spécifique du politique —, l’interprétant sous la forme d’une compréhension renouvelée de l’antagonisme de classes18. On le voit, les récents emprunts à gauche ne sont pas sans posséder quelques antécédents de marque. C’est probablement chez Antonio Negri et Giorgio Agamben que le recyclage équivoque de concepts schmittiens pour une analyse ou pour une résolution normative des problèmes politico-philosophiques contemporains s’avère le plus frappant. Alors qu’Agamben mobilise le paradigme de l’ « état d’exception », Negri réfléchit le « pouvoir constituant » en s’appuyant notamment sur La dictature19. La visibilité retentissante des thèses et des prescriptions de ses deux auteurs a fait prendre conscience de l’ampleur d’un phénomène d’actualité, celui d’un « schmittianisme » (ou d’un « schmittisme ») de gauche. Selon Yves Charles Zarka, qui persiste a pensé que Schmitt est l’auteur de documents et non d’une œuvre, si l’extrême droite en vient à faire appel à Carl Schmitt, ce serait là « une chose naturelle », puisqu’elle ne ferait que « revendiquer ce qui lui appartient et selon une rhétorique habituelle », mais que la gauche radicale « prenne le même chemin », voilà un phénomène quelque peu incongru qui, d’après le spécialiste français de Hobbes, témoignerait d’une « crise idéologique » profonde du post-marxisme20. Pourquoi donc — car il est vrai qu’une telle inspiration ne semble pas aller de soi — une partie de la gauche actuelle s’est-elle empressée de recourir aux philosophèmes d’un conservateur aguerri qui, par surcroît, se compromit un temps avec le Reich hitlérien ?
Dans un ouvrage publié il y a peu, Jean-Claude Monod tente d’apporter une première explication à ce curieux syndrome, en précisant que « les lectures marxistes de Schmitt pourraient faire l’objet d’une étude en soi21 ». Il existerait sinon une réelle connexité, du moins une connivence notable, entre la pensée marxiste et celle du publiciste de Weimar : elles consacreraient, toutes les deux, l’existence d’une distinction conceptuelle originale. À la fois sanctifiée par Schmitt et par les théories marxistes, « la dissociation du libéralisme et de la démocratie » légitimerait un certain type de violence — celle de la classe ouvrière dans le cas des épigones de l’auteur du Capital. Mais, d’un autre côté, « la dissociation du politique et de l’étatique », constat malheureux dans La notion du politique, permettrait à l’extrême gauche actuelle de libérer le peuple — le pouvoir constituant — du joug de la souveraineté du prince22. Cette proximité analytique aurait rendu possible un emploi réfléchi (et infléchi) des thèses de l’ancien partisan du Troisième Reich. Les outils empruntés par « les schmittiens de gauche ou d’extrême gauche » leur auraient surtout permis de dénoncer l’un des travers de l’ordre libéral, à savoir le sapement de l’État de droit par le biais de procédures d’exception totalement banalisées23. La traduction en français du livre de Müller met à la portée du lectorat francophone un constat qui, quoique formulé quelques années auparavant, s’apparente grandement à celui de Monod. Néanmoins, le professeur de Princeton insiste plus particulièrement sur le fait que la gauche aurait trouvé chez Schmitt une réponse, qu’elle juge sans doute déterminante, dans l’objectif de pallier le besoin d’une repolitisation de la lutte contre le libéralisme triomphant ; c’est-à-dire le besoin d’une constitution de l’unité politique face à l’adversaire capitaliste. « En particulier, nous dit Müller, la pensée de Schmitt est censée compenser l’absence du politique et, plus encore, l’absence d’une théorie de l’État dans le marxisme24. » Partant du théoricien du politique, la gauche d’inspiration schmittienne finirait par célébrer le retour du conflit international ouvert, afin de s’opposer à l’universalisme libéral qu’elle calomnie pour cause de son hypocrisie. Plutôt que de concevoir « un modèle d’action politique à proprement parler », elle se borne à « réaffirmer la nature inévitablement conflictuelle du politique » (soit qu’elle estime cela comme une nécessité véritable, soit qu’un engagement dans une telle direction lui paraît préférable au triomphe du marché mondial)25. Dans tous les cas, il semble pour Müller que le post-marxisme souffre d’insuffisances théoriques, dans son combat contre le libéralisme, et qu’à ce titre, la pensée du plus fidèle détracteur de la doctrine libérale a pu tenir lieu d’expédient.
Si en Allemagne ou en Italie, les emprunts contemporains aux théories de Schmitt peuvent prendre appui sur de véritables précédents, Zarka souligne qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène assez nouveau en France26 » — l’étude de Müller se cantonne d’ailleurs principalement aux deux premiers pays cités, et l’auteur ne cache pas que le « terme » de son parcours introspectif ne soit que « tout provisoire27 ». Daniel Bensaïd et Étienne Balibar ont, entre autres, eu recours à la pensée du juriste, ce dernier soutenant pour sa part que « pour connaître l’ennemi, il faut aller au pays de l’ennemi28. » Les réflexions de Balibar, ancien élève d’Althusser, nous apparaissent comme une piste conséquente, dans l’optique de concilier le « schmittianisme de gauche » (antilibéral) avec le refus de consacrer l’avènement du conflit comme mode d’être du politique. L’exigence d’une politisation — ou, plus simplement, d’une définition d’un « état » politique — peut déboucher, en dernière instance, sur « une résistance à la violence29 ». Le philosophe français reconnaît sans ambages que le juriste rhénan a pesé sur l’histoire des idées politiques ; il n’a du reste pas hésité à affirmer, dans sa préface à la traduction du Der Leviathan de Schmitt, que la pensée de celui-ci était « l’une des pensées les plus inventives30 » du vingtième siècle. C’est en s’adossant à la théorisation schmittienne de la souveraineté, qui lui apparaît « indispensable » pour comprendre l’ensemble des discours ayant trait « aux limites d’application » d’un tel concept31, que Balibar a pu développer « la thèse d’un extrémisme du centre », taxant l’État de droit libéral d’être doté d’une « face d’exception » qui participerait à l’exclusion des anormaux et des déviants32. Mais cette prise en considération des arguments antilibéraux du juriste, que Balibar actualise et façonne, ne l’a pas empêché de questionner les « effets destructeurs de la violence, y compris de la violence révolutionnaire33. » La violence détruirait la possibilité même de la politique dont le maintien nécessiterait « un moment propre de civilité », c’est-à-dire un moment à l’issue duquel serait introduit l’impératif de l’anti-violence. À bien lire Balibar, il n’est pas certain que schmittianisme et post-marxisme soient incapables d’avancer de concert vers la génération d’une action politique de gauche.
La construction européenne ou l’oubli de l’élément proprement « politique »
Il peut sembler inadapté, à première vue, de formuler l’hypothèse d’un rapprochement plausible entre la pensée politique de Carl Schmitt et les considérations théoriques actuelles autour de la construction européenne. Nicolas Sombart, qui a fréquenté le juriste déchu à Plettenberg, a réprouvé le fait que la plupart des lecteurs du publiciste découvraient, selon lui, « le faux Schmitt », à savoir le « concepteur de cette machine célibataire qu’est l’ « État »34 », alors que l’auteur du Nomos de la Terre avait surtout su diagnostiquer le déclin de la forme étatique moderne qui serait parvenue à son terme. Avec le passage à l’ère globale, les Européens devraient songer à remplacer l’État, vieilli et poussiéreux, « par des formes d’ « unité politique » substantielles, véritablement souveraines35. » Depuis une dizaine d’années, les études schmittiennes se sont élargies à la question d’un prolongement continental et européen de la notion du « politique ». Ce phénomène naissant, encore à l’état d’un décantage initial, fut impulsé, pour l’essentiel, par les recherches de Christoph Schönberger et d’Ulrich K. Preuss36. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le penseur conservateur s’était effectivement donné pour objectif de réfléchir sur l’avenir du Vieux Continent, désormais pris en étau entre les deux puissances dominantes. La « reconstruction » européenne, telle qu’il la voyait se dessiner, lui apparaissait comme une entreprise menée à l’encontre des Allemands vaincus et qui manquait, par ailleurs, de se pourvoir des attributs du politique. À la vue d’une Europe « kidnappée par des esclaves37 » et soumise au dictat des vainqueurs, Schmitt conçoit un équilibre mondial reposant sur l’instauration d’un pluriversum de « grands espaces ».
Après 1945, le juriste rhénan revoit sa théorie du Großraum qu’il avait mise, dans un premier temps, au service du régime nazi. Celle-ci prévoit la suppression des entités étatiques en tant que lieux de souveraineté et leur incorporation au sein d’un espace « aux limites indéterminées, ou plutôt flexibles38 », où chacun des peuples phagocytés disposerait de droits différentiels. Sous l’impulsion d’un « centre », du Reich allemand, un grand espace européen unifierait le Vieux Continent sur la base d’un critère d’appartenance christique (ou chrétien), constituant de fait une réponse appropriée au dépérissement progressif du concept d’État. Carl Schmitt n’a de cesse d’identifier l’Europe à la chrétienté ; cette dernière représenterait une solide alternative au bloc soviétique et au bloc libéral — marxisme et libéralisme étant tous deux la conséquence d’un noyau métaphysique athée et de croyances immanentistes. Se composerait, dès lors, un ordre mondial fondé sur la coexistence de plusieurs blocs autonomes — les grands espaces — qui permettrait ainsi un rééquilibrage des puissances. Tomas Kostelecky, en particulier, s’autorise à interpréter la notion de Großraum comme l’analyse intéressante d’un effacement tendanciel des frontières39. Schmitt aurait pressenti le déplacement progressif du lieu de la souveraineté depuis les entités étatiques vers un grand espace européen, préfigurant de ce fait l’avènement d’une construction d’échelle continentale.
L’élargissement des frontières géographiques s’accompagne, dans la théorie du penseur conservateur, d’une révision des limites « nationales » : la théorisation d’un Großraum passe inévitablement par une redéfinition du concept de nation. « Une Europe démocratique avait d’abord besoin d’un peuple européen homogène40 », ce que la croyance en Jésus-Christ était toute disposée à fournir. Schmitt estime qu’un pacifisme morne ne peut, en aucun cas, prodiguer les propriétés vertueuses du politique. Dans sa construction de l’après-guerre, l’Europe aurait omis de fonder le patriotisme européen sur l’identification d’un autre, d’un ennemi, de se fonder sur l’homogénéité du peuple chrétien à même d’édifier une forme authentiquement politique pour le continent. Le savant de Plettenberg bat en brèche l’idéal du refus de la puissance ; il souhaite faire de l’Allemagne le « pôle impérial » d’une nation chrétienne, refusant d’un même geste la sanction des triomphateurs et l’élaboration d’une formule politique « neutre ».
Les questions de l’État-nation — et des relations internationales —, de la souveraineté, de l’ordre juridique européen, soulevées par Schmitt à son époque, sont actuellement consubstantielles au problème de l’intégration européenne. C’est assez logiquement que les raisonnements de ce dernier paraissent susceptibles, au jour d’aujourd’hui, de trouver une utilité particulièrement éloquente dans le cadre des discussions théoriques relatives à l’idée d’Europe. Si les écrits du juriste permettent d’attaquer systématiquement les thèses « néo-cosmopolitiques » et de nourrir l’ensemble des discours « souverainistes », nous rejoignons Müller sur le fait qu’il est également tout à fait pensable que de tels textes puissent peser sur les réflexions des néo-kantiens et des libéraux, dans l’optique bien différente de solidifier le modèle cosmopolitique. Il semble que s’il souhaite prendre effet, le cosmopolitisme y gagnerait beaucoup à prendre en compte « la dialectique schmittienne de la souveraineté et de l’unité politique forgée à peine de vie et de mort41 », en vue d’envisager, en fin de compte, d’y échapper complètement. Müller formule, en filigrane, l’hypothèse suivante : probablement que ceux qui relèvent le défi de réfléchir à de nouvelles identités supranationales devront, d’une manière ou d’une autre, se mesurer aux philosophèmes de Carl Schmitt, afin d’imaginer les moyens nécessaires au dépassement de l’homogénéité et de l’hostilité42. Le penseur conservateur pourrait, semble-t-il, nous aider, a contrario, à penser (à renforcer ?) le domaine du métanational. Existerait-il une thématique plus actuelle en théorie politique ?
Conclusion
Yves Charles Zarka a tout récemment précisé la distinction qu’il avait opérée entre les œuvres et les documents, lorsque dans un article paru dans Le Monde au lendemain de la publication en français du Der Leviathan de Schmitt, il avait affirmé que les textes du juriste allemand appartenaient à la catégorie des documents43. Il écrit que « ce qui fait le caractère particulier du document est d’être inscrit dans un moment historique dont il est un témoignage, d’en être d’une certaine manière inséparable. En revanche, une œuvre nous interpelle au-delà de son temps, en dehors du contexte où elle a été écrite pour nous parler aussi bien de son temps que du nôtre. En ce sens, […] Schmitt est l’auteur de documents44. » Durant l’espace d’un demi-siècle, Carl Schmitt a exercé une influence sur l’ensemble du spectre politique, de l’extrême gauche italienne à la Nouvelle Droite française — et il continue de le faire de manière posthume. Il reste à espérer que la traduction en langue française de l’ouvrage de Jan-Werner Müller fera prendre conscience du poids et de l’importance qu’ont pu prendre les diagnostics et les anamnèses souvent judicieuses de l’adversaire le plus virulent du libéralisme — ce qui n’a jamais contraint ses lecteurs de partager les suggestions normatives qui corroborent l’analyse. S’obstiner à discréditer à tout prix la pensée du savant de Plettenberg au point de refuser que les écrits de ce dernier constituent une œuvre, au motif qu’entachés par le nazisme, ils n’auraient plus rien à nous dire d’actuel, est un tour de passe-passe plutôt difficile à réaliser.
Cette recension a fait l’objet d’une première publication dans Raison publique, 2014, n°8.
==================
NOTES
- L’expression est de George D. Schwab, « un chercheur de l’université de New York » qui, écrit Müller, fut « à l’origine de la redécouverte américaine de Schmitt » (Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 302).[↩]
- Nous paraphrasons ici la formule d’Étienne Balibar : « Carl Schmitt est le plus brillant et donc [nous soulignons] le plus dangereux des penseurs d’extrême droite » (BALIBAR, Étienne [entretien avec], « Internationalisme ou barbarie », propos recueillis par Michael Löwy et Razmig Keucheyan, SolidaritéS, n° 30, mercredi 2 juillet 2003, p. 22, texte disponible sur : http://www.solidarites.ch/index.php?action=4&id=1025&aut=80 ).[↩]
- Op. cit., p. 9.[↩]
- Cf. surtout VAN LAAK, Dirk, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens : Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin, Akademie Verlag. 1993.[↩]
- HABERMAS, Jürgen, « Le besoin d’une continuité allemande. Carl Schmitt dans l’histoire des idées politiques de la RFA », trad. par Rainer Rochlitz, Les Temps Modernes, n° 575, juin 1994, p. 31.[↩]
- Ibid., p. 32.[↩]
- Schmitt a développé sa compréhension de l’évolution du régime parlementaire dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (Parlementarisme et démocratie, trad. par Jean-Louis Schlegel et préface de Pasquale Pasquino, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1988).[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 369.[↩]
- RAYNAUD, Philippe, « Que faire de Carl Schmitt ? », Le Débat, n°131, septembre – octobre 2004, p. 165.[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 13.[↩]
- Ibid., p. 169. C’est nous qui soulignons.[↩]
- Ibid., p. 184.[↩]
- « L’intégrisme européen et l’essor de la (des) nouvelle(s) droite(s) européennes », in ibid., pp. 288-303.[↩]
- Claire-Lise Buis affirme, parmi d’autres, que « l’antilibéralisme est bien un élément fondamental de regroupement des fidèles schmittiens » (« Schmitt et les Allemands », Raisons politiques, n°5, février 2002, p. 151).[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 29.[↩]
- « Le Partisan dans le paysage de la trahison : la théorie de la guérilla de Schmitt — et ses partisans », in ibid., p. 204-219.[↩]
- « La critique du parlementarisme », in ibid., pp. 240-248.[↩]
- « Schmitt et la haine de classes : les Marxisti Schmittiani », in ibid., pp. 248-253.[↩]
- Cf. notamment AGAMBEN, Giorgio, État d’exception. Homo sacer, II, 1, trad. par Joël Gayraud, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2003 ; NEGRI, Antonio, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, trad. par Étienne Balibar et François Matheron, Paris, PUF, coll. « Pratiques théoriques », 1997.[↩]
- ZARKA, Yves Charles, « Carl Schmitt, après le nazisme », Cités, n°17, 2004, p. 148.[↩]
- MONOD, Jean-Claude, Penser l’ennemi, affronter l’exception. Réflexions critiques sur l’actualité de Carl Schmitt, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 2007, p. 21.[↩]
- « Les usages opposés de Schmitt : une longue histoire », in ibid., pp. 21-31.[↩]
- Ibid., p. 107.[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 302.[↩]
- Ibid., p. 310 ; pp. 321-322[↩]
- ZARKA, Yves Charles, Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, suivi de deux textes de Carl Schmitt traduits par Denis Trierweiler, Paris, PUF, coll. « Intervention philosophique », 2005, p. 92.[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 343.[↩]
- BALIBAR, Étienne (entretien avec), loc. cit., p. 22.[↩]
- Cf. BALIBAR, Étienne, « Violence et civilité. Sur les limites de l’anthropologie politique », in GÓMEZ-MULLER, Alfredo, La question de l’humain entre l’éthique et l’anthropologie, Paris, L’Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2004. Le texte est disponible sur : http://ciepfc.rhapsodyk.net/article.php3?id_article=83.[↩]
- « Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes », préface à : SCHMITT, Carl, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes, p. 8.[↩]
- BALIBAR, Étienne, « Prolégomènes à la souveraineté : la frontière, l’État, le peuple », Les Temps Modernes, n°610, septembre – octobre – novembre, 2000, p. 50.[↩]
- « Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes », préface à : SCHMITT, Carl, op. cit., p. 11. C’est l’auteur qui souligne.[↩]
- BALIBAR, Étienne (entretien avec), « Internationalisme ou barbarie », propos recueillis par Michael Löwy et Razmig Keucheyan, SolidaritéS, n° 30, mercredi 2 juillet 2003, p. 23.[↩]
- « Promenades avec Carl Schmitt », in SOMBART, Nicolaus, Chroniques d’une jeunesse berlinoise (1933-1943), trad. par Olivier Mannoni, Paris, Quai Voltaire, 1992, p. 324.[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 342.[↩]
- Cf. WAGNER, Helmut, « La Notion juridique de l’Union européenne : une vision allemande », trad. par Pascal Bonnard, Notes du Cerfa, n°30(a), février 2006, pp. 1-13. Le texte est disponible sur : http://www.ifri.org/files/Cerfa/Note_Wagner_MR.pdf .[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 203.[↩]
- KERVÉGAN, Jean-François, « Carl Schmitt et « l’unité du monde » », Les études philosophiques, n° 1, janvier 2004, p. 13.[↩]
- Cf. KOSTELECKY, Tomas, Aussenpolitik und Politikbegriff bei Carl Schmitt, München, Neubiberg-Institut für Staatwissenschaften, 1998.[↩]
- Carl Schmitt : Un esprit dangereux, p. 14. C’est nous qui soulignons.[↩]
- Ibid., p. 337.[↩]
- « Une ère post-héroïque ? Après la nation, l’État — et la mort politique », in ibid., pp. 336-338.[↩]
- ZARKA, Yves Charles, « Carl Schmitt, nazi philosophe ? », Le Monde, n° 17998, vendredi 6 décembre 2002, p. VIII.[↩]
- ZARKA, Yves Charles, « Carl Schmitt ou la triple trahison de Hobbes. Une histoire nazie de la philosophie politique ? », Droits – Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 45, 2007, p. 177.[↩]

Tristan Storme
Tristan Storme est maître de conférences en sciences politiques à Nantes Université.
