Brexit de gauche : aucune île n’est une île…
 Jess Hurd
Jess Hurd
Patrick Savidan a lu The left Case for Brexit (Polity Press, 2020) de Richard Tuck et questionne l’idée selon laquelle il n’y aurait d’avenir pour le progrès social qu’en dehors de l’Union européenne. Sur cet ouvrage, lire également l’analyse de Jean-Fabien Spitz, « Un Plaidoyer de gauche pour une sortie de l’Union européenne »
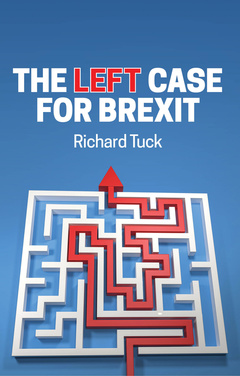
Le souverainisme et le nationalisme ont actuellement le vent en poupe. De nombreux événements politiques en témoignent. Songeons à la teneur des oppositions au traité visant à établir une constitution pour l’Europe et aux débats qui ont accompagné son rejet par voie référendaire en mai 2005 en France puis aux Pays-Bas le mois suivant, pensons également à l’élection de Donald Trump en novembre 2016 à la présidence des États-Unis, au vote en faveur du Brexit en juin 2016 ou au renforcement des partis d’extrême droite presque partout en Europe. Bon nombre d’analystes y ont vu, à l’instar de Jan-Werner Müller1 ou de Céline Spector2, les signes d’un populisme renouvelé pouvant emprunter indifféremment aux répertoires conceptuels des extrêmes de droite et de gauche. Nul n’ignore a priori que la pression économique exercée par la mondialisation et la concentration des richesses et du pouvoir politique qu’en ont tiré les élites des pays concernés n’y sont pas pour rien.
Richard Tuck, un historien britannique de la philosophie politique européenne, désormais en poste à Harvard (la mondialisation n’a donc pas que des défauts) nous donne, avec son livre The left Case for Brexit (Polity Press, 2017), l’occasion de nous intéresser à l’idée suivant laquelle cette évolution pourrait se révéler in fine avantageuse pour les plus défavorisés. Richard Tuck se présente ainsi comme un « lexiteer », soit un intellectuel de gauche défendant le Brexit au nom du progressisme. Il n’est pas seul à emprunter cette voie. Songeons à Alan Johnson et à son article de 2017, « Why Brexit is best for Britain : the left wing case »3, ou à Christopher Bickerton, un enseignant-chercheur au sein du département de sciences politiques et relations internationales à l’université de Cambridge au Royaume Uni (après avoir enseigné à l’université d’Amsterdam au Pays Bas et à Sciences Po Paris), qui défend un Brexit de gauche dans un article repris en 2019 dans Le Monde diplomatique4.
Il existe deux manières principales d’aborder ce débat. La première soutient que ces affirmations populistes ou souverainistes pourraient avoir une utilité stratégique. C’est par exemple la position qu’adopte Nancy Fraser lorsqu’elle en appelle à la constitution d’un bloc contre-hégémonique qui puisse, par la promotion d’un « populisme progressiste » (qu’elle distingue du populisme réactionnaire de Trump), combattre efficacement les politiques et gouvernements néolibéraux5. Mais il arrive aussi – et c’est la deuxième manière d’appréhender cette discussion – que l’on propose, plus radicalement, une défense de principe, non stratégique, du populisme de gauche. Dans un tel cas de figure, le Brexit n’est pas seulement une opportunité que la gauche pourrait (tenter de) mettre à profit, mais c’est une condition préalable, nécessaire, à toute politique progressiste. Le livre de Richard Tuck participe, et vigoureusement, de cette seconde perspective.
L’ouvrage réunit un ensemble de prises de positions forgées dans le contexte du débat pré- et post- référendum6. Rédigés au fil de l’actualité politique la plus brûlante et faits pour la nourrir, ces articles n’ont pas la rigueur académique dont l’historien fait montre dans ses travaux universitaires – tous les arguments ne sont pas toujours étayés ni pleinement documentés – mais ils ont les qualités que l’on attend d’interventions rédigées par un universitaire engagé, savant, probe, qui prend le risque de penser au plus près du politique, au fil des événements et des débats auxquels ceux-ci donnent lieu. L’entreprise retient de ce contexte la vivacité de ton propre à ce qui se présente d’abord comme une sorte de journal de pensée, et qui assume une démarche dont il faut bien reconnaître qu’elle est autrement plus épineuse que celle visant à étudier, par exemple, les origines et le développement des théorie du droit naturel7, à restituer la logique des philosophies du gouvernement entre 1572 et 16518, à présenter les usages possibles de la philosophie de Hobbes9 ou à montrer comment la distinction entre souveraineté et gouvernement éclaire l’histoire de la pensée de la démocratie10. Autant de domaines dans lesquels Richard Tuck a fait la démonstration de son très grand talent.
Il ne sera pas rendu justice, dans cette brève recension, à la richesse de l’ouvrage. Ici seront principalement envisagés les présupposés politiques et juridiques de la position générale défendue par son auteur, sur un mode qui, nous l’espérons, donnera au lecteur l’envie de se procurer l’ouvrage et de juger par lui-même.
La thèse de l’auteur dépend d’un constat : une politique authentiquement progressiste est impossible dans le cadre de l’Union Européenne en raison des normes néolibérales que celle-ci promeut, voire impose. Si ce constat peut valoir pour tous les Etats membres, on conçoit qu’il puisse être ressenti plus durement encore du point de vue d’une tradition politique et juridique britannique qui, n’admettant pas de différence de principe entre le droit constitutionnel et la production législative ordinaire, est conduite à porter un regard plus sévère et irrité à l’endroit de toute norme venant corseter, contraindre ou bloquer le pouvoir parlementaire. Or, pour Tuck, cette spécificité britannique doit être défendue. D’abord parce qu’elle permet, à travers les alternances, de garantir une véritable respiration politique. Une majorité parlementaire fraîchement élue peut ainsi tout à fait défaire tout ce qu’aura pu mettre en place la précédente : « Je ne pense pas qu’il y ait une magie propre à l’île de Grande-Bretagne, écrit-il. Je pense que l’omnicompétence du Parlement a en revanche engendré une culture des libertés civiles, qui tient au fait que personne n’a jamais eu à craindre, pour ses projets politiques, une défaite permanente ou quasi-permanente. » Ensuite, parce que cette organisation ne fixe a priori aucune limite politique. Reprenant sur ce point une position déjà défendue par Marx en 1872 dans un discours prononcé devant l’association internationale des travailleurs, Richard Tuck a beau jeu de rappeler que le socialisme n’est pas une impossibilité pratique mais une simple question de majorité parlementaire. Tuck en veut pour preuve la création du National Health Service :
Les premiers membres du parti travailliste en Angleterre (qui étaient plus marxistes que leurs successeurs ne voulaient l’admettre) l’avaient compris et estimaient qu’une classe ouvrière bien organisée, s’appuyant sur la représentation à la Chambre des communes, pouvait entraîner un changement économique et social radical. Et, si l’on compare ce qu’était la vie de la classe ouvrière au XIXe siècle à ce qu’est devenue celle de la classe ouvrière après le développement du parti travailliste, ils avaient raison de le penser. En effet, la création du National Health Service, qui est le plus grand accomplissement du parti travailliste, aurait été impossible dans un pays où le pouvoir législatif reste soumis à des contraintes constitutionnelles fortes. De fait, cette réforme nécessitait l’expropriation à grande échelle de la propriété privée sur laquelle reposaient les anciens hôpitaux.
L’objectif, dans une telle perspective, doit donc être double : redonner d’abord au parlement britannique la plénitude de ses pouvoirs, pour ainsi permettre au parti travailliste de mener, sans que l’Union européenne ne s’avise de s’en mêler, ses politiques progressistes — à charge pour lui bien sûr de conquérir la majorité. A ce compte-là, on comprend que Richard Tuck puisse vouloir libérer de l’Union Européenne le parlement britannique et le soustraire à tout contrôle de conformité par une autorité indépendante.
Le livre de Richard Tuck est souvent convaincant quand il s’attache à montrer le caractère néolibéral des orientations européennes, en insistant sur les conditions qui favorisent la liberté des marchés et exercent une contrainte sur l’intervention publique des États dans le domaine économique. Il ne l’est pas toujours cependant quand on considère les conclusions tirées de ces analyses. Cela apparaît clairement dès lors que l’on prend la thèse de Tuck au niveau de radicalité qui est le sien : l’historien ne se contente pas de critiquer l’orientation néolibérale de l’Union européenne, mais il développe, pour la Grande-Bretagne, une défense de la souveraineté populaire fondée sur une critique de l’Etat de droit, en faisant le pari que cela tournera in fine à l’avantage des plus défavorisés. Pour lui, avec l’entrée dans l’Union européenne,
La classe dirigeante britannique de la fin du XXe siècle a mis au rebut l’institution la plus précieuse dont elle avait hérité, une institution dont la conservation était l’impératif le plus évident pour leurs prédécesseurs : une Chambre des communes qui ne soit pas contrainte par une constitution. Un vote en faveur du maintien dans l’UE rendra irrévocable la mise à sac cavalière de cette institution, et mettra fin à tout espoir d’une politique véritablement de gauche au Royaume-Uni.
De cet argument, il faudrait donc pouvoir déduire a contrario que les Etats de droit ne peuvent pas être pleinement démocratiques et qu’ils ne peuvent pas non plus mener de politiques sociales ambitieuses. Cet argument, qui d’un point de vue théorique et abstrait n’est pas inintéressant, semble néanmoins assez problématique dès lors qu’on le confronte aux faits.
On peut tout d’abord se demander ce qui permet à Tuck de penser que, par principe, l’institution parlementaire britannique est plus démocratique que les parlements des Etats de droit. Le système électoral britannique n’a pas la réputation d’être particulièrement démocratique. Le mode de scrutin des élections générales repose sur un vote uninominal majoritaire à un tour, qui a certes l’avantage d’être simple et de produire des majorités claires, mais qui a aussi pour effet – puisque les électeurs et les électrices ne peuvent voter que sur un seul nom – de désigner un vainqueur qui, dans la plupart des cas, n’a pas obtenu la majorité des suffrages. Ce mode de scrutin, qui encourage le vote utile, peut envoyer à Westminster un MP avec un pourcentage de voix très faible – puisqu’il n’y a pas non plus de seuil minimal – et n’accorde qu’une très faible représentation à des partis importants mais faiblement implantés dans les circonscriptions.
On peut également se demander ce qui permet à Richard Tuck de penser que les Etats de droit sont moins capables qu’un parlement omnicompétent de réduire la pauvreté et de réduire les inégalités de niveaux de vie et d’opportunités. Les données dont on dispose auraient plutôt tendance à faire la démonstration du contraire. L’écart de salaire entre les hommes et les femmes au Royaume-Uni en 2017 était de 20,8% (seules l’Allemagne et la République Tchèque font pire), alors qu’il était de 15,4% en France, 14,7% au Danemark, 13,9% en Irlande, 12,6% en Suède, et de 16% en moyenne dans l’Union européenne11… Avec un seuil de pauvreté fixé à 50% du revenu médian, on constate que 11,3% de la population au Royaume-Uni vit en deçà du seuil de pauvreté, alors qu’en Irlande le taux est de 7,1%, 6,9% en Norvège, 6,8% au Danemark, 6,7% en France ou 5,4% en Finlande. Là encore on observe que le pourcentage de la population au Royaume-Uni vivant en-dessous du seuil de pauvreté est supérieur au taux moyen pour l’ensemble de l’Union Européenne12… On pourrait multiplier à l’envi ce type de constats, dont il ne faut pas s’étonner. De fait, les systèmes de protection sociale dans bon nombre des Etats de droit en Europe sont plus redistributeurs et protecteurs que le système social britannique. C’est aussi dans des pays de ce type que se trouve assurée la gratuité d’accès à des services publics auxquels Richard Tuck accorde légitimement une grande importance. Il y a donc manifestement d’importantes marges de manœuvre dont le Royaume-Uni ne fait pas usage sans qu’il soit légitime d’en imputer la responsabilité à l’Etat de droit ou à l’Union européenne.
Ajoutons que si Richard Tuck dénonce à juste titre les rigidités néolibérales européennes, on pourrait aussi faire remarquer que ces rigidités possèdent clairement une forme de plasticité, comme en témoignent la souplesse admise sur le plan budgétaire pour des pays confrontés à la pandémie de coronavirus ou les exemptions assez régulièrement accordées, par exemple récemment à l’Espagne et au Portugal, qui à la faveur d’une exemption dite « ibérique » ont obtenu, sans avoir besoin de désobéir, la possibilité de décrocher du système européen sur les tarifs de l’énergie afin de lutter plus efficacement, avec les moyens qui sont les leurs, contre l’inflation.
Comme chacun sait, les règles européennes ne sont pas des données naturelles, permanentes et surplombantes. Elles sont le fruit d’un certain état du rapport des forces à un moment donné de l’histoire politique de l’Union européenne et de ses États membres. Ce n’est pas faire offense au Royaume-Uni que de rappeler que ce pays, à la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, a joué, en recourant notamment à son droit de véto, un rôle tout à fait significatif dans ce devenir néolibéral des orientations européennes que les progressistes dénoncent à bon droit. Au fond n’y aurait-t-il pas là alors un risque pour Richard Tuck? Celui d’avoir eu raison sur un point : le Brexit pourrait bien, effectivement, favoriser la mise en œuvre de politiques socio-économiques plus progressistes ; mais tort sur un autre : avec le Brexit, ce changement a désormais plus de chances de s’opérer, non pas au Royaume-Uni cependant, mais bien dans les pays de l’Union européenne libérés de l’influence néolibérale britannique.
C’est une hypothèse que Richard Tuck ne semble pas vouloir examiner pleinement. Il revisite pourtant un dilemme progressiste, dont il n’ignore rien, qui interroge la réponse qu’il convient d’apporter à la formidable concentration et extension du pouvoir économique. Face à une telle évolution, les progressistes se sont en général divisés en deux camps principaux.
Pour les uns, il faut ramener le pouvoir économique à l’échelle du pouvoir politique afin que ce dernier puisse reprendre la main. Au début du XXe siècle aux États-Unis par exemple, Louis D. Brandeis, qui deviendra un juge influent de la Cour suprême des Etats-Unis, s’est ainsi opposé avec vigueur et constance aux monopoles et aux trusts, parce qu’il estimait que le « Big Business » sapait les fondements de la démocratie. Dans un tel contexte, il fallait selon lui, non pas nécessairement chercher à renforcer le pouvoir politique, mais bien plutôt veiller à disperser, décentraliser, le pouvoir économique13.
Dans le camp d’en face, on estimait que cette perspective était vouée à l’échec. Pour réaffirmer l’autorité démocratique, on soutenait alors à la même époque que l’on parviendrait mieux à rééquilibrer le rapport de forces en faisant en sorte que le pouvoir politique se hisse au niveau du pouvoir de l’économie. Dans la perspective de l’intellectuel et journaliste américain Herbert Croly, cela passait par le déploiement d’un « nouveau nationalisme » et le renforcement des prérogatives du gouvernement fédéral afin que celui-ci dispose des moyens de réguler effectivement l’économie14. Les termes du débat ont forcément beaucoup changé depuis le début du XXe siècle. Mais la question des modalités du rééquilibrage entre pouvoir économique et pouvoir politique demeure. Avec le Brexit, le parlement britannique a certes repris la main dans une certaine mesure. Son pouvoir d’action n’est-il pas cependant plus faible? On voit en tous les cas assez bien le bénéfice qu’en pourra tirer le « big business », moins bien la manière dont une majorité travailliste (si tant est qu’il y en est une) pourra en faire usage pour promouvoir une politique progressiste. « No man is an island » écrivait John Donne. Ajoutons : aucune île non plus, désormais.
==================
NOTES
- Qu’est-ce-que le populisme ? : Définir enfin la menace, Paris, Premier Parallèle, 2016, 200 p.[↩]
- Céline Spector, No demos ? Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2021, 415 p.[↩]
- https://www.nytimes.com/2017/03/28/opinion/why-brexit-is-best-for-britain-the-left-wing-case.html.[↩]
- https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/BICKERTON/59567[↩]
- Voir https://esprit.presse.fr/article/nancy-fraser/de-clinton-a-trump-et-au-dela-41672. Se demandant s’il existe une option contre-hégémonique viable, elle écrit notamment : l’option la « plus probable [correspond à] une forme ou une autre de populisme. Le populisme pourrait-il constituer une alternative possible – si ce n’est tout de suite, à moyen terme ? Entre les soutiens de Sanders et ceux de Trump, en effet, une part importante d’électeurs américains a rejeté la politique de redistribution néolibérale en 2015-2016. Peuvent-ils se retrouver dans un nouveau bloc hégémonique ? Pour cela, les soutiens ouvriers de Trump et de Sanders doivent réaliser qu’ils sont des alliés – tous victimes, différemment situées, d’une même économie pipée, qu’ils pourraient chercher à transformer ensemble. Le populisme réactionnaire, même sans Trump, n’est pas une base plausible pour une telle alliance. Sa politique de reconnaissance hiérarchique et exclusive ne manquera pas de décourager de larges segments des classes ouvrières et moyennes des États-Unis. Cela laisse le populisme progressiste comme le candidat le plus plausible pour un nouveau bloc contre-hégémonique. Associant redistribution égalitaire et reconnaissance non hiérarchique, cette alternative a une chance d’unifier l’ensemble de la classe ouvrière. »[↩]
- Un certain nombre de ses articles sont accessibles en ligne, par exemple sur le site de la revue Dissent : https://www.dissentmagazine.org/online_articles/left-case-brexit, sur celui de Policy Exchange : https://policyexchange.org.uk/pxevents/brexit-a-prize-in-reach-for-the-left/ ou encore sur celui de Briefings for Britain : https://www.briefingsforbritain.co.uk/a-brexit-proposal-by-christopher-bickerton-and-richard-tuck/.[↩]
- Natural Rights Theories: Their Origin and Development, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.[↩]
- Philosophy and Government 1572–1651, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.[↩]
- Hobbes: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 1989.[↩]
- The Sleeping Sovereign, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.[↩]
- https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaire-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe [↩]
- https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-en-Europe.[↩]
- Brandeis on Democracy, Philippa Strum (éd.), University Press of Kansas, 1995[↩]
- Herbert Croly, The Promise of American Life, New York: The MacMillan Company, 1909 ; voir Charles Forcey, The Crossroads of Liberalism Croly, Weyl, Lippmann, and the Progressive Era. 1900-1925, New York: Oxford university Press, 1961.[↩]

Patrick Savidan
Patrick Savidan est agrégé et docteur en philosophie, professeur en science politique au sein du département de droit public et de science politique de l'Université Paris-Panthéon-Assas et directeur éditorial des Editions Raison publique. Ses travaux portent principalement sur la démocratie et la justice sociale et s'attachent à éclairer les questions morales et civiques que soulève notre époque en les reliant aux enjeux classiques et contemporains de la philosophie politique.
Parmi ses derniers ouvrages: Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale (dir., Presses universitaires de France, 2018) ; Dire les inégalités. Représentations, figures, savoirs (dir. Avec R. Guidée, Presses universitaires de Rennes, 2017) ; Voulons-nous vraiment l’égalité ? (Editions Albin Michel, 2015); Repenser l'égalité des chances (Livre de poche [Grasset], 2010); Multiculturalisme (PUF, 2009).
