13-novembre, panser l’après : une question de genre

Que reste-t-il de la mémoire du 13 novembre 2015 ? Et comment se souvient-on, quelques mois après, de ces événements lorsqu’on les a suivis à plus de 300 kilomètres de la capitale ? Ces questions se posent-elles de la même manière selon qu’on est un homme ou une femme ? Dans La charge mémorielle. Une approche genrée de la mémoire du 13-Novembre (2025), Charlotte Lacoste, Maîtresse de conférences à l’Université de Lorraine, livre les premiers résultats d’une enquête scientifique nationale pour apporter des réponses aussi précises que nuancées à ces interrogations d’actualité.
A propos de Charlotte Lacoste, La charge mémorielle, une approche genrée de la mémoire du 13-Novembre, Paris, Hermann, coll. « Mémoire(s) », 2025.
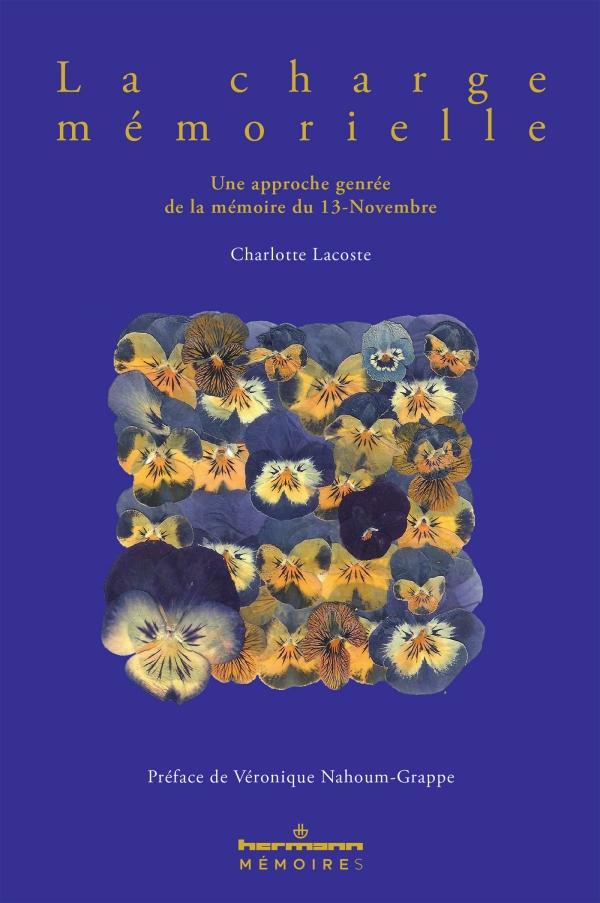
Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 131 morts et plus de 1700 blessés à Paris, quels souvenirs gardons-nous de cet événement hors-normes ? Au-delà de la mémoire publique, entretenue par les commémorations officielles en hommage aux victimes, peut-on parler d’un récit commun des attentats et de ses conséquences sociales ? Si ces questions ont été ravivées par le procès V13, elles sont également à l’origine du programme de recherche 13-Novembre. Porté par l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache depuis 2016, ce programme transdisciplinaire de grande envergure – réponse scientifique de la France aux attentats terroristes – s’inspire des recherches menées aux Etats-Unis sur la mémoire du 11 septembre, mais aussi des grandes collectes de témoignages relatifs à la Shoah, afin de comprendre comment s’élabore et évolue la mémoire individuelle et collective de ces événements. Menée par le CNRS en partenariat avec l’INA et l’ECPAD, l’Étude 1000 vise ainsi à recueillir, sous forme d’entretiens filmés et transcrits, les témoignages d’environ 1000 personnes à quatre reprises en 10 ans. Un tel projet mobilise un grand nombre de collaborateur·ices et requiert une pluralité d’expertises scientifiques. Spécialiste des pratiques et des écritures testimoniales au XXe siècle, Charlotte Lacoste, dont les travaux se distinguent par une attention constante à l’éthique[1], a d’entrée de jeu pris une part active à la conduite de l’Étude 1000. Enquêtrice et coordinatrice d’un travail de recherche collectif, elle a déjà co-signé des études remarquables, associant analyse du discours et textométrie, de manière à faire apparaître les caractéristiques linguistiques de la mémoire des attentats telle qu’elle s’élabore en 2016, suivant le groupe d’appartenance et le degré de proximité à l’événement[2]. La charge mémorielle, une approche genrée de la mémoire du 13-Novembre, publié en 2025 aux éditions Hermann dans la collection « Mémoire(s) » dirigée par Denis Peschanski, s’inscrit clairement dans la continuité de ces premiers travaux.
Si cet essai s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable des études sur la mémoire du 13 novembre et, plus largement, des recherches sur le témoignage, cela ne tient pas seulement à sa grande rigueur méthodologique (protocole scientifique des entretiens, approche statistique et analyse qualitative) ou à l’appréciable clarté de l’expression. La force du livre procède du développement vigoureux de son hypothèse de départ : la mémoire des violences historiques diffère, selon qu’on est un homme ou une femme. Loin de former un tout homogène, les souvenirs se distinguent par leurs contenus et par leur portage : la « charge mémorielle » revient aux femmes ; elle s’ajoute à leur « charge mentale » quotidienne. Forgé par la sociologue Monique Haicault dans les années 1970, le concept de « charge mentale » vient outiller la réflexion de Charlotte Lacoste qui lui donne un prolongement aussi inédit que convaincant. Née de l’observation empirique des entretiens conduits à Metz en 2016 auprès de 79 volontaires géographiquement éloignés de la capitale, l’hypothèse de travail est soutenue par l’analyse linguistique des transcriptions et confirmée par les outils statistiques. Elle est aussi avancée avec prudence, constamment étayée par une approche transdisciplinaire (anthropologie, histoire, sociologie, littérature, études de genre). Les recherches menées par Charlotte Lacoste visent à explorer et mettre en lumière ces différences encore largement passées sous silence dans les études de la mémoire, comme en témoigne le questionnaire gender blind proposé aux volontaires de l’Étude 1000. Ouvrant un dialogue avec les gendered memories, domaine de recherche constitué depuis une vingtaine d’années dans les mondes anglophones et latino-américains, La charge mémorielle vient combler une lacune scientifique dans le champ des études mémorielles menées en France. Inversement, l’analyse du discours permet aux travaux sur les mémoires genrées de gagner en précision. Adossée à une bibliographie substantielle, la démonstration progresse à partir de postulats empruntés à la sociologie – la « mémoire collective » selon Maurice Halbwachs – et à l’ethnologie – les « émotions mémorielles » selon Daniel Fabre – pour interroger, sous l’angle du genre, les réactions et les investissements imaginaires suscités par les attaques terroristes. Soucieuse d’objectiver ces différences, sans jamais perdre de vue le contexte spécifique des attentats et de ces entretiens menés dans un cadre imposant, qui a pu renforcer les effets de genre, la chercheuse défend avec fermeté la nécessité de « débusquer les normes puissantes qui sont (encore) à l’œuvre et travaillent, jusque dans le domaine de la mémoire, à différencier nettement (“tyranniquement”, dirait Marie Duru-Bellat) deux catégories de genre » (p. 180). Loin d’entériner les différences de genre, ce qui conduirait à un figement voire à une essentialisation, La charge mémorielle s’attache au contraire à rendre visible l’inégal partage des tâches mémorielles – veiller, pleurer, garder la mémoire – de manière à avancer plus lucidement sur le terrain de l’égalité. Entamée au moment où la quatrième vague féministe invite à un changement de regard sur l’ensemble des pratiques sociales, la rédaction du livre porte la trace d’un souci de rendre son prix au travail invisible des femmes. La charge mémorielle s’emploie ainsi à revaloriser, dans la perspective ouverte par la philosophie et l’éthique du care (Joan Tronto, Carol Gilligan, Sandra Laugier, Fabienne Brugère, Manon Garcia), l’ensemble des pensées, des gestes et des pratiques que les femmes interrogées se montrent si enclines à dévaloriser, signalant malgré elles la dévaluation du rôle social qui leur est pourtant assigné.
Le livre de Charlotte Lacoste offre une expérience de lecture particulièrement stimulante, qui prendra assurément une résonance particulière selon le degré de proximité du lecteur ou de la lectrice aux attentats parisiens d’une part, selon son identité de genre (homme, femme, non-binaire) de l’autre. Est-ce parce que je vivais dans le XIe arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres du Bataclan, au moment des attaques terroristes ? Est-ce parce j’ai traversé cette nuit du 13 novembre, les jours et les mois qui ont suivi, dans une peine sans nom ? Ou est-ce parce que je suis enseignante-chercheuse (comme un certain nombre de volontaires) particulièrement sensible aux questions féministes ? Ces diverses raisons expliquent sans doute, à des degrés divers, la tension particulière qui a accompagné la lecture de l’enquête messine. Au fil des pages, j’ai eu le sentiment d’osciller entre la reconnaissance – les citations des entretiens, toujours escortées d’analyses et d’interprétations fines, ont suscité une reconnaissance intime, une prise de conscience renouvelée – et l’étonnement – surprise de constater que des femmes ont « encaissé » le choc de manière aussi vive alors qu’elles habitaient loin de la capitale ; que le décalage entre les hommes et les femmes issus d’un milieu social relativement homogène (classes moyennes, classes moyennes supérieures) soit aussi saisissant. Les régularités remarquables et spécifiantes identifiées dans les discours des un·e·s et des autres m’ont paru confirmer – sans que je sache pour autant le verbaliser – ce que le temps et l’expérience m’ont personnellement appris (apprennent aux femmes ?). Et pourtant, dans ce contexte des attentats, ces façons de marquer la différence ne finissent pas de surprendre, de révolter (parfois), et surtout d’aiguiser le besoin de comprendre la variation des processus de mémorialisation. C’est que cet inégal partage de la charge mémorielle transcende les générations et s’inscrit dans une histoire longue des pratiques et des usages de la mémoire, que Charlotte Lacoste documente en prenant notamment appui sur les études anthropologiques ou ethnocritiques d’Yvonne Verdier, d’Arnold Van Gennep, de Françoise Zonabend, de Marie Scarpa, de Sylvie Mougin ou de Véronique Nahou-Grappe, qui préface le livre.
Particulièrement efficace, la progression de l’essai accentue au fil de ses cinq chapitres ces différences en alternant lecture détaillée des entretiens et mises en perspective des processus de socialisation des filles et des garçons sur le temps long de l’anthropologie sociale et culturelle. De prime abord, rien ne vient marquer nettement la distinction entre hommes et femmes invités à se rendre dans un studio d’enregistrement installé au sein d’un laboratoire de recherche de l’Université de Lorraine pour raconter « leur » 13 novembre, en 2016, quelques mois après les attentats. Le premier chapitre met l’accent sur les points communs entre les 79 récits collectés à cette période. Un récit apparemment uniforme semble se dégager des entretiens messins. Parce qu’elles partagent un sentiment d’illégitimité à parler d’attentats dont elles n’ont pas été les témoins directs, parce que leur discours présente des dissonances cognitives identiques (fascination et répulsion à l’endroit des médias ; sentiment d’impuissance et sensation de soulagement de ne pas avoir été atteint ; besoin de comprendre et refus de s’en tenir à une explication ; mémorabilité et insignifiance de l’événement), les personnes interrogées semblent faire état de réactions et de peurs similaires quelques mois après les attentats. Pourtant, dès le deuxième chapitre, l’analyse fait voler en éclats cette idée d’un récit partagé : l’approche contrastive des entretiens permet de faire ressortir nettement des différences dans les manières de vivre l’événement. Alors que les femmes du panel s’autorisent à dire ouvertement le choc provoqué par la catastrophe (réactions physiques et morales), les hommes usent de stratégies d’évitement (euphémisation, dépersonnalisation du propos) destinées à évacuer le sujet du discours et à donner une image d’impassibilité et de self-control face aux événements. Charlotte Lacoste excelle dans l’analyse patiente et scrupuleuse de ces « cabrioles syntaxiques » masculines, révélatrices d’une gêne, d’une pudeur, d’une indifférence ou d’un phénomène d’autocensure. Moins diserts que les femmes interrogées, les hommes témoignent d’un rapport plus malaisé au flux médiatique, insistant sur un phénomène de déréalisation de la catastrophe dont les images surviennent brusquement au cours d’une partie de jeu vidéo ou du match de foot du Stade de France. Diverge aussi la résonance des attentats dans la vie de chacun·e. Les participants entendent s’exprimer en citoyens éclairés : ils revendiquent une forme de recul ; montent en généralité ; improvisent des exposés d’histoire ou de géopolitique pour dire les conséquences nationales du 13 novembre. A contrario, les femmes du panel évoquent d’abord la puissance de déflagration de cet « événement monstre » (Pierre Nora) sur leur vie et celles de leurs proches. Affichant plus d’incertitudes que les hommes en matière de savoir – alors même qu’elles ne cessent de se documenter –, elles sollicitent leur mémoire autobiographique. Précise, inquiète, cette mémoire est au travail : les femmes interrogées cherchent et creusent dans le détail sans se donner pour finalité la composition d’un discours surplombant. De ces analyses des réactions socialement normées ressort l’hypothèse d’une forme d’aliénation masculine : l’expression de l’émotion est proscrite si bien que les hommes interrogés se trouvent en marge de l’émotion « collective » qui traverse la société française, alors même que les femmes y prennent une part active. Les trois chapitres qui suivent dressent une typologie des fonctions endossées par ces porteuses de souvenirs au lendemain des attentats. Charlotte Lacoste distingue ainsi les veilleuses, les pleureuses et les gardeuses de mémoire.
Se mettre en faction, parer à la catastrophe, prendre la foudre pour l’épargner aux autres, suivant la « fonction paratonnerre » identifiée par Yvonne Verdier dans son étude sur les femmes d’un village bourguignon dans les années 1970 : telles sont les charges assumées par les femmes placées en première ligne au moment où tombe la nouvelle. Ce sont elles qui vont apprendre et transmettre l’information, se documenter et aller aux renseignements auprès des proches, tandis que les hommes du panel manifestent sinon de l’indifférence, du moins peu de préoccupation à l’endroit de leur entourage après avoir pris connaissance des attaques. Alors même qu’elles ne cessent de disqualifier leur obsession du déchiffrement des signes et leur attitude d’hypervigilance, les femmes consacrent un temps important à anticiper la suite pour leurs proches, qu’ils soient exposés à une situation périlleuse dans la région parisienne, ou qu’ils soient mis en position d’écouter à l’école le récit possiblement choquant des attentats. Passionnantes, les pages consacrées à la mantique, au déchiffrement des signes et à la scrutation des informations montrent combien ce rôle ancien de vigie assurant les échanges entre l’espace domestique et le dehors trouve à se renouveler dans une société hyperconnectée. Au-delà de cette veille documentaire et familiale, les participantes déclarent aussi avoir veillé les morts à leur manière. Bien qu’aucune n’ait été proche des victimes du 13 novembre, toutes les femmes du panel ont manifesté un souci des défunts – souci ravivé par la mort d’un couple de jeunes messins au Bataclan –, donnant des signes de deuil, dont les pleurs sont la manifestation la plus tangible. Dans le beau chapitre consacré à ces « pleureuses », Charlotte Lacoste détaille ces rites de passage auxquels se sont livrées intuitivement ces femmes pour « faire passer » ce que les anthropologues qualifient de « mauvais morts » pour désigner « celles et ceux dont la mort a été à la fois solitaire, soudaine, prématurée, violente, injuste, inhumaine et déritualisée » (p. 125). À cette liste, la chercheuse ajoute l’adjectif « préméditée » pour replacer ces intolérables disparitions dans le contexte des attentats. Or, alors que les hommes du panel considèrent le deuil comme une affaire privée et comme une parenthèse qu’il faudrait pouvoir refermer assez vite, les femmes l’envisagent, dans un tel moment, comme l’affaire de tous et de toutes. S’interrogeant sur les formes et les règles du deuil (commémorations publiques, recueillement dans la sphère privée), elles disent la nécessité d’accompagner dignement les morts, de leur accorder du temps et de l’attention pour préparer la mémoire d’après. Bricolés en marge du quotidien, ces rituels révèlent l’importance des actes des vivants à l’égard des morts, sur lesquels Vinciane Despret a attiré l’attention[3]. S’appuyant sur l’enquête de la philosophe, Charlotte Lacoste montre à quel point ces tâches mémorielles – et la hantise qui l’accompagne dans certains cas – s’avèrent genrées lorsqu’elles concernent des violences historiques.
Au moment de la collecte des entretiens, le temps du deuil semble encore ouvert pour les participantes. Pour autant, le refus de fermer la parenthèse ouverte par l’événement ne doit pas être confondu avec une conception figée du culte des morts. En témoigne le choix lexical opéré par la chercheuse pour qualifier l’attitude des femmes du panel vis-à-vis des souvenirs. Charlotte Lacoste privilégie la réactualisation du mot ancien de « gardeuse » contre l’emploi de son austère et solennel concurrent « gardienne ». Il s’agit moins de protéger la mémoire contre les ingérences extérieures que de veiller avec bienveillance sur les souvenirs, de les retenir « pour qu’ils ne s’égaillent pas » (p. 154). Cette image n’est pas seulement plaisante : elle est révélatrice d’une attention constante de l’enquêtrice et autrice aux tâches invisibilisées du care (garde d’enfants, garde des bêtes dans l’enclos) qui passent sous les radars des institutions. Gardeuses et non gardiennes, car les femmes du panel se montrent en alerte et en mouvement. Certes, elles s’engagent à porter le poids de la mémoire des morts ; elles stockent les souvenirs dans leur tête, dans leurs corps. Mais elles s’avisent aussi de les déposer dans des endroits où ils pourront bénéficier à l’avenir des vivants – c’est la raison pour laquelle elles se sont portées volontaires pour les entretiens du Programme 13-Novembre. Plus encore, les attentats les ont conduites à multiplier les initiatives, à transformer le souvenir en autre chose, en « petites choses » – expression qui n’échappe pas à leur entreprise d’autodénigrement alors que ces gestes sont autant de manières de tisser du lien social. Ce sont ces actions créatrices et ces dons multiples (argent, objets, temps, savoir, affection, paroles…) qui permettent de panser le corps social meurtri.
Une telle recherche appelle bien des prolongements : l’on aimerait par exemple savoir si ces différences de genre persistent au fil des années et se retrouvent au même degré dans les différents cercles de participant·e·s à l’Étude 1000. En attendant ces compléments d’enquête, il faut saluer la démarche initiée par Charlotte Lacoste dans le cadre du Programme 13-Novembre : scruter une somme d’entretiens – paroles ordinaires attachées à dire les répercussions d’un événement hors normes – à partir de multiples approches disciplinaires fait assurément tout le prix de son essai. Alors que des chercheuses s’attachent depuis plusieurs années à définir les enjeux éthiques des recueils de voix[4], à préciser l’archéologie et les modalités de cet « art de l’écoute[5] » caractéristique d’une part importante de la production littéraire contemporaine, Charlotte Lacoste nous invite à partager une véritable science de l’écoute des voix minorisées. Pensé en partie comme une réponse à des discours auxquels l’enquêtrice a su prêter une oreille attentive, La charge mémorielle est aussi un livre qui interpelle : gageons que son appel sera largement entendu.
Je renvoie notamment à son essai Séductions du bourreau. Négation des victimes, Paris, PUF, coll. « Intervention philosophique », 2010. ↑
Charlotte Lacoste, Bénédicte Pincemin, Serge Heiden, Denis Peschanski, Carine Klein-Peschanski et Francis Eustache, « Les mots du 13-Novembre », Questions de communication, n°45, 2024, 07 octobre 2024 a, p. 221-244 ; « Les mots du 13-Novembre (2). La mémoire collective à l’épreuve de la textométrie », Questions de communication, n° 46, 2024 b, p. 277-298 ↑
Vinciane Despret, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, 2015. ↑
Mathilde Zbaeren, Paroles tenues. Recueil de voix et dette littéraire dans la littérature française contemporaine (1993-2023), thèse de doctorat, Université de Lausanne, novembre 2023. Voir également les actes du colloque « Livres de voix. Narrations pluralistes et démocratie » (Alexandre Gefen et Frédérique Leichter-Flack dir.), Colloques Fabula, 2022, DOI : https://doi.org/10.58282/colloques.8057 ↑
Maud Lecacheur, Une littérature de l’écoute. Collectes de voix de Georges Perec à Olivia Rosenthal, Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2024, p. 89. ↑

Aurélie Adler
Aurélie Adlerest Maîtresse de conférences en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’Université de Picardie Jules Verne, directrice de l’équipe « Roman & Romanesque » du laboratoire du CERCLL. Auteure d’Eclats des vies muettes. Figures du minuscule et du marginal dans les récits de vie de Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Annie Ernaux et François Bon (Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012), elle poursuit ses recherches sur les liens entre littérature, éthique et politique dans le domaine de la fiction et de la non-fiction au tournant du XXIe siècle. Outre des travaux consacrés aux renouvellements des écritures engagées (Ernaux, Bertina), elle s’intéresse actuellement à la choralité dans le roman contemporain d’expression française.
