La réception des débats allemands sur le capitalisme en France au tournant 1900

Pour Ludovic Frobert (ENS Lyon), l’étude des travaux de Élie Halévy (1870-1937), Charles Rist (1874-1955) et François Simiand (1873-1935) permet de compléter, sur le versant économique, l’analyse du « moment républicain » français au tournant du 1900. Elle permet en outre de comprendre quelques raideurs républicaines caractéristiques, que celles-ci concernent la prise en compte de l‘hétéronomie et de la conflictualité ou le traitement des questions économiques et sociales.
Les débats allemands fin de siècle sur l’essor du capitalisme demeurent associés à l’image wébérienne de la « cage d’acier »1 : l’affirmation d’un monde utilitaire et commercial fondé sur le calcul et la rationalité individuelle, loin de constituer un progrès en termes d’émancipation, sapait inexorablement les valeurs anciennes d’une culture basée sur la solidarité et le sens authentique des affaires humaines. Le contexte intellectuel français de réception du capitalisme est bien différent. Ici, autour de 1900, le phénomène est passé au crible des valeurs rationalistes et laïques affichées par le nouveau régime. Vincent Descombes, dessinant en quelques traits ce paysage a pu écrire que les principaux intellectuels « progressistes »2 s’accordaient alors sur l’idée que « l’humanité, depuis ses origines, n’a cessé de progresser vers un accord mutuel de tous les êtres humains sur des principes raisonnables : principes qui, justement, sont ceux des institutions républicaines »3. Si ce programme rencontre alors un terrain d’application privilégié dans le cadre de la lutte contre l’Église, les choses sont plus complexes sur le terrain économique et social. Là, une véritable enquête est nécessaire, et les investigations, tant empiriques que théoriques, doivent être multipliées pour vérifier de quelle manière l’essor économique moderne doit être articulé aux valeurs de la République. C’est dans ce contexte que nombre de jeunes économistes, sociologues, philosophes français se tournent vers les débats sur le capitalisme qui depuis plusieurs décennies font rage dans les pays de langue allemande. 1870 a inauguré une véritable crise allemande de la pensée française4. Cette crise a parfois pris la forme d’une obsession, mais certaines réactions furent plus calculées. Dans les sciences sociales naissantes, mais aussi en philosophie, le pari fut plutôt d’observer et analyser les atouts allemands ; son université, créditée d’une large part de la victoire de 1870 ; mais aussi les solutions progressistes que ce régime pourtant impérial et autoritaire avait apporté à la question sociale alors même que, paradoxalement, la France républicaine et démocrate n’en était encore sur ce point qu’aux balbutiements.
Nés tous trois au lendemain de la défaite de Sedan, Élie Halévy (1870-1937), Charles Rist (1874-1955) et François Simiand (1873-1935) appartiennent à une même génération qui demeure centrale dans l’histoire de la vie politique française5 ; c’est la « génération des hommes de quarante ans » qu’évoquera Charles Péguy dans Notre jeunesse ; une génération qui, notamment, a eu vingt ans au moment de l’Affaire Dreyfus. Les trois hommes sont, au tournant 1900, de jeunes intellectuels républicains, dreyfusards, proches du socialisme ou sensibles à nombre de ses arguments. Un autre trait les spécifie : d’abord engagés dans des études de droit ou de philosophie, ils se sont, par conviction politique, orientés rapidement vers l’étude de l’économie qui leur paraissait la discipline la mieux armée pour aborder certains des problèmes les plus neufs et les plus cruciaux de leur temps. Tous trois sont des observateurs attentifs et parfois acteurs du premier mouvement de réforme qui a conduit à expérimenter en France autour de 1900 les toutes premières avancées sociales sur les terrains des assurances sociales, des retraites, des accidents de travail, du droit d’association.
Ce choix en faveur de l’économie politique les a engagés aussi, au plus tôt, à lire et méditer les économistes de langue allemande qui les ont influencés au moment où ils allaient rédiger leurs premiers travaux d’envergure. Au sein des courants de langue allemande chacun des trois jeunes intellectuels va nouer une alliance spécifique. Les trois correspondants « allemands » privilégiés d’Halévy, Simiand et Rist seront alors respectivement Karl Marx, Gustav Schmoller et Anton Menger. Nous étudierons d’abord successivement ces trois réceptions. Puis nous soulignerons que, de ce détour, productif, Halévy, Simiand et Rist vont ramener plusieurs acquis communs : une culture économique solide qui contrastera avec les généralités philosophiques habituellement en vigueur dans le contexte français ; un dialogue renoué avec la notion pré-marxiste de société industrielle ; une conception moderne de cette notion de société industrielle, faisant désormais également part au consensus et aux conflits.
Halévy lecteur de Marx
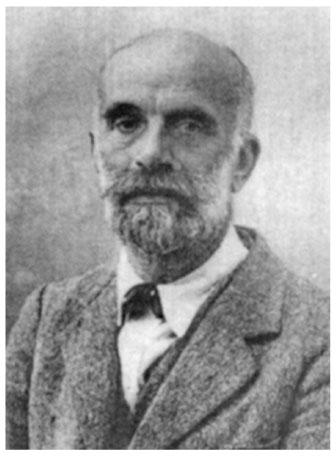
Élie Halévy (1870-1937) est souvent présenté comme un philosophe-historien. De fait, il était philosophe de formation, et l’un des principaux représentants, avec Xavier Léon ou Léon Brunschvicg d’un jeune mouvement intellectuel sensible aux lacunes et silences du formalisme kantien adopté par ses aînés républicains, notamment Charles Renouvier ; un mouvement qui allait créer très tôt, en 1893, son organe de combat, la Revue de métaphysique et de morale. Mais rapidement sensible aux limites de la philosophie pure (qu’il avait pratiqué dans un premier grand travail sur la dialectique platonicienne) Halévy s’oriente progressivement vers l’histoire. Il est surtout connu en tant qu’historien de l’Angleterre moderne, pays du parlementarisme et du capitalisme. Ses grands ouvrages, antérieurs à la Grande Guerre, sont bien connus : La Formation du radicalisme philosophique (3 volumes publiés entre 1901 et 1904) et L’Angleterre en 1815, premier volume, publié en 1912, de sa monumentale Histoire du peuple anglais au 19e siècle. Des anglais et de leur histoire, Halévy va toujours retenir une sorte de miracle : il en formulera les termes de différentes façons, mais sans doute au plus près en 1936 : « le peuple anglais est vraiment un peuple hégélien, qui possède l’art, dans sa vie sociale et politique, d’identifier les contradictions »6. Cette orientation de sa curiosité intellectuelle – l’attention aux contradictions et à la capacité de certaines collectivités d’en exploiter les paradoxales virtualités – permet de comprendre la lecture qu’il propose des auteurs de langue allemande. Son point de vue est exposé dans ses leçons sur l’histoire du socialisme européen, leçons qu’il inaugure en 1902 à l’École Libre des Sciences Politiques. Dans ce cours, Halévy évoque les différentes traditions autrichiennes et allemandes. Carl Menger et le marginalisme autrichien renouent selon lui avec une tradition spontanéiste initiée par Adam Smith. Cette tradition vaut donc plus pour ses options méthodologiques (l’individualisme) que pour ses résultats théoriques (une conception naturaliste du monde économique centrée sur l’échange). Halévy mentionne également l’École historique allemande mais pour souligner là encore que, utile par sa critique des excès méthodologiques de l’économie ricardienne, utile également par les informations historiques qu’elle a accumulées, cette École ne propose pas d’alternative théorique sérieuse à l’« économie politique déductive », échouant notamment sur le chapitre central de l’analyse de l’évolution économique moderne.
L’interlocuteur allemand d’Halévy est alors Marx. En novembre 1901, le jeune intellectuel écrivait à son ami Célestin Bouglé : « Ni Schmoller, ni Wagner, ni tous les professeurs, ni tous les éclectiques ne m’intéressent. J’appartiens tout entier à Karl Marx (…). Le marxisme sera le pivot de mon cours cet hiver ». Le marxisme vaut par la synthèse qu’il opère entre différentes traditions allant dans le sens d’un gouvernement commun de la sphère économique. Selon Halévy, deux chapitres de l’œuvre de Marx méritent d’être soigneusement distingués. Le premier chapitre concerne la théorie de la valeur-travail. À ses yeux, ce chapitre affaiblit considérablement le marxisme dans la mesure où cette théorie de la valeur est infirmée par les avancées récentes du marginalisme, et que d’autre part, l’adoption de cette théorie signale la contamination du marxisme par une anthropologie de la peine héritée des économistes ricardiens. C’est donc le chapitre hégélien du marxisme qui en fait la valeur. Marx retient de Hegel l’idée de contradiction comme condition du progrès. Mais il s’en sépare en mettant l’homme et non Dieu à l’origine du progrès et en insistant sur le rôle des contradictions économiques : « ces contradictions, souligne Halévy, présentent un caractère concret, réel, économique ; ce sont des conflits d’intérêts, individuels ou de classe, c’est-à-dire, des luttes historiques entre des individus ou des groupes d’individus »7. De cette interprétation de l’histoire, Marx tire l’enseignement d’une concentration capitaliste croissante ne pouvant que déboucher sur une crise terminale et l’installation d’un régime économique et social radicalement distinct. Halévy se désolidarise naturellement de ces deux conclusions et de l’orientation déterministe qu’elles signalent. Ce qui lui importe en revanche ce sont deux enseignements centraux du marxisme de Marx :
- Le matérialisme historique qui permet de souligner que les liens sociaux et politiques modernes – par contraste avec ceux des sociétés militaires et religieuses – résultent de manière grandissante des pratiques économiques ;
- L’analyse de la conflictualité économique. Le secret de ce lien nouveau est une forme originale de conflictualité. Marx, en effet, à la différence par exemple de Proudhon qui « méconnaît la nécessité, la fécondité des contradictions, des conflits, du mal et du coup […] méconnaît la condition du progrès »8, insiste sur le conflit économique et en détaille le versant positif.
Dans ses travaux ultérieurs, Halévy mobilise, après l’avoir retravaillé, ce canevas marxiste. On en trouve l’illustration dans son « grand œuvre » économique, texte pourtant méconnu, l’article « Les principes de la distribution des richesses » (1906). Halévy souligne dans ce texte la présence depuis un siècle de deux traditions rivales d’interprétation du capitalisme moderne. La première consiste à l’analyser comme un système de marché ; l’option ici revient « à considérer la relation d’échange comme le type de toutes les relations économiques, celle à laquelle il est ou désirable, ou possible, que toutes se laissent ramener, si l’on veut en avoir l’explication9 ». Initiée par les Classiques, représentée dans le présent par les marginalistes, cette tradition trouve pourtant, selon Halévy, sa première véritable maturité chez les saint-simoniens. Ces derniers négligeant la thèse des conséquences inattendues des actions individuelles estiment que le marché, encadré par tout un ensemble d’institutions, loin d’être une réalité naturelle est une convention révélatrice de certains choix sociaux en matière de production et de distribution des richesses. Ces choix manifestent la légitimation de la force et de la performance comme critères d’organisation sociale. C’est ici, en quelque sorte, un « droit de la force » qui est adopté et la nouvelle société économique estime cette option réalisée lorsque le système de marché précisément réglé permet une distribution des richesses strictement proportionnelle à la contribution de chacun. Halévy écrit ici : « L’échange est un mode artificiel de distribution des richesses, voulu ou consenti par la majorité des membres de la société où il fonctionne ; et le conflit des forces économiques serait parfaitement réglé, selon les lois de l’échange, lorsque chacun se trouverait rémunéré selon son travail10 ».
À cette tradition d’analyse s’est constamment opposée une autre lecture, celle de « l’association des producteurs », estimant que le capitalisme moderne porte en lui la virtualité d’une « société d’individus qui se considèrent comme les copropriétaires d’un capital social ». Dans cet environnement, le choix présidant à la distribution s’opère selon une toute autre logique : « À chacun ce dont il croit avoir besoin, écrit Halévy, et ce dont les autres croient qu’il a besoin dans l’accomplissement de sa fonction11 ». Ici, les derniers déterminants relevant d’une contrainte « objective » léguée par la nature (le travail, la force, la contribution) disparaissent et la distribution n’obéit plus qu’à une autre forme de rationalité, entièrement sociale. Dans ces conditions, c’est alors la fabrique d’une opinion raisonnable qui s’impose comme une priorité, cette logique de choix social devant rapidement aboutir à l’évidence de l’égalité des besoins de chacun.
Halévy estime que son interprétation synthétique des deux traditions rivales permet de souligner leur enseignement commun. Que l’on parte du marché comme convention ou de l’association des producteurs, on aboutit à une logique de contrôle social. En fait, le système moderne repose sur la tension créatrice12 entre les exigences décrites par les partisans du marché, la performance, l’innovation, le dépassement, et celles décrites par les partisans de l’association, le partage, l’équité, la solidarité ; c’est la gestion de plus en plus raisonnable de cette tension qui constitue l’enjeu de l’avenir. Un enjeu déjà en partie intégré dans le présent, Halévy attirant l’attention dans les dernières lignes de son papier sur les « germes » du « monde industriel en devenir », « les syndicats, les coopératives, les entreprises industrielles administrées par l’État et les municipalités13 ». Le principal enseignement du système économique moderne est donc là, dans l’établissement d’un régime original de conflictualité générant des institutions et des pratiques neuves permettant au final de tisser continûment les principaux liens politiques. Récupérant en partie l’enseignement saint-simonien distinguant logique guerrière et prédatrice d’une part, logique industrielle et constructive, d’autre part, Halévy souligne la positivité d’une évolution conduisant l’activité industrielle au premier rang14. Mais c’est à Marx qu’il doit sans doute l’idée que le secret de cette positivité réside surtout dans la forme singulière et ambivalente de conflits qui s’y développent.
Simiand lecteur de Schmoller

Membre incontournable de la première équipe de L’Année sociologique (première parution en 1896), François Simiand (1873-1935) est considéré comme le fondateur de la sociologie économique en France à l’extrême fin du dix-neuvième siècle, mais aussi ultérieurement comme l’une des sources intellectuelles majeures de l’École des Annales que vont créer Lucien Febvre et Marc Bloch en 1929. Entre 1896 et 1914, son activité est essentiellement polémique et concerne la situation et la méthode de la Science Sociale généraliste. Défenseur des principes méthodologiques durkheimiens, Simiand dénonce les sociologies concurrentes, critique les historiens historisants et les géographes de l’école vidalienne. Sur le terrain économique, il attaque le marginalisme dans ses versions tant utilitariste que mathématique ou psychologique. Les griefs concernent l’usage selon lui très approximatif de la méthode hypothético-déductive, le schématisme de l’homo œconomicus, l’absence de vérification empirique des résultats théoriques obtenus et l’intrusion constante et clandestine de considérations normatives dans le discours scientifique15. Parallèlement à cette activité critique, Simiand pose les bases de la méthode positive en science économique. Il va les appliquer scrupuleusement dans ses premières monographies de recherche ; il publie en 1904 puis (sous une forme élargie) en 1907 sa première réflexion d’envergure : Le Salaire des ouvriers des mines de charbon en France. Contribution à la théorie économique du salaire, où il met en acte son discours de la méthode positive et commence à avancer ses proposition relatives à la normalité économique analysée comme « succession de déséquilibres ». Ces premiers moments de sa recherche sont aussi l’occasion de compter ses alliés ; les travaux des Institutionnalistes américains sont salués. Mais c’est surtout avec les courants allemands que le dialogue est engagé. Et c’est, plus précisément encore, l’entreprise de Gustav Schmoller et de son équipe qui est saluée par Simiand.
De nombreux comptes-rendus critiques dans L’Année sociologique le conduisent d’abord à relever les contributions aux Schmoller Jahrbuch, et la parution des monographies d’A. Doren, R. Eberstadt, A. Spiethoff et de nombreux autres encore est régulièrement saluée par Simiand. Et, en 1900 puis 1904, il publie deux longs comptes-rendus des volumes 1 et 2 des Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre de Schmoller. Même si quelques réserves sont prononcées, la critique est très élogieuse et Simiand peut affirmer que « ce traité est un monument scientifique16 ». Quatre qualités de l’approche de Schmoller retiennent l’attention du jeune sociologue.
- L’adoption d’une méthode, positive, par ailleurs scrupuleusement réfléchie par une pratique collective de recherche et d’enquête ; une méthode procédant de « l’observation exacte », condition à la formulation de définitions précises et à l’établissement de classements rigoureux et permettant au final de « trouver les formes types et d’expliquer causalement17 » ;
- L’élaboration d’une nouvelle distribution des matières économiques distinguant et articulant une approche de type anatomique dévouée à l’étude de « l’organisation centrale et structure de l’économie », et une approche de type physiologique étudiant les « processus dynamique de cette économie » ;
- Le maintien d’une ligne exigeante en matière de but de l’activité scientifique en économie. Schmoller, a certes accumulé dans un premier temps des travaux historiques et des monographies, mais « il n’a jamais perdu de vue le but synthétique de généralisation et de théorie, théorie vraiment scientifique cette fois » ;
- Le fait que cette entreprise théorique culminant avec l’étude la plus précise et positive possible des processus dynamiques modernes a toujours nourri, chez Schmoller et ses élèves, « une aspiration raisonnée vers la réforme sociale18 ».
Simiand a alors pu résumer son point de vue sur l’économie schmollerienne en quelques phrases :
Il est, je crois, nettement inexact de considérer que l’école dite historique ne pense pas aboutir à des lois. (Voir la Préface du 2e volume du Grundriss de Schmoller, où il s’oppose lui-même autant aux historiens purs qu’aux économistes orthodoxes ; et le chapitre méthodologique de ce même précis). Sans doute les lois auxquelles les économistes arrivent ou peuvent arriver ne sont pas universelles en ce sens qu’elles exprimeraient la vie économique de tous les temps et de tous les pays ; ce sont des lois d’évolution et des lois relatives : mais apporter la notion d’évolution dans une matière à science expérimentale n’est pas renoncer à la science de cette matière ; tout au contraire. La distinction conforme à la division réelle des économistes serait plutôt une distinction entre la tendance à une science conceptuelle, idéologique d’une part, et la tendance à une science positive, expérimentale, d’autre part. Mais du reste, il est rare qu’aucune de ces deux tendances soient pure et soutenue jusqu’au bout dans aucune des écoles passées19.
Cette lecture de Schmoller permettait à Simiand d’une part, de critiquer l’option marxiste, d’autre part d’avancer dans son propre programme de recherche. Le marxisme est critiqué sur deux plans ; au niveau de la détermination trop stricte qu’il prévoit des phénomènes sociaux par les seuls phénomènes économiques. Simiand peut ici s’appuyer sur le credo durkheimien et avant lui comtien d’une interdépendance générale et organique de tous les phénomènes sociaux pour dénier la prééminence d’un seul d’entre eux. Et, significativement, Simiand appuie aussi sa critique sur la démonstration proposée par R. Stammler et sur sa mise en avant des phénomènes juridiques20. Mais il critique aussi le marxisme pour la conception pessimiste qu’il présente de l’évolution économique moderne. Le constat est dressé à l’occasion de ses toutes premières réflexions sur la notion de « crises économiques », cette notion allant rapidement devenir le cœur de son propre projet théorique21. En 1902, Simiand chapitre les théoriciens qui, considérant « la crise comme un mal pour la société économique […] en ont conclu que le système où se produisait constitutivement ce phénomène était par-là seul pathologique » ; or, plutôt que pathologiques, les crises dans un système dynamique ont peut-être une « fonction ». Simiand note ici, « il est à présupposer en effet, qu’un phénomène aussi caractéristique, revenant à périodes presque fixes, sert à quelque chose dans la système économique contemporain […] c’est-à-dire accomplit certaines fonctions22 ».
La fonction des crises est explicitée par Simiand dans ses premières contributions théoriques propres. L’évolution économique moderne s’accomplit par l’intermédiaire d’une succession ininterrompue de phases de hausse et de baisse, causée elle-même par un jeu d’actions collectives rivales des deux acteurs centraux du capitalisme moderne : « tous ces phénomènes s’expliquent par une action humaine, une action ouvrière et une action patronale, et se ramène à un jeu de tendances de ces deux actions ». Chez ces acteurs, patronaux et ouvriers, quatre tendances s’observent. Dans l’ordre, tendance à conserver le même gain, tendance à ne pas augmenter l’effort, tendance à augmenter son gain, tendance à diminuer l’effort. L’enquête positive menée par Simiand dans le cadre d’une industrie spéciale, mais typique des nouvelles relations industrielles modernes, signale comment s’articulent ces tendances :
- « Dans un même sujet économique chacune de ces tendances, rangées dans cet ordre, est plus forte que la suivante, c’est-à-dire se satisfait d’abord avant et plutôt que la suivante » ;
- « De l’une à l’autre des parties en présence, les tendances de même rang s’équivalent, c’est-à-dire, si elles sont en conflit composent entre elles » ;
- « De ces deux tendance résulte le corollaire que chacune de ces tendances, soit ouvrière soit patronale, est plus forte que la tendance de rang inférieur de l’autre partie23 ».
Deux enseignements sont donc ici centraux dans la vision du capitalisme moderne que Simiand propose : ce régime peut abriter un régime original et providentiel de conflictualité où patrons et ouvriers par leur heurts réguliers produisent paradoxalement le progrès ; toutefois ce régime doit être organisé et veillé car il dépend de la bonne réalisation de conditions particulières ; les groupes d’agents doivent être informés et organisés en vue du déroulement réglé de cette conflictualité économique récurrente. Il est nécessaire, dans les termes de Simiand, « d’organiser le déséquilibre » par un véritable « programme d’action ». Il faut donc étudier positivement « dans la société actuelle tous les premiers linéaments, toutes les préparations, tous les commencements d’une telle organisation », étudier donc le nouveau rôle de l’État, des syndicats, des coopératives24.
Rist lecteur de Menger
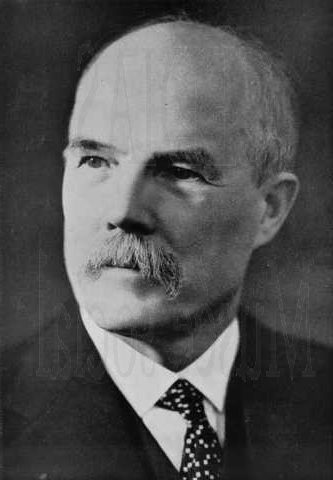
Charles Rist (1874-1955) était un brillant représentant de la toute jeune génération d’économistes formés dans les nouveaux départements d’économie récemment abrités, sur décision du gouvernement républicain, dans les facultés de droit. La création en 1896 de la mention économique à l’agrégation de droit viendra consacrer cette volonté politique de dégager son enseignement en France du monopole de l’école libérale qui pontifiait encore dans le vieux Journal des économistes. Une « nébuleuse réformiste25 » s’exprimera par opposition, dès 1887, dans la turbulente Revue d’économie politique26. Influencé par le réformisme de Raoul Jay, le jeune Rist27 consacrera ses deux thèses de droit à des aspects saillants de la question sociale : les accidents de travail et la journée de travail de l’ouvrier. Il s’éloigne rapidement du droit pour se consacrer à l’économie, discipline plus à même d’apporter des améliorations aux problèmes sociaux modernes, et il va être, à l’instar d’Albert Aftalion, d’Adolphe Landry ou d’Étienne Antonelli, l’un des acteurs de la réception du marginalisme en France au tout début du vingtième siècle. Il lit et s’enthousiasme pour les travaux de Carl Menger, Léon Walras, Alfred Marshall, Irving Fisher ou encore Joseph Schumpeter. L’orientation sociale de ses préoccupations demeure, et il rédige par exemple avant 1914 la « Chronique ouvrière » de la Revue d’économie politique alors que, simultanément, il travaille avec son irascible aîné, Charles Gide, à la première édition de leur Histoire des doctrines économiques, qui paraîtra en 1909 et dont il rédige les parties les plus novatrices.
Dans cette Histoire des doctrines économiques, Rist met en valeur une tradition qui, autour de 1830, partant des efforts des saint-simoniens dont il admire entièrement les options théoriques et doctrinales, a trouvé dans le socialisme d’État allemand, avec Rodbertus puis Ferdinand Lassalle, une expression plus moderne. Mais l’aboutissement actuel de cet effort se trouve selon Rist dans l’œuvre d’Anton Menger auquel il consacre une longue étude en 1903 à l’occasion de la parution de sa Neue Staatslehre.
La recension est extrêmement élogieuse et Rist pourra la conclure en notant que « la Neue Staatslehre formule avec une autorité sans égale un idéal positif de réforme28 ». La rigueur déductive de Menger, sa volonté de synthèse, le caractère encyclopédique de son travail sont salués ; ce que Rist apprécie toutefois en priorité chez Menger est d’avoir renouvelé et actualisé les intuitions du socialisme pré-marxiste, notamment saint-simonien. Les saint-simoniens, procédant de la distinction entre sociétés guerrières et sociétés industrielles, bouleversent l’analyse à trois niveaux : ils opposent la problématique de la distribution (qui intègre la question de la dotation initiale des agents, donc celle notamment de la propriété) à celle de la répartition (simple problème de la détermination du prix des facteurs sur le marché) ; dessinent avec l’opposition entre industriels et oisifs une nouvelle logique de conflictualité (antagonisme entre producteurs et oisifs, mais dialogue entre producteurs) ; prévoient enfin de nouvelles articulations entre conciliation spontanée des intérêts et conciliation artificielle ; sur ce dernier point, Rist souligne par exemple leurs efforts en vue « d’éviter par une prévoyance et une centralisation intelligente les inconvénients de la concurrence29 ». Menger renoue donc avec ce socialisme dont il adopte la distinction entre sociétés guerrières et sociétés industrielles et surtout l’intuition d’un fondement juridique et non économique du socialisme. Le socialisme se résume à deux droits, droit à l’existence et droit au produit intégral du travail, ces deux droits se heurtant à l’instant présent au droit de propriété. L’État, en effet, dans le système présent, continue à obéir à une logique de la force, à la base des rapports sociaux et de leur histoire. Il mène une politique de puissance et de conquêtes et protège les classes souveraines en validant le droit de propriété et en laissant par la suite jouer, mais sur des bases inégales, les contrats et transactions économiques. Le futur État socialiste lui substituera une logique de production en rapport avec les intérêts généraux. La propriété sera transférée à la collectivité : les instruments de travail seront gérés collectivement et la répartition, bien qu’inégalitaire, obéira à une logique consciente de partage et de bien-être minimal de chacun. Si Rist loue dans l’ensemble l’analyse de Menger, il pointe néanmoins deux défauts : en premier lieu, le fait d’avoir ignoré que les linéaments de cet ordre futur sont d’ores et déjà visibles dans le présent : le droit de propriété est constamment entamé par les nouvelles lois sociales, l’État intervient de façon croissante dans l’économie, une réflexion d’ensemble est menée sur la nécessité d’un système économique prévoyant mais en les contrôlant collectivement, les inégalités, le comportement intéressé et la hiérarchie. En second lieu, le fait de trop miser sur l’impulsion politique d’un tel mouvement de réforme ; si l’État importe dans le cadre de cette évolution, il faut remarquer aussi qu’une large part de cette dynamique procède des pratiques économiques elles-mêmes. L’idéal juvénile du socialisme industrialiste est, selon Rist, plus nettement porté par les « embryons de l’ordre économique de l’avenir30 », sociétés coopératives, grandes banques, fédérations des grandes industries, que par l’État lui-même dont on ne peut taire, y compris chez Menger, le penchant autoritaire.
Cette réflexion sur le socialisme juridique de Menger s’intègre chez Rist à une réflexion d’ensemble sur l’économie qu’il expose en 1904 et 1907 dans un grand article en deux parties, « Économie optimiste et économie scientifique31 ». Il articule à cette occasion son admiration doctrinale pour le socialisme dans sa version juridique et son admiration théorique pour le marginalisme walrasso-paretien. Le marginalisme, selon Rist, a fait réaliser deux grandes avancées à la réflexion :
- il a d’abord renouvelé les analyses de l’échange, de la production et de la distribution, dégageant au final un enseignement central : « la libre-concurrence réalise la justice dans la distribution des richesses, comme le maximum de bien-être dans l’échange et dans la production32 » ;
- il a ensuite nettement séparé le domaine du positif de celui du normatif si bien que le marginalisme ne peut en aucun cas être assimilé à une défense inconditionnelle du laisser-faire et du régime actuel de la propriété.
Dans l’article de 1904, Rist analyse la théorie contemporaine de l’échange qui montre que, dans un régime parfait de libre-concurrence, les prix s’établissant sur le marché procurent à chaque échangiste un maximum de satisfaction. Ce résultat, selon Rist, n’a aucun contenu politique évident tant il est question ici d’ophélimité et non d’utilité au sens commun du terme, que cette analyse est totalement silencieuse concernant les dotations initiales des échangeurs et qu’enfin, la libre-concurrence est une « conception conventionnelle » ; « la libre-concurrence, note-t-il d’ailleurs, est une conception artificielle (…) dont la réalisation ne saurait par suite résulter de je ne sais quelle action naturelle et spontanée des individus, poursuivant isolément leur intérêt personnel, mais uniquement de leur action concertée33 ». L’article de 1907 est quant à lui spécialement consacré à la distribution des richesses. Le marginalisme, en montrant comment la libre-concurrence égalise contribution et rétribution des facteurs, est, strictement, une théorie de la « fixation du prix des services ». Pour passer à une approche en termes de distribution des richesses, il faut faire intervenir le problème des dotations, non seulement en statique, mais surtout en dynamique : « le revenu individuel dépend, en grande partie, de la répartition préalable de la propriété ». Ce problème, central chez les penseurs socialistes, a cependant occulté la question de la dotation des individus en qualités spécifiques : dès lors, pour Rist, « pour passer de la théorie du prix des services à celle de la répartition des revenus, il faut faire intervenir au moins deux autres éléments : la répartition de la propriété entre les hommes et la répartition entre eux de la force, de l’intelligence, de l’habileté34 ». Ces deux éléments sont-ils indépendants ? Rien n’est moins sûr selon Rist, mentionnant ici les idées de Pareto sur les élites. L’idée est reprise avec plus d’extension encore lorsque le problème de la distribution est analysé en dynamique. En dynamique, ce sont des déséquilibres créateurs de rentes qui constituent l’état normal du système. Ces rentes sont parfois le fait du hasard pour leurs bénéficiaires. Mais Rist insiste surtout sur la capacité de certains individus à innover, bousculer les routines, et ainsi créer des déséquilibres dont ils sont les bénéficiaires ; ici, l’idée de « concurrence vitale » est réaffirmée par le jeune économiste qui peut écrire :
L’homme ne se contente pas de profiter, à des degrés divers, des rentes que font naître les déplacements d’équilibre économique, dus à des causes collectives involontaires. Il fait plus, il les crée lui-même. Il se fait volontairement l’agent des déplacements de l’équilibre… Ainsi, l’agent le plus actif du perpétuel déséquilibre économique, c’est l’homme lui-même ; c’est lui qui fait surgir constamment des rentes nouvelles, – et l’action simultanée de tous ces individus hantés du même souci et courant au même but, qu’est-ce autre chose que la lutte pour la vie, sous sa forme la plus brutale souvent et la plus cynique, mais aussi la plus féconde et la plus belle35.
Rist tire trois conséquences de son analyse : en premier lieu, la théorie marginaliste du prix des services relève plus de la théorie de la production que de celle de la distribution, les revenus réels des individus étant surtout conditionnés par la répartition préalable de la propriété et par la lutte pour la vie ; en second lieu, cette analyse disqualifie l’idée de classe au sens marxiste du terme : ici pas d’antagonisme frontal entre deux classes, mais plutôt présence de multiples « groupes entre lesquels la lutte pour la vie fait naître des conflits innombrables36 » ; en troisième lieu, cette analyse permet de montrer que la répartition n’obéit à aucun mécanisme social impératif mais dépend plutôt de certaines conventions et institutions. Dès lors, Rist peut tirer de cette analyse deux orientations normatives : d’une part il n’y aucun sens à vouloir agir sur les prix des services pour modifier la distribution, puisque cette dernière obéit à des déterminants autrement complexes ; d’autre part, si une action volontaire doit s’imposer, elle ne peut que concerner les conditions de la lutte pour la vie ; Rist note ici qu’« il semble qu’une égalisation croissante des conditions de la lutte pour la vie serait de nature à assurer une répartition plus favorable37 ».
Société industrielle et république
Il y a évidemment nombre de nuances et différences dans la lecture des débats allemands que proposent Halévy, Rist ou Simiand. Chacune des trois réceptions constitue une sélection apparemment personnelle répondant à des attentes individuelles : sélection d’un auteur de prédilection, et sélection d’une direction élue de son œuvre. L’apparent éclatement des trois lectures ne doit cependant pas être surestimé car elles offrent des aspérités communes qui trouvent leur origine dans le contexte intellectuel français du tournant 1900. L’essor du capitalisme n’est pas ici, comme dans le contexte allemand confronté à des doutes, angoisses, regrets, liés à l’essor d’un monde dominé par la rationalité instrumentale et le calcul ; il est plutôt évalué à l’aune des exigences de l’idée républicaine et de la prétention de ses institutions et valeurs à accorder tous les hommes sur des principes raisonnables. Mais Simiand, Halévy et Rist s’opposent également à un ethos français qu’ils jugent trop obnubilé par les problèmes politiques et moraux et pas assez attentif aux questions économiques et sociales. Dans le contexte intellectuel de l’époque, où domine le combat en faveur de la laïcité et où l’économique et le social se déclinent sur le mode incantatoire de la solidarité, ils opèrent un triple décentrement.
La lecture de Marx et des marxistes, de Schmoller et des socialistes d’État, des marginalistes autrichiens, répondait d’abord à la volonté singulière de ces trois auteurs de délaisser le droit ou la philosophie pour s’intéresser à l’économie et à son histoire ; il ne faut pas ici sous-évaluer certaines décisions ; Halévy, délaissant Platon, déroge à son statut de brillant jeune penseur pour s’occuper brusquement d’histoire des doctrines, économiques de surcroît ; autour de 1900, il doit de nombreuses fois s’en expliquer, se justifier auprès de ses camarades. Simiand, frais cacique de l’agrégation de philosophie (en 1896) – et dont Henri Bergson expliquait qu’il avait été « l’esprit le plus remarquable qu’il ait jamais rencontré parmi ses élèves et le mieux doué à coup sûr en philosophie » – entre immédiatement à la Fondation Thiers, prépare une thèse de droit, et pour cela, rassemble et compile pendant plusieurs années des séries de statistiques des salaires des ouvriers des mines en France. Rist, élève de Raoul Jay, s’éloigne du droit, commence à suivre les cours d’économie à la Faculté de Paris, se dégoûte de leur caractère invertébré, se met alors à étudier les mathématiques pour comprendre les œuvres, alors marginales et décriées en France, d’un Léon Walras ou d’un Irving Fisher. Ces efforts participaient d’une volonté commune à ces trois jeunes intellectuels de « déniaiser », pour ainsi dire, le républicanisme à la française ; si les combats traditionnels en faveur de l’autonomie, en particulier du jugement, demeurent capitaux et méritent l’affrontement présent avec l’Église, il ne faut pas dissimuler, jugent-ils, le fait que les principales atteintes à l’autonomie se développent aussi sur le terrain économique et social. Et ce terrain mérite une étude positive, nouvelle, ingrate au risque de reproduire les inoffensives approximations du solidarisme. Ce qui est donc original dans ce contexte républicain français, chez Rist, Halévy ou Simiand, c’est qu’ils se servent de nombre de références, dont celle capitale des auteurs de langue allemande, pour déplacer cette interrogation sur l’autonomie et la domination du terrain traditionnel de la laïcité et de l’opposition de l’Église et de l’État à celui de l’économie politique. C’est ici Halévy qui exprimera le plus clairement cette décision. Rendant compte d’un ouvrage de John Hobson, il a pu noter :
C’est la connaissance approfondie de l’économie politique qui permet à M. Hobson de parler, en matière sociale, un langage rigoureux, d’échapper soit au formalisme de la doctrine kantienne du droit, soit au formalisme, tantôt abstrait, tantôt métaphorique, de la sociologie contemporaine, et enfin, au lieu de réfuter ou défendre la théorie abstraite des droits de l’homme, de la réviser, de la compléter, de la remplir en quelque sorte38.
En second lieu, la lecture des auteurs allemands a permis, par réaction, à ces jeunes intellectuels de renouer avec la tradition industrialiste et positiviste française des origines, celle ayant éclos autour de 1830. L’analyse allemande du capitalisme – Marx fait ici figure d’épouvantail – est perçue comme trop pessimiste et trop déterministe, trop unilatérale enfin dans ses solutions, où l’État autoritaire joue chaque fois un rôle tuteur. Pour les auteurs français, ce n’est pas le capitalisme et ses antagonismes frontaux qui importe, mais la société industrielle qui doit s’élever sur les décombres des anciennes sociétés guerrières et belliqueuses. Les filiations sont ici évidentes ; on sait le tribut que les durkheimiens, payaient spontanément aux saint-simoniens, Durkheim dans son cours de 1895-1896 sur le socialisme faisant de Saint-Simon et non de Marx le cœur de ce mouvement d’idées ; et Simiand, influencé en outre par les réflexions de Lucien Lévy-Bruhl sur Auguste Comte et le positivisme, est ici sur une ligne très proche, un commentaire plaçant toute son œuvre sous le signe d’un « saint-simonisme averti39 » ; mais Halévy, faisant référence à l’actualité des disciples de Saint-Simon, ne cachera pas non plus son admiration pour leur économie politique, et notera aussi en 1907, « Les saint-simoniens conçurent, et nous tendons après eux, à concevoir la société comme une association, non pour l’abolition mais pour l’organisation de la concurrence40 ». Deux ans plus tard, Rist, exprimant l’idée d’une actualité de la doctrine, est plus explicite encore : « Le socialisme saint-simonien n’exprime pas une vague aspiration vers une égalité primitive et chimérique ; il est au contraire, l’expression d’un enthousiasme juvénile pour le nouveau régime industriel, né des inventions et des découvertes scientifiques41 ». Le langage importe ici : le terme « capitalisme » demeure associé à une vision déterministe et peu engageante de l’avenir ; en revanche, les termes « industrie », « industriels », « industrielle », sont associés à une vision plus ouverte et plus prometteuse du futur.
En troisième lieu, le passage par les auteurs allemands a permis à ces jeunes intellectuels de rafraîchir la vision industrialiste originelle. Naturellement, ils demeurent attentifs au fait que l’industrie est plutôt promesse de concorde et de consensus là où auparavant les sociétés guerrières ne produisaient que chaos, peur et destruction. Mais – et ici l’influence de Marx, même tue, est bien présente et féconde – on repousse justement chez Halévy, Rist et Simiand une vision trop unilatérale des choses et on complète l’idée de coopération par celle de conflit. Cela explique d’ailleurs le rapport assez tiède qu’ils entretiennent avec la vulgate solidariste qui dessine alors un certain moment républicain. Là encore, c’est Halévy qui exprime le mieux son scepticisme : rendant compte en 1907 dans la Revue de métaphysique et de morale du petit volume de son ami Bouglé, Le Solidarisme, Halévy déplore : « Mais pourquoi M. Bouglé s’attèle-t-il à la tâche ingrate d’exposer, avec une apparente sympathie, une doctrine usée par le patronage d’un trop grand nombre de personnages officiels, et peut-être, en fin de compte, inexistante » ?, un peu plus loin il conclut, « doctrinalement, le solidarisme n’existe pas ». Mais il le dira aussi directement et brutalement à l’intéressé : « le solidarisme n’existe que dans la pensée de quelques professeurs français42 ». Halévy, Simiand ou Rist choisissent alors de s’écarter de la notion de consensus pour mieux tenter de dégager la fécondité de certains conflits économiques ou industriels. Ces conflits, remarquent-ils, produisent dans certains cas de la coopération et du lien. Un singulier agencement de conflits est bien au cœur de la théorie de l’évolution économique de Simiand. Rist, de même, évoque l’idée de sélection, mentionne les compétitions individuelles mais surtout porte attention aux transactions toujours changeantes entre groupes « d’industriels » (au sens saint-simonien du terme) dans le cours de l’évolution. Halévy le dit aussi, et, significativement, à l’occasion d’une critique du « mysticisme sentimental » des saint-simoniens : « on ne saurait concevoir une association si parfaite que l’antagonisme n’y joue encore un rôle, et que le problème de l’organisation politique, dans cette société comme dans tout autre, est non de supprimer mais d’utiliser un principe d’antagonisme qui est comme enraciné dans le nature des choses ». Mais la vision du conflit qui se dégage ici n’est pas marxienne dans le sens où ces trois auteurs insistent sur le caractère divisible des conflits économiques43. La société industrielle est donc une société en mouvement produisant continûment et indissociablement de la coopération et du conflit et l’enjeu consiste à cultiver le processus singulier de développement qui en résulte. Pour cela, chacun des trois auteurs renoue avec le thème classique de l’association, au cœur du message des socialistes originels. Le rôle régulateur du nouvel État républicain dans ce processus n’est pas nié, loin de là ; mais en complément ou en contrepoids à sa logique centripète et centralisatrice, et en raison de leur familiarité avec les processus économiques émergents, ces jeunes intellectuels-économistes affirment la présence et la fécondité régulatrice d’instances intermédiaires, associations, coopératives, syndicats. Rist en proposera la formulation la plus claire un peu plus tard dans sa contribution significative au volume La Politique républicaine : « tout l’essor économique du dernier siècle, écrit-il, est lié à l’essor des associations, à celle du capital et à celle des hommes. Tout l’effort de la législation républicaine depuis cinquante ans se résume à un encouragement de l’association ». Dans le système nouveau, industriel et démocratique, « l’essentiel est que soit mis en contact les représentants qualifiés de toute l’activité productive du pays que leurs intérêt antagoniques se formulent librement, que de leurs oppositions se dégage pour tous la nécessité de solutions équitables et de compromis pratiques et la notion d’un intérêt national supérieur44 ».
In fine l’étude ponctuelle de quelques textes ou lectures de jeunesse de ces trois intellectuels constitue une première invitation à la découverte des économistes de la République, au tournant 1900 aussi bien qu’à d’autres moments charnières de l’histoire politique et économique française de ces deux derniers siècles. Le lien que tentaient d’opérer de grandes figures de l’analyse, Jean-Baptiste Say ou Léon Walras, entre leur engagement républicain et les rouages économiques des sociétés modernes est redécouvert actuellement. Cette redécouverte atteste de la fécondité d’une histoire élargie de l’économie politique et mérite donc d’être approfondie par l’étude d’autres économistes. Cette enquête peut aussi permettre de compléter l’analyse du « moment républicain » français en 190045 ; il est notamment évident que les analyses proposées par ce trio d’économistes républicains, Halévy-Simiand-Rist, ne coïncident pas exactement avec le dogme solidariste. Enfin, ce travail peut bénéficier à la recherche contemporaine en permettant d’observer certaines zones intellectuelles où quelques raideurs républicaines caractéristiques, qu’elles concernent la prise en compte de l‘hétéronomie et de la conflictualité ou le traitement des questions économiques et sociales46, ont été constamment travaillées et donc en partie transformées par des intellectuels qui décidèrent de consacrer leurs efforts à l’observation et l’étude de ce qu’en termes modernes Albert Hirschman appelait récemment « la nécessaire praxis du développement économique47 ».
In fine l’étude ponctuelle de quelques textes ou lectures de jeunesse de ces trois intellectuels constitue une première invitation à la découverte des économistes de la République, au tournant 1900 aussi bien qu’à d’autres moments charnières de l’histoire politique et économique française de ces deux derniers siècles. Le lien que tentaient d’opérer de grandes figures de l’analyse, Jean-Baptiste Say ou Léon Walras, entre leur engagement républicain et les rouages économiques des sociétés modernes est redécouvert actuellement. Cette redécouverte atteste de la fécondité d’une histoire élargie de l’économie politique et mérite donc d’être approfondie par l’étude d’autres économistes. Cette enquête peut aussi permettre de compléter l’analyse du « moment républicain » français en 190048 ; il est notamment évident que les analyses proposées par ce trio d’économistes républicains, Halévy-Simiand-Rist, ne coïncident pas exactement avec le dogme solidariste. Enfin, ce travail peut bénéficier à la recherche contemporaine en permettant d’observer certaines zones intellectuelles où quelques raideurs républicaines caractéristiques, qu’elles concernent la prise en compte de l‘hétéronomie et de la conflictualité ou le traitement des questions économiques et sociales49, ont été constamment travaillées et donc en partie transformées par des intellectuels qui décidèrent de consacrer leurs efforts à l’observation et l’étude de ce qu’en termes modernes Albert Hirschman appelait récemment « la nécessaire praxis du développement économique50 ».
==================
NOTES
- Cet article a fait l’objet d’une première présentation aux journées d’études « Débats allemands sur les formes de capitalisme fin dix-neuvième – début vingtième siècles », organisé par Gilles Campagnolo (CEPERC / CIERA), Aix-Marseille, mai 2006, puis a été publié dans le numéro 10 de la revue Raison publique.[↩]
- Les intellectuels du « mouvement » qui, dans le contexte d’un heurt des « deux France », affrontaient alors sur de nombreux dossiers les intellectuels de « l’ordre » ; voir ici les remarques classiques de François Goguel, La Politique des partis sous la IIIe République, Paris, PUF, 1946.[↩]
- Vincent Descombes, Le Même et l’autre, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 17.[↩]
- Claude Digeon, La Crise allemande de la pensée française 1870-1914, Paris, PUF, 1959.[↩]
- Pascal Ory et Jean-François. Sirinelli, Les Intellectuels en France de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Armand Colin, 1992, chapitres 1 et 2.[↩]
- Élie Halévy, « Grandeur, décadence et persistance du libéralisme en Angleterre » dans Inventaire : la crise sociale et les idéologies nationales, Paris, Félix Alcan, 1936, p. 23.[↩]
- Élie Halévy, Histoire du socialisme européen, Paris, Gallimard, 1948, p. 91-99.[↩]
- Ibid.[↩]
- Elie Halévy, « Les principes de la distribution des richesses », Revue de métaphysique et de morale, vol. 14, no 4, 1906, p. 547.[↩]
- Ibid., p. 571.[↩]
- Ibid., p. 572.[↩]
- Il s’agit d’ailleurs plutôt chez Halévy d’un hommage méthodologique à Platon et à sa dialectique ; Élie Halévy, La Théorie platonicienne des sciences, Paris, Alcan, 1896.[↩]
- Élie Halévy, « Les principes de la distribution des richesses », art. cit., p. 595.[↩]
- Élie Halévy, « La doctrine économique de Saint-Simon », Revue du mois, 1908, vol. 4 et vol. 6, p. 641-676 et p. 39-75.[↩]
- François Simiand, La Méthode positive en science économique, Paris, Alcan, 1912.[↩]
- François Simiand, critique de Gustav von Schmoller, Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre (2e vol.), L’Année sociologique, vol. 4, 1903-1904, p. 514-520, p. 518.[↩]
- Ibid., p. 490.[↩]
- François Simiand, critique de Gustav von Schmoller, Über einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirtschaftslehre, L’Année sociologique, 1898, p. 448-450, p. 450.[↩]
- François Simiand, intervention pour l’entrée « économie politique », dans André Lalande (dir.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, (première édition 1926-1927 chez Alcan). L’entrée « économie politique » fut discutée en 1905. [↩]
- François Simiand, critique de Rudolph Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschitsauffassung, eine sozialphilosophische Untersuchung (1896), L’Année sociologique, vol. 2, 1897, p. 488-497.[↩]
- Voir ultérieurement son titre majeur, François Simiand, Le Salaire, l’évolution sociale et la monnaie, Paris, Domat-Montchrestien, 1932.[↩]
- François Simiand, « Crises économiques », L’Année sociologique, 1902-1903, p. 580-582.[↩]
- François Simiand, « Le salaire des ouvriers des mines de charbon en France », Journal de la société de statistique de Paris, 1908, p. 13-29, p. 26.[↩]
- Voir François Simiand, « Le problème économique », dans Georges Renard (dir.), Le Socialisme à l’œuvre. Ce qu’on en fait. Ce qu’on peut faire, Paris, Cornély, 1907.[↩]
- Christian Topalov (dir.), Laboratoire du nouveau siècle. La nébuleuse réformiste et ses réseaux en France 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.[↩]
- Lucette Levan-Lemesle, Le Juste ou le riche. L’enseignement de l’économie politique 1815-1950, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, 2e partie.[↩]
- Sur Rist, voir surtout le numéro commémoratif de la Revue d’économie politique, 1955, et notamment la « Notice biographique », rédigée par Rist qui y est reproduite pages 977-1045.[↩]
- Charles Rist, « Un nouveau livre d’Anton Menger », Revue d’économie politique, 1903, p. 888-912, p. 907.[↩]
- Charles Rist, « Saint-Simon, les saint-simoniens et les origines du collectivisme », dans Charles Gide et Charles Rist, Histoire des doctrines économiques, Paris, 1909, livre 2, chapitre 2.[↩]
- Charles Rist, « Un nouveau livre d’Anton Menger », art. cit., p. 911.[↩]
- Charles Rist, « Économie optimiste et économie scientifique », Revue de métaphysique et de morale, vol. 12, 1904, p. 643-663, et vol. 15, 1907, p. 596-619.[↩]
- Ibid., 1904, p. 645.[↩]
- Ibid., 1904, p. 658.[↩]
- Ibid., 1907, p. 607.[↩]
- Ibid., 1907, p. 608.[↩]
- Ibid., 1907, p. 616.[↩]
- Ibid., 1907, p. 618-619.[↩]
- Élie Halévy, critique de John Hobson, The Social Problem, Revue de métaphysique et de morale, 1901, vol. 9, supplément de juillet, p. 4. [↩]
- Célestin Bouglé, « La méthodologie de François Simiand et la sociologie », Annales sociologiques, série A, 1936, p. 12.[↩]
- Élie Halévy, « La doctrine économique de Saint-Simon », art. cité, 1907.[↩]
- Charles Rist, chapitre cité de Histoire des doctrines économiques.[↩]
- Élie Halévy, Correspondance (1891-1937), Paris, Éditions de Fallois, 1996, p. 281.[↩]
- Sur cette distinction entre conflits divisibles/non divisibles et sur le caractère divisible des conflits économiques voir Albert Hirschman, « Des conflits sociaux comme piliers d’une société démocratique de marché », dans Un certain Penchant à l’autosubversion, trad.. P.-E. Dauzat, Paris, Fayard, 1995.[↩]
- Charles Rist, « La politique économique républicaine », dans Michel Augé-Laribe, Aimé Berthod, Émile Borel et alii., La Politique républicaine, Paris, Alcan, 1924, p. 275.[↩]
- Jean-Fabien Spitz, Le Moment républicain en France, Paris, Gallimard, 2005. [↩]
- Voir ici la mise en évidence de ces carences dans, Nicolas Tenzer, La République, Paris, PUF, 1993 ; ou dans Serge Audier, Les Théories de la république, Paris, La Découverte, 2004.[↩]
- Albert Hirschman, « Des conflits sociaux comme piliers d’une société démocratiques de marché », art. cit., p. 348.[↩]
- Jean-Fabien Spitz, Le Moment républicain en France, Paris, Gallimard, 2005. [↩]
- Voir ici la mise en évidence de ces carences dans, Nicolas Tenzer, La République, Paris, PUF, 1993 ; ou dans Serge Audier, Les Théories de la république, Paris, La Découverte, 2004.[↩]
- Albert Hirschman, « Des conflits sociaux comme piliers d’une société démocratiques de marché », art. cit., p. 348.[↩]

Ludovic Frobert
Ludovic Frobert est historien de l’économie, directeur de recherches CNRS,membre de l’UMR Triangle,à l’ENS Lyon.
