Tolstoï et la lutte contre l’autocratie
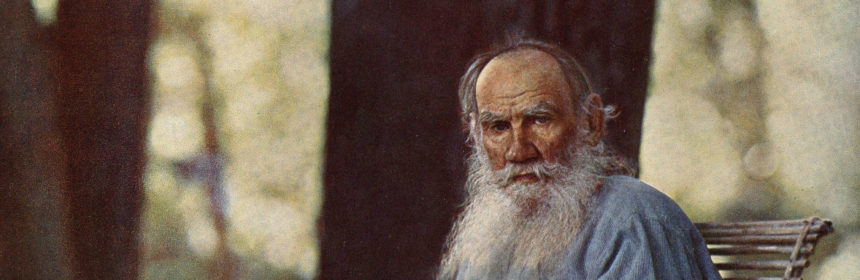
À propos de : Léon Tolstoï, Les Insurgés. Cinq récits sur le tsar et la révolution, traduit du russe, présenté et annoté par Michel Aucouturier, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2017.

Décembristes1, populistes, socialistes, Polonais : ces hommes qui, pour des raisons et dans des buts divers, luttèrent contre les tsars de Russie au cours du XIXe siècle, peuplent les pages des Insurgés, recueil de cinq récits de Tolstoï dont la conception, le titre, et les traductions sont dus à Michel Aucouturier. Ces cinq textes sont : « Les Décembristes », « Après le bal », « Pour quelle faute ? », « Le Divin et l’Humain », « Notes posthumes du starets Fiodor Kouzmitch ». Ainsi que Michel Aucouturier l’explique dans sa préface, le premier de ces textes diffère des quatre suivants par son origine et son statut. « Les Décembristes » se compose en effet des trois premiers chapitres d’un roman commencé dans les années 1860, et abandonné par Tolstoï pour l’écriture de Guerre et paix. Les autres textes « renvoient [eux aussi] à un intérêt ancien et constant du romancier pour l’histoire de son pays et de sa société, mais [ils] appartiennent par leur dimension et leur orientation générale à une autre phase de sa vie spirituelle et de son activité intellectuelle, dominée par le prosélytisme et les préoccupations religieuses2 » (préface aux Insurgés, p. 13).
Ce prosélytisme et ces préoccupations sont particulièrement sensibles dans le récit intitulé « Le Divin et l’Humain », qui opposent les trajectoires également fatales, mais de sens contraire, de deux révolutionnaires populistes, Svetlogoub et Mejenetski, le recruteur de Svetlogoub. Arrêté, celui-ci est condamné à mort. Dans sa prison, on lui remet un exemplaire des Évangiles, qu’il lit d’abord « pour le seul plaisir de lire » (p. 149). Mais bientôt cette lecture le bouleverse, et le transforme. Elle n’est plus que le passe-temps d’un prisonnier, mais une révélation – la révélation d’une manière d’être et de vivre, bonne pour Svetlogoub et pour tous les hommes : « Il se demandait pourquoi les hommes, tous les hommes, ne vivaient pas comme il était dit dans ce livre. « Car ce n’est pas pour un seul homme qu’il est bon de vivre comme ça, mais pour tous les hommes. Qu’on vive comme ça, il n’y aura pas de malheur, de besoin. » » (p. 152). La lecture des Évangiles lui révèle même le sens profond de ses engagements passés, auprès du peuple, pour l’éduquer, puis dans l’action terroriste : « Oui, oui, c’est bien cela ! s’écria-t-il soudain, les yeux pleins de larmes. C’est précisément cela que je voulais faire. Oui, c’est cela que je voulais : donner aux autres mon âme ; ne pas la préserver, mais la donner. C’est là qu’est la joie, c’est là qu’est la vie » (p. 151). Sur le chemin de sa pendaison, Svetlogoub est aperçu par un vieux-croyant3 détenu dans la même prison que lui, et qui reconnaît en lui un homme qui « a connu la vérité » (p. 162). Ce même vieux-croyant va croiser la route de Mejenetski, également arrêté, mais condamné à la prison, puis à la déportation au bagne. En prison, Mejenetski manque de sombrer dans la folie, connaît la tentation du suicide, mais retrouve son équilibre en s’exerçant à imaginer la révolution à venir. Au bagne, il doit faire face aux critiques d’une nouvelle génération de révolutionnaires pour qui « tout ce que faisaient Mejenetski et ses amis, toutes leurs tentatives de soulever les paysans, et surtout la terreur et les assassinats, […] étaient une erreur » (p. 181), et qui prônent l’arrachement du peuple à la terre afin qu’il apprenne, dans les usines, la solidarité prolétarienne, condition nécessaire de la révolution. Il retrouve aussi le vieux-croyant, dont il ne comprend pas la foi, et qui lui apparaît comme une incarnation du peuple arriéré dépeint dépeint avec mépris par les nouveaux révolutionnaires. Pris d’« une colère contre tous, contre tout, contre tout ce monde absurde où ne pouvaient vivre que des hommes semblables à des animaux, comme ce vieillard avec son agneau4, et des bourreaux et des geôliers tout aussi bestiaux, ou ces doctrinaires insolents, sûrs d’eux-mêmes, morts-nés » (p. 188), Mejenetski se pend dans sa cellule.
Tout semble clair, et même un peu trop clair, dans « Le Divin et l’Humain » : pour lutter contre l’injustice politique et sociale, la réforme morale et une sorte de quiétisme évangélique sont préférables à l’action révolutionnaire, à ses prétentions, à sa violence. La construction en diptyque du récit vient en souligner le message. Ce Tolstoï-là n’est-il pas un peu trop affirmatif et moralisant pour nous ? Il me semble cependant qu’on peut être sensible, dans ce texte, à la mise en récit du questionnement politique et moral des personnages, à leurs interrogations – voire à leur conversion, dans le cas de Svetlogoub –, qui dénotent des âmes également intègres, à défaut d’avoir également raison aux yeux de leur créateur. Ces motifs de l’interrogation moral et du revirement de la conscience sont au centre de deux autres récits : « Après le bal » et « Notes posthumes du starets Fiodor Kouzmitch ». Dans « Après le bal », un certain Ivan Vassiliévitch raconte à des amis comment sa vie a, d’une certaine façon, basculé en une nuit. Il était étudiant, amoureux de Varenka, la fille d’un colonel de l’armée impériale – et il pouvait à bon droit penser qu’elle le lui rendait bien. Il connaît une véritable extase amoureuse au cours d’un bal donné par « le maréchal de la noblesse » (p. 81) de sa province, et auquel se trouvent également Varenka et son père. Après le bal, incapable de dormir, il part en promenade, se dirige vers leur demeure – et tombe sur la scène qui va tout changer pour lui : un soldat du régiment commandé par le père de Varenka, le torse et le dos nus, passe entre ses camarades, alignés sur deux files, et qui le frappent avec des verges, sur l’ordre du colonel. La scène de cette atroce punition – récurrente, comme le relève Michel Aucouturier, dans les différents textes du recueil – bouleverse Ivan Vassiliévitch : « J’avais tellement honte, que, ne sachant de quel côté regarder, comme si j’avais été surpris en train d’accomplir l’action la plus honteuse, je baissai les yeux et me hâtai de revenir chez moi » (p. 92). Après cette scène, il ne lui est plus possible d’aimer Varenka. Le bal a son envers : la cruelle punition du soldat, et cet envers l’emporte dans le cœur et la conscience d’Ivan Vassiliévitch. Comme dans « Le Divin et l’Humain », Tolstoï a construit son récit comme un diptyque, où le son des tambours militaires répond à la musique du bal, l’ordonnancement de la punition à celui des danses, le corps titubant et meurtri du soldat à la grâce de Varenka – et la hargne du colonel dirigeant la punition à son maintien de danseur. La conclusion qu’Ivan Vassiliévitch tire de son expérience paraît cependant moins nette qu’on ne pourrait s’y attendre : « Et alors, vous pensez que j’ai donc décidé que ce que j’avais vu était mal ? Pas le moins du monde. « Si on faisait cela avec autant d’assurance et que tous le jugeaient indispensable, c’est qu’ils savaient tous quelque chose que je ne savais pas », pensai-je, et je m’efforçai de l’apprendre. Mais j’avais beau faire, même plus tard je ne parvins pas à l’apprendre » (p. 93). Mais si l’humilité d’Ivan Vassiliévitch le retient d’affirmer que « ce [qu’il avait] vu était mal », l’insatisfaction quant aux raisons de l’ordre social qu’il en a retirée s’avère durable.
« Notes posthumes du starets Fiodor Kouzmitch » est un récit inachevé, et cet inachèvement donne des regrets : car Fiodor Kouzmitch est l’identité d’emprunt du tsar Alexandre Ier qui, s’étant fait passer pour mort, a pu quitter un trône dont il ne voulait plus, et mener une vie secrète et retirée avant, sur le tard, de raconter d’une plume critique son enfance de future autocrate, puis sa vie d’autocrate5. Il est dommage que Tolstoï ait abandonné un récit d’une conception aussi forte : l’autocratie mise à nue par l’autocrate lui-même. On retiendra notamment des pages qui nous restent le portrait « de l’intérieur » et passablement démystifiant de Catherine II, la « grande Catherine », la grand-mère d’Alexandre Ier : « Grand-mère me choyait, me couvrait de compliments, et je l’aimais, même si j’étais repoussé par la mauvaise odeur qui, malgré les parfums, l’entourait toujours ; surtout lorsqu’elle me prenait sur ses genoux. Et je trouvais aussi désagréables ses mains propres, jaunâtres, ridées, vaguement glissantes, brillantes, avec des doigts recourbés vers l’intérieur, et des ongles nus d’une longueur excessive. Elle avait les yeux troubles, fatigués, presque morts, ce qui, avec le sourire de sa bouche édentée, produisait une impression pénible, mais pas repoussante » (p. 217) – on se demande comment interpréter les trois derniers mots d’un tel portrait. On retiendra également, et surtout, la relation de l’événement qui a conduit le tsar à quitter le trône – et qui lui a permis de le quitter incognito : une scène de punition militaire semblable à celle d’« Après le bal », et dont la victime ressemble au tsar – ce qui permettra de faire passer le corps du soldat martyrisé pour celui du tsar prétendument décédé. Les réflexions que la scène, d’autant plus frappante qu’il se reconnaît dans le soldat, inspire au souverain font écho à celles d’Ivan Vassiliévitch dans « Après le bal », liant ainsi le prince et son sujet : « Le sentiment qui dominait en moi était que je devais compatir à ce que subissait mon double. Faute de compassion, il fallait reconnaître que l’on faisait ce qu’il fallait – et je sentais que je ne le pouvais pas » (p. 202). Mais le prince, plus coupable, est plus radical que le sujet dans ses conclusions : « Et cependant, je sentais que si je ne reconnaissais pas qu’il devait en être ainsi, que c’était bien, je devais reconnaître que toute ma vie, tous mes actes, tout était mal, et que je devais faire ce que je voulais faire depuis longtemps : tout abandonner, m’en aller, disparaître » (Ibid.). Néanmoins, l’un comme l’autre renoncent à la vie qui leur était promise parce qu’ils ne peuvent plus tenir leur place dans un monde où de simples soldats sont publiquement torturés à mort pour leurs manquements. Et l’inspiration religieuse du retrait d’Alexandre Ier le rapproche également de Svetlogoub, le révolutionnaire exécuté de « Le Divin et l’Humain ».
De ce qui précède, on pourrait conclure que la sensibilité au spectacle de l’injustice, l’aptitude au retour critique sur ses croyances et ses actes sont affaires de classe sociale, et que l’homme du peuple ne les possède pas. Il n’en est rien. Le bourreau de Svetlogoub dans « Le Divin et l’Humain », « un assassin, un bagnard » à qui « le titre de bourreau […] donnait une liberté et un bien-être relatifs » (p. 169), est ébranlé par l’interpellation du condamné : « Et tu n’as pas pitié de moi ? » (p. 167), au point de ne plus vouloir, par la suite, remplir la fonction de bourreau. Et dans les jours qui suivent la mort de Svetlogoub, « il but non seulement tout l’argent qu’il avait reçu pour l’exécution mais tous ses vêtements relativement riches, et finit par être mis au cachot, et du cachot transporté à l’hôpital » (p. 169). Il en va de même pour le cosaque Danilo Lifanov dans « Pour quelle faute ? ». Il a reçu « l’ordre de conduire jusqu’à Saratov deux Polonaises avec leurs cercueils » (p. 130). Ces deux Polonaises sont Albina Migurski et sa dame de compagnie Ludwika ; les cercueils sont ceux des enfants d’Albina, nés et morts loin de la Pologne, à Ouralsk, où leur père avait été relégué pour s’être rebellé contre la domination russe, et où leur mère l’avait suivi. Le mari d’Albina s’étant noyé, elle a reçu l’autorisation de regagner la Pologne avec les dépouilles de ses enfants. Mais Migurski n’est pas mort, il est caché dans le tarantas6où voyagent Albina et Ludwika, et ce n’est pas d’un retour qu’il s’agit, mais d’une évasion. Danilo Lifanov comprend la supercherie, la dénonce, assiste à l’arrestation de Migurski, aux larmes d’Albina. Après cela, « il commanda de la vodka, et se mit à boire : il but toute la journée, dépensa tout ce qu’il possédait et tout ce qu’il portait, et ce n’est que la nuit suivante que, réveillé dans le ruisseau, il cessa de penser à la question qui le tourmentait : avait-il bien fait de rapporter aux autorités qu’il y avait dans la caisse le mari de la Polonaise ? » (p. 134). On peut voir, dans la conduite de Danilo Lifanov comme dans celle du bourreau de Svetlogoub, qui pour boire se dépouillent de leurs biens, comme une forme d’expiation – d’autant plus que le bourreau de Svetlogoub boit ce qu’il doit à sa fonction. Et c’est du général qui ratifie la condamnation de Svetlogoub que nous vient un exemple flagrant de déresponsabilisation morale. Alors qu’il hésite à revenir sur sa signature, parce qu’il se souvient que la culpabilité de Svetlogoub lui a paru discutable, qu’il sent son cœur battre plus fort, il se dit à lui-même : « Et puis cela ne me regarde même pas. Je suis l’exécutant d’une volonté supérieure et je dois être au-dessus de ces considérations » (p. 139). C’est en quelque sorte le mal de l’autocratie que le général dénonce ainsi sans le savoir : amener un homme à renoncer à sa conscience et sa responsabilité pour ne pas avoir à s’interroger sur la justice de ses actes, et devoir ainsi sortir du rang. C’est ce que le bourreau de Svetlogoub et Danilo Lifanov ont, à leur manière, compris.
En plus de leur dimension évidemment morale, les récits rassemblés dans Les Insurgés offrent un aperçu diversifié et saisissant des vicissitudes vécues par ceux qui osèrent défier le régime tsariste. La relégation, la prison, la mort sont le salaire de leurs actions. Leurs personnes en sont affectées, leurs vies et celles de leurs proches bouleversées. La prison manque de rendre fou Mejenetski, comme d’autres avant lui : « Horribles étaient ce silence de mort bien aménagé et la conscience de ne pas être seul et que, derrière ces murs impénétrables, il y avait des détenus comme lui, condamnés à dix, vingt ans de réclusion, qui se tuaient, se pendaient et devenaient fous, ou mouraient de la tuberculose. Il y avait là des femmes et des hommes, et des amis peut-être… « Des années vont passer et tu deviendras fou toi aussi, tu te pendras ou tu mourras, et on ne saura rien de toi », pensait-il » (p. 173-174). La mort de ses enfants fait craquer, pour Albina Migurski, le vernis de normalité de la vie qu’elle mène en exil, aux côtés de son époux, et cet exil lui apparaît alors dans toute son absurdité et sa cruauté : « Sa vie misérable d’exilée, qu’elle savait jusque-là embellir par son goût et sa délicatesse féminine, était à présent devenue insupportable […] » (p. 114). Dans les trois chapitres restant des « Décembristes », c’est du retour à Moscou, après « des décennies » (p. 37) de Sibérie, du décembriste Pierre Ivanovitch et de sa famille qu’il est question. Si le récit est plus foisonnant, plus vif, plus allègre que dans « Pour quelle faute ? » – mordant aussi dans sa peinture de la bonne société moscovite que redécouvre le vieux décembriste –, il fait entrevoir les traces laissées par une si longue relégation à travers la description de l’épouse de Pierre Ivanovitch, Natalia Nikolaïevna : « Ses beaux yeux noirs étaient perdus dans le lointain ; elle regardait et se reposait. Elle se reposait, eût-on dit, ni seulement du rangement de ses affaires, ni seulement du voyage, ni seulement de ses années difficiles : elle se reposait, eût-on dit, de toute sa vie, et le lointain où se perdait son regard, sur lequel se projetaient les visages vivants de ceux qu’elle aimait, était le repos qu’elle désirait » (p. 37). Certes, la fatigue de Natalia Nikolaïevna – fatigue mentionnée à plusieurs reprises dans la suite du récit – n’est pas associée aux seules années de relégation ; mais comment ne pas penser que ces longues années sont pour quelque chose dans une lassitude aux dimensions de toute une existence ?
Une description comme celle de Natalia Nikolaïevna témoigne du fait que, si les récits rassemblés dans Les Insurgés ne sont peut-être pas les plus grands de Tolstoï, celui-ci, comme l’écrit Michel Aucouturier, « n’a […] rien perdu de son pouvoir d’évocation du réel ni de son acuité psychologique » (p. 20). Et, avec toutes les nuances qui s’imposent, le monde d’autoritarisme, de révolte, de répression, de lutte pour l’indépendance, de recherche de la justice que ces récits dépeignent, n’est pas étranger à certains hommes d’aujourd’hui – à certains peuples d’aujourd’hui. Il en est – de ces hommes, dans ces peuples – pour refuser résolument l’irresponsabilité morale, comme Tolstoï nous y incite.
==================
NOTES
- Michel Aucouturier rappelle dans sa préface que furent ainsi nommés les participants à la tentative de coup d’État contre le tsar Nicolas Ier du 14 décembre 1825. [↩]
- Pour un aperçu sur cette phase, je renvoie à la monographie de Michel Aucouturier : Tolstoï, Paris, Le Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1996. [↩]
- « Adepte des anciens rites de l’Église orthodoxe russe » (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vieux-croyant_vieux-croyants/81945).[↩]
- L’agneau vient de l’Apocalypse de saint Jean, que lit le vieux-croyant. C’est une désignation du Christ.[↩]
- Le récit de Tolstoï est, bien entendu, une fiction, mais cette fiction, comme le rappelle Michel Aucouturier dans sa préface, reprend une légende selon laquelle « un certain Fiodor Kouzmitch, vagabond dont on ne connaît que le patronyme », gratifié du « titre de « starets », synonyme de « starik », vieillard, mais dans une acception respectueuse qui en fait un synonyme de « saint homme » » (p. 17-18), aurait bien été le tsar Alexandre Ier.[↩]
- « Ancienne carriole paysanne russe à quatre roues » (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tarantass/76700).[↩]

Jean-Baptiste Mathieu
Jean-Baptiste Mathieu est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm). Professeur agrégé de lettres modernes, il enseigne actuellement au Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Il est rédacteur en chef de la rubrique « Critiques » au sein de la rédaction de la revue Raison publique.
