La terreur d’imaginer : Zabel Essayan – Hagop Oshagan

S’appuyant sur les témoignages de Zabel Essayan et Hagop Oshagan sur le génocide arménien, Catherine Coquio analyse l’emprise de la terreur sur l’écriture. Si Essayan, témoin immédiat des massacres, se laisse emporter par une profusion de mots face à l’horreur, Oshagan y répond par la mise en histoire de l’insensé, dans une démarche patrimoniale. Cet article est d’abord paru dans Raison publique, n°16, printemps 2012.
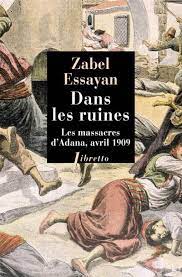
Je souhaite ici attirer l’attention sur deux auteurs arméniens dont viennent d’être traduits des textes importants. D’une part, un récit de Zabel Essayan, Dans les ruines (Averaknerun mej), paru en France cent ans après sa première publication à Constantinople en 1911, et un an après sa réédition en Turquie1. Ce texte, qui évoque le massacre des Arméniens de Cilicie en 1909, peu après la révolution Jeune-Turque de 19082, est un témoignage d’importance historique, puisqu’il est le premier qui tenta d’approcher par l’écriture littéraire une destruction génocidaire : l’auteur, envoyée en mission humanitaire par le Patriarcat, qui lui confiait la tâche de rassembler les enfants survivants dans des orphelinats arméniens, déchiffre cette volonté d’éradication, alors inouïe, à travers les « ruines » que constituent les lieux du massacre et les survivants eux-mêmes. L’autre groupe de textes émane de Hagop Oshagan : il concerne le projet que celui-ci eut d’écrire, au seuil des années 1930, alors qu’il était réfugié à Chypre, un « roman de la Catastrophe »3 s’affrontant pour finir au génocide de 1915 – projet qui ne put aboutir. Ce roman, intitulé Mnatsortats, qu’on traduit ordinairement par « Ce qui reste », était écrit aux deux-tiers et couvrait plus de 1 600 pages lorsqu’en 1934, tout s’arrêta. L’auteur cessa d’écrire, terrorisé et menacé par son propre projet littéraire.
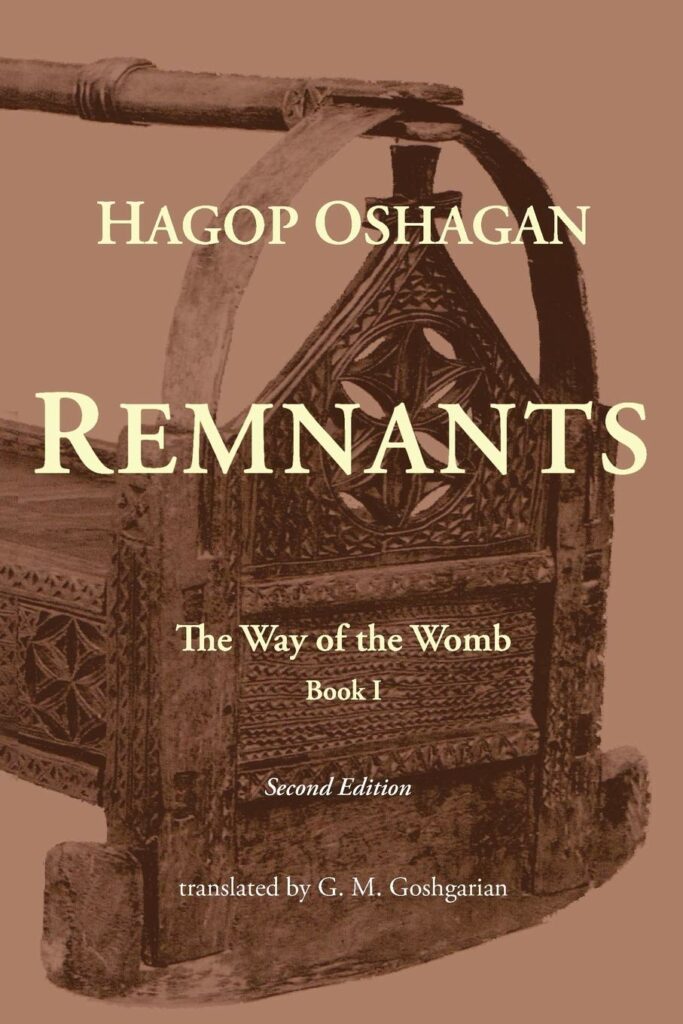
« Roman de la Catastrophe » est la formule-titre du gros livre que Marc Nichanian a consacré en 2008 à cet auteur4 : celui-ci comporte, en annexes, de larges extraits de ce roman inachevé, et un précieux entretien donné en 1931 à Chypre pour un journal arménien de Boston, paru en 1932 sous le titre « À l’ombre des cèdres », où Oshagan expose en détails son projet5. Tout le livre de Nichanian est une tentative pour interpréter l’œuvre d’Oshagan à la lumière de ce projet esthétique, de cet échec, et du projet critique qui supplanta finalement le projet romanesque, signant une mutation du « témoignage », de l’acte de création littéraire à l’acte de sauvetage critique et philologique. Le Roman de la Catastrophe est le dernier volume d’une trilogie intitulée Entre l’art et le témoignage. Littératures arméniennes au XXe siècle, dont le premier, La Révolution nationale, contient un chapitre entier consacré à Zabel Essayan : Nichanian y interprète le livre Parmi les ruines, et surtout sa préface, rédigée deux ans après le témoignage lui-même, comme une tentative pour produire une lecture politique de massacres « constitutionnels », et de ramener Turcs et Arméniens à l’espoir d’une « patrie » commune.
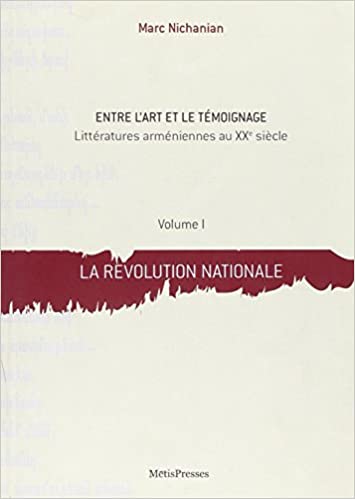
L’ensemble de cette trilogie, qui constitue un apport considérable pour la réflexion sur les littératures de la Catastrophe, redonne vie à d’autres œuvres d’écrivains arméniens qui, après avoir nourri un idéal national nourri d’une « esthétique de la langue » où Oshagan prit une large part, périrent lors du génocide, et à d’autres qui, voyant leurs espoirs s’effondrer, se laissèrent prendre au piège de l’Arménie soviétique, succombant au régime après des adhésions enthousiastes ou des solutions de compromis, comme ce fut le cas de Yeshigué Tcharents et de Zabel Essayan elle-même. De sorte que toute la trilogie est une réflexion sur les relations entre terreur et littérature, à partir de destins broyés par la violence du siècle : celle du génocide d’abord, celle du totalitarisme soviétique ensuite. Destins déchiffrés dans des œuvres qui portent les marques d’une lutte acharnée contre l’entreprise de destruction intégrale, fût-ce au prix de l’autocensure ou de l’aveuglement.
Si j’évoque ici, à travers Essayan et Oshagan, deux moments méconnus dans l’histoire du témoignage, c’est, outre leur importance intrinsèque, que l’un et l’autre se montrent, au moment d’évoquer l’événement à partir des « ruines » ou du « reste », sous l’emprise d’un effroi inédit, qui relève d’une espèce de terreur : comme si l’ensemble de la réalité, objective et subjective, était sous l’empire d’une instance à laquelle l’écriture devait elle-même résister et céder à la fois. Cet effroi est l’ombre portée d’un événement qui, lui, ne relève plus de la terreur politique, ni même de la « violence », puisqu’il s’agit d’un programme d’anéantissement préparé, puis réalisé. À l’époque où Essayan écrivait Dans les ruines, en 1909, ce programme n’en était qu’à l’étape de l’expérimentation6 ; quand Oshagan, exilé à Chypre, imaginait la fin de son roman, en 1931, on en était à l’étape de la négation politique, pratiquée depuis neuf ans à l’échelle internationale.
La réalisation d’un génocide, et déjà du massacre concerté qui l’annonce, porte la terreur politique à un point où elle s’autodétruit en tant qu’instrument de pouvoir, pour basculer dans une opération de destruction intégrale qui porte sa propre logique intrinsèque, dénuée de sens, mais qui, impliquant les individus et souvent les « voisins », s’accompagne d’actes de cruauté illimitée, eux, dotés de sens et même souvent pleins d’ingéniosité symbolique7. Ce qu’on dit « inimaginable » est à la fois cette finalité logique et cette cruauté sans fin des gestes qui l’accompagnent. Témoigner de cet illimité, c’est restituer la perturbation inouïe du témoin, qui s’acharne à concevoir cette absence de fin et cet insensé, objet de terreur. L’imagination et la réflexion s’y déséquilibrent par un va-et-vient entre le réel et l’imaginaire, l’identification et la projection, par quoi le témoin du génocide fait l’expérience d’une autre terreur.
Essayan et Oshagan étaient deux écrivains déjà connus dans les milieux littéraires arméniens de Constantinople lorsqu’eurent lieu les événements qui firent rupture dans leur œuvre et leur vie : alors qu’ils travaillaient l’un et l’autre à moderniser la littérature arménienne occidentale, rattrapés par l’histoire ottomane, ils voulurent être des témoins de la Catastrophe, et tentèrent de l’être en écrivains. Ils ont été des « témoins » en deux sens très différents : Essayan a été en 1909 ce qu’on appelle un témoin oculaire, et Oshagan est à la fin de sa vie un témoin en un sens qui lui est entièrement propre ; il s’est constitué, lui et son œuvre, en document de l’histoire d’un pays et de « l’âme » d’un peuple. Et c’est différemment aussi que l’un et l’autre ont acquis un statut mythique dans la mémoire arménienne.
« Un effroi d’un genre nouveau »
Dans les ruines raconte le voyage de Zabel Essayan et de ses compagnons de mission en Cilicie, deux mois et demi après les massacres, et le trajet qui l’a menée, de village en village, jusqu’à Dört-Yol et Hadjin. Alors qu’elle s’était jusque-là illustrée par une veine militante nourrie du modèle citoyen – et féministe – français, et un art littéraire à la fois réaliste et intimiste, Essayan tente d’imaginer ce qui vient de se dérouler en déchiffrant les traces visibles que le cataclysme a laissées dans ces lieux qu’elle visite. Sa plume, d’ordinaire très ferme, tremble à chaque page sous le coup d’une imagination impuissante à saisir et communiquer la réalité. Tout au long elle restitue ce qu’elle voit et entend, dont les récits des témoins directs des massacres, surtout des Européens – une mère supérieure dans un orphelinat, la femme d’un consul anglais dans un hôpital pour enfants, une Française qui assista à tout – car les survivants, eux, semblent ne plus pouvoir parler. Elle en décrit les corps blessés, efflanqués et mutilés, mais surtout les regards traversés de folie. Témoignage des traces, Dans les ruines est un recueil de témoignages directs et une série de portraits d’êtres effondrés, femmes, vieillards et enfants surtout, puisque la population masculine était décimée ; l’auteur revient sans cesse à leurs regards hallucinés ou hébétés, et c’est à travers leurs lueurs effrayantes que se fait voir la démesure de l’événement. Ou plutôt celui-ci prend forme, page après page, dans le regard qu’elle porte sur chacun de ces regards, en un mouvement d’horreur et de compassion mêlées : l’hallucination la gagne à mesure de ce qu’il lui faut imaginer, et rend vaine l’« aide humanitaire » qu’elle était censée apporter.
Le témoignage restitue la terreur croissante qui surgit dans l’après-coup immédiat du crime, là où le crime ne peut être que saisi à partir de l’énormité du malheur produit, qui fait de la mission une course-poursuite avec la folie. Le texte court de portrait en portrait, de récits en récits, et s’achève sur un galop effréné pour fuir le lieu de cauchemar qui vient d’être visité. Regarder les survivants provoque une lutte visible pour ne pas se laisser totalement noyer dans la misère. La pensée s’arrime à un effort de rationalisation politique, qui a le dernier mot en préface : Essayan y dit sa « révolte à la vue des bourreaux » et « l’impudence du regard des criminels impunis », mais, s’adressant à la fois au Arméniens et aux « compatriotes » turcs, elle magnifie les « humbles » qui continuent de mettre leur « vie blessée et meurtrie à disposition de courants d’avant-garde » – celui de la révolution citoyenne, idéal initialement partagé avec les Jeunes Turcs –, pour lutter contre « le plus grand danger qui menace la patrie : le retour de la tyrannie ». Dans son commentaire, Nichanian interprète les deux ans de maturation du livre comme ce qu’il a fallu à cette femme pour « se libérer de la terreur, de la trop grande identification aux sinistrés », afin de « produire ce livre de douleur et de deuil » – deuil qui à cette époque, ajoute-t-il, semblait encore possible. En 1911, Essayan pouvait encore « se dresser contre l’interdit du deuil et élever un monument aux morts sous la forme d’un témoignage8 ». Ou plutôt elle pouvait imaginer que le deuil était possible – ce qui ne sera plus le cas en 1915, quand, pendant d’interminables mois, un peuple entier fut massacré, affamé à mort, expulsé et confiné dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie pour y périr intégralement9.
Cette imagination funéraire, encore politique, contrebalance celle d’un crime qui ne l’est plus. Placée devant l’abîme des haines inextinguibles, Essayan recule après avoir perdu pied dans la folie des rescapés. Au-delà d’une terreur intime à exorciser, ce texte en appelle à la compassion humaine pour affirmer un droit. Mais ce qu’il faut penser est un au-delà de la tyrannie : c’est l’entrée en démence d’une volonté politique gagnée à l’idée d’anéantissement, qui fait écrire en tant qu’« être humain » :
Ce que j’ai vu et entendu pourrait ébranler les fondements de tout État. […] C’est ce sentiment qui m’a poussée à écrire sans réserve aucune – en tant que citoyenne libre, que véritable enfant de mon pays, jouissant des mêmes droits et assumant les mêmes obligations que tous – ces pages qu’il faut considérer non pas tant comme le fruit de la sensibilité d’une femme arménienne que les impressions spontanées et sincères d’un être humain comme les autres10.
Dans le texte lui-même, le langage de la « citoyenne libre » cède à celui de l’empathie – les « impressions spontanées et sincères » –, qui devrait susciter l’émotion des « compatriotes » turcs eux-mêmes. Mais cette mutation de la pitié en solidarité se heurte à un mur de silence implacable, et pour « l’être humain » même la compassion se corrompt dans un « trouble » profond et violent. Celle qui devait « assister » se dit tout au long débordée, impuissante : non seulement parce que les moyens d’assister les orphelins étaient honteusement dérisoires11, mais parce que le mouvement d’empathie est lui-même précédé et parcouru de ce sentiment de terreur, dont l’auteur dit d’emblée la violence morbide. Dès le premier chapitre (« Vers la Cilicie »), Essayan dit « l’impatience sordide » et la « curiosité fébrile » que suscite « l’idée de pénétrer au cœur de la catastrophe » (p. 33). Et plus loin elle évoque la « curiosité maladive » de son groupe, perçue par tel haut-fonctionnaire turc, qui s’étonne que celui-ci prenne en pitié même une criminelle turque condamnée à la pendaison (p. 152).
La composition géographique et initiatrice du récit, qui raconte la mission étape par étape, obéit à cette « idée » par quoi l’imagination pénètre la catastrophe en direction de son « cœur ». Cette idée maladive est celle-là même qui anime la volonté de témoignage à l’œuvre dans ce texte qui, comme atteint par la démence du monde criminel et survivant qu’il lui faut traverser, devient une chambre d’échos pleine de cris, de grimaces et de plaintes, que l’analyse ne peut, elle, « pénétrer » que de biais, s’extrayant du « cœur de la catastrophe ». Le témoignage lui-même se dit et se sait sinon fou, travaillé d’hystérie : « […] j’ai voulu décrire, dit Essayan, ce qu’est un peuple rendu fou par le feu et le sang versé, livré à des décisions insensées », et « exprimer ces cauchemars qui obscurcissent et endeuillent le ciel de la patrie elle-même » (p. 32). La « patrie », invoquée politiquement, est aussi « endeuillée » par un « peuple rendu fou » car « livré à des décisions insenées » – cercle de l’insensé que restitue le cercle des « impressions spontanées ».
Le récit fait retour sur ce sentiment de terreur qui absorbe les autres et altère la pitié. Dans le chapitre ironiquement appelé « Une journée d’aide (humanitaire) », croisant le regard d’une femme rendue folle par son « histoire cauchemardesque », Essayan parle d’une « émotion qui donne le vertige » (p. 114) ; et devant le spectacle abyssal des orphelins, elle dit éprouver un « effroi d’un genre nouveau »12. Au chapitre sur « Les orphelins », le sentiment d’impuissance est livré à l’analyse alors que le texte tente de rendre compte de ce qui a été vu : une foule d’enfants aux yeux éteints ou exorbités, terrorisés et livrés à l’abandon total. Ici la compassion est dépassée à proportion que la souffrance l’est elle-même – « la souffrance était au-dessus de leurs forces », dit-elle, décrivant des enfants « anéantis » qui s’effondrent dans le sanglot, le silence, ou le sommeil (p. 56), ou qui, regardant celle qui les regarde, saisissent l’horreur qu’ils suscitent : « Ces enfants voyaient qu’ils me faisaient horreur. J’étais troublée par leur psychologie, incapable de les regarder dans les yeux ». Au moment d’écrire, le premier regard posé sur la foule des « orphelins blêmes » reste en mémoire comme la hantise d’un échec à « saisir, même par un effort extrême, toute l’intensité de leur malheur : c’est une chose qui, jusqu’à ce jour, m’est restée impossible », dit Essayan (p. 57). À cette intensité s’ajoute une ampleur impropre à la compassion individuelle comme à la totalisation :
Des détails ou des images partielles me reviennent à l’esprit, mais je reste incapable de faire l’inventaire des innombrables histoires sanglantes de ces enfants. Je ne pouvais m’occuper longuement de chacun d’eux. Ces regards d’enfants étonnés, ahuris, encore incompris, exprimaient un chant de mort, embrouillé, interminable13. Ce carnage, ce flot de sang, le désespoir de ces personnes affolées prises en étau entre le feu et les poignards, demeuraient hors de mon entendement et je pense qu’il en a été ainsi pour chacun d’entre nous. (p. 57)
Au dernier chapitre, intitulé « Sur le chemin », le fourgon du convoi humanitaire parti en direction d’Adana accélère sa course sur un sol couvert de « cendres blanches et brillantes », « cendres d’ossements humains » que le vent soulève tandis que, malgré la chaleur du soleil qui se déverse dans ce « champ de désespoir », un froid glacial pénètre les corps : « nous tremblions, nous tremblions terriblement. […] Le monde était noir à nouveau pour nous, nous étions dans l’ombre de la mort… » (p. 259). Un moment, les « sentiments désespérément tristes de témoin » sont crevés par l’image d’une « vitalité sans cesse renaissante » : « vengeance » d’une « pensée victorieuse » de courte durée, qui très vite s’égare « dans les détails » et cède à « l’épouvante » : « Des visions cauchemardesques défilaient furtivement dans mes souvenirs et mon pauvre cœur battait avec une intensité irrégulière » (p. 256). Le cœur en chamade s’accorde au galop des chevaux, rendus « comme fous » par ces visions. Le paysage minéralisé par la destruction rejette la vie incongrue dans une fuite hallucinatoire. Et lorsque celle-ci s’arrête, la conscience se ressaisit pour éprouver un scandale sans mesure. Arrivée à Adana, Zabel Essayan se lève en pleine nuit et observe, du haut de sa fenêtre, le sommeil de « la ville criminelle » :
La ville criminelle dormait. Je me suis levée et j’ai longuement regardé, très longuement, autour de moi, sur les toits. J’ai senti ma fierté et ma haine si intenses que je n’ai pas osé en prendre la mesure. (p. 268).
La préface de 1911 est faite pour redonner une mesure politique, et donc une signification, à cette intensité. En 1915, Essayan ne pourra plus, dit Nichanian, « donner ainsi un “sens” à l’extermination de son peuple ». Après avoir fui par la Bulgarie, réfugiée dans le Caucase, elle passa trois ans à transcrire et traduire en français des témoignages de la Catastrophe destinés à documenter le crime14. Puis son idéal de citoyenneté se transporta vers le communisme. Installée en Arménie soviétique en 1933, elle servit la cause du régime jusqu’à ce qu’un jour, une trop grande franchise en faveur d’un écrivain menacé la fasse arrêter pour espionnage au compte de la France – et elle disparut dans une geôle soviétique en 1943.
« Il avait peur de quelque chose qui se profilait au loin »
Le sentiment de terreur se manifeste tout autrement chez Oshagan, par un silence, un blanc, qui brusquement, comme par surprise, clôt le chapitre du racontable et du représentable – et pour lui définitivement. S’il y a bien un « tremblement terrible », ici, il n’anime pas l’écriture intime d’un témoin s’exprimant en son nom, mais un silence qui prend place à l’endroit où le récit, mûrement réfléchi à l’état de projet, devait passer à l’acte et « conclure » l’histoire d’un peuple. Mnatsortats, ou le roman des « Paralipomènes », devait, selon ses termes, « sauver ce qui reste de notre peuple », « ce qui demeure à la surface de la terre digne d’être conservé, de ses mœurs et de son expérience » « fixer sur le papier, dans ses expressions essentielles, la sensibilité des Arméniens occidentaux »15, par la reconstitution fictionnelle d’un vécu ancien : c’est ainsi qu’Oshagan entendait initialement témoigner, chargeant le romancier qu’il était de « rendre le temps qui fut le sien », celui de l’enfant, de l’adolescent, puis de l’homme mûr. Après avoir raconté, selon sa méthode épique et subjectiviste, inspiré des anciens chroniqueurs et de Joyce et Proust, l’histoire des Arméniens ottomans à l’échelle d’un village arméno-turc au cours du XIXe siècle, comme un drame passionnel et finalement sanglant, Oshagan s’arrêta sur le seuil de la dernière partie, qui devait s’intituler « L’Enfer ».
Auteur de cycles romanesques faits de récits complexes et enchevêtrés, destinés à raconter l’Histoire à travers l’entremêlement des vies individuelles et des groupes sociaux, jusque-là maître de ses procédés littéraires qui avaient incorporé la technique du roman moderne, et sûr de sa valeur d’artiste jusqu’à la mythomanie, Oshagan savait qu’il s’attaquait là à un sujet singulier, qui mettait à l’épreuve l’aptitude de l’art à mettre en œuvre le réel. Il avait mûrement réfléchi aux problèmes inhérents à la représentation romanesque de l’anéantissement d’un peuple, et à la manière dont il pensait pouvoir les surmonter. Il s’en était expliqué dans cet entretien où, isolé à Chypre, à distance spatio-temporelle de l’événement lui-même, il énumérait les obstacles qu’allait devoir surmonter sa poétique pour se réaliser néanmoins : il se fiait à sa « méthode d’approfondissement » puisée dans la technique du roman moderne anglosaxon, propre à « embrasser dans leur ensemble les vagues de la vie qui se croisent, qui se prolongent l’une l’autre, ces vagues d’une vie qui n’aime rien tant que replonger en elle-même »16. Les « impressions spontanées », chez lui, devaient être construites, sédimentées, finalisées.
Oshagan cherchait non seulement à « sauver de l’oubli autant de gens qu’il est possible », mais à totaliser par l’œuvre d’art une expérience historique assimilée à une « tragédie » : il fallait écrire à la manière d’un « flot d’énergie nerveuse » plutôt que d’un « document historique », et représenter les « conflits ethniques » à la manière de « luttes spirituelles », passant par les « voies du sexe et du sang » – d’où le titre des première et deuxième parties – « Le Chemin de la matrice », et « Le Chemin du sang » –, écrites et prêtes pour la publication à l’époque où il exposait ce projet d’ensemble. Ce programme, il le disait « modeste » en soi mais « difficile à mettre en œuvre » dès lors que « l’ouragan » avait dispersé le peuple qui en formait le sujet, réduisant à rien sa « réceptivité nerveuse »17. Mais les difficultés réelles venaient avec la représentation de l’anéantissement lui-même : « on voit venir le point, dit Oshagan, où les individus cesseront d’avoir du poids et où c’est la masse qui entrera en scène ». Or ce point était un point-limite, car la manière dont la « masse » était « entrée en scène », faisant des uns des bourreaux et des autres des victimes, était peu propice à la scène de l’art :
La Catastrophe, infinie mais étrangement uniforme, échappe à l’artiste qui veut l’embrasser tout entière, car la condition de l’art est la diversité. La critique qui a été soulevée contre les analyses connues sous le nom de « littérature de guerre » est tout aussi pertinente pour n’importe quel travail qui prendra son sujet dans notre Extermination. Sur une route qui s’étire sur des milliers de kilomètres, presque partout ce sont des gens que l’on égorge dans des conditions identiques et d’autres qui égorgent18.
Pour répondre à l’exigence de « diversité » qui conditionne la forme artistique, Oshagan se fie à sa « méthode d’approfondissement » : il entend « transporter l’intérêt vers les états psychologiques » en multipliant les « angles d’approches » et les « moments », et examiner « d’infiniment près », par une « sorte de pointillisme », cet écoulement « fait de sang, d’âme, de crime et de péché »19. Mais, difficulté supplémentaire, il lui faudra faire ce travail en l’absence des innombrables témoignages qu’il aurait fallu d’abord rassembler et lire, pour pouvoir écrire et « saisir sans romantisme » la dispersion ultime et la « transmettre au lecteur ». Oshagan, qui était lui aussi parvenu à s’enfuir par la Bulgarie, n’avait pas vécu la déportation. Il se fiait à une expérience au long cours transformée en atavisme personnel : « Depuis mille ans (parfois cinq à dix fois par siècle), dit-il, notre peuple a vécu ses 1915. » Et puisque, comme il l’écrit, « l’expérience du sang ne (lui) était pas étrangère », il devait donc pouvoir « s’approcher de la Catastrophe » par la « concentration » et un « honnête traitement » (p. 331).
Ce récit, Oshagan ne put jamais l’écrire. Sa poétique romanesque, qui consistait à construire une « myriade d’impressions » en récit polyphonique, connaît un arrêt brutal à l’endroit liminaire où le récit de « l’Enfer » devait plonger son lecteur – et son auteur – dans la folie anéantissante qui s’était réalisée vingt ans plus tôt. Cet échec, que Oshagan a réfléchi après coup dans des textes saisissants, marque la mise en défaut de l’imagination littéraire de l’anéantissement, du moins sous la forme de la contre-épopée polyphonique qu’il projetait d’accomplir. Le chroniqueur de la Catastrophe totale, sauveur des « restes » devenu prophète d’un peuple survivant, fut rendu finalement muet par l’idée de la Catastrophe à écrire, comme si la monotonie informe de l’égorgement en série ne pouvait donner lieu à l’approfondissement pointilliste, comme si la totalisation impossible empêchait le travail de « concentration » sur les individus et sur les moments particuliers : la démesure et l’ampleur des souffrances, qui rendaient impossible chez Essayan le travail de la compassion et de l’entendement à la fois, interdisent chez Oshagan celui de la forme artistique telle qu’il la concevait.
Oshagan ne renoncera pourtant pas à « sauver » ces « restes », ni à « témoigner ». Mais il le fera sous forme critique dans son œuvre dernière, un énorme Panorama de la littérature arméno-occidentale, qui, entamé en 1938 et rédigé pendant plusieurs années, paraîtra en dix volumes de 1945 à 198220. À la place du roman de la Catastrophe, donc, Oshagan écrivit une histoire de la littérature des Arméniens de l’Empire ottoman, qui constituait, dans son esprit, un « témoignage très concentré » de l’histoire de ce peuple. Cette « sensibilité arméno-occidentale » qu’il voulait sauver de l’oubli en donnant forme à « ce qui reste », il ne put la sauver que sous forme d’une critique des œuvres, qu’il écrivit, elle, sans difficulté aucune21. La critique fut donc la forme que prit le « témoignage » chez Oshagan, et ceci en un sens personnel. À la fin de cette somme testamentaire, au livre X, intitulé « Témoignage », Oshagan parle de lui-même à la troisième personne, et évoque l’inachèvement de Mnatsortats. Là, le romancier devenu philologue se met à réécrire ce livre imaginaire en des termes qui rappellent l’entretien de Chypre. Mais il présente l’arrêt de son travail comme un recul devant la mort.
Écrire, pour lui, ce n’était ni un désir de gloire, ni une maladie. Il n’en attendait plus rien. Mais il avait peur de quelque chose qui se profilait au loin. Et s’il se pressait, mêlant le jour et la nuit, c’était du fait de cette peur. Quand, au printemps de 1934, il arriva à l’épuisement, sous la forme d’une légère crise cardiaque, il mit bas le stylo. Il ne pouvait pas marcher droit sur la mort22.
Au seuil de ce dernier volume sur la Catastrophe, Oshagan s’était donc approché au plus près de « l’Enfer », si près qu’il lui fallut reculer. Ce qui faisait se « presser » depuis plusieurs années, est aussi ce qui fait reculer – et on retrouve ici, longtemps après et comme intériorisé, le double mouvement de course et de fuite évoquée par Essayan. Mais le plus impressionnant n’est pas ce recul, ni l’arrêt du cœur sous l’excès de la tâche angoissante. C’est qu’en 1934 encore, presque vingt ans après, Oshagan percevait « quelque chose qui se profilait au loin ».
Le temps de l’écho
Zabel Essayan et Hagop Oshagan ont écrit dans des circonstances et des visées profondément différentes, difficiles à imaginer aujourd’hui. Essayan écrit dans l’immédiat après-coup des massacres, pour témoigner au sens le plus simple du terme, en journaliste et en écrivain, de ce qu’elle voit et ressent ; elle écrit ses « impressions » en se tenant « dans les ruines » de l’histoire qui vient de se dérouler, au plus près de l’état d’effroi et de bousculade intérieure qu’il suscite. Ce tumulte nourrit l’acte d’écrire au point de devenir son objet, et le regard sur l’autre, sur les ruines de l’autre, alterne avec un propos sur soi, sur l’effondrement ou l’engloutissement de soi, qui fait osciller l’écriture entre terreur et pitié en un sens très peu aristotélicien, l’une traquant et détruisant l’autre. Le lecteur est emporté dans ce chaos d’une âme et d’un corps, à travers un langage et un style d’époque qui souvent font obstacle à l’identification aujourd’hui. Oshagan, lui, écrit vingt ans après l’événement, et rêve d’une œuvre capable de totaliser l’histoire arménienne à travers une forme moderne : chez lui l’effroi semble plus maîtrisé, projeté à distance par l’idée esthétique, mais il ressurgit à l’horizon du projet lui-même, qu’il fait intégralement basculer dans le registre de l’utopie : il conduit l’auteur à interrompre sa réalisation. Et c’est la réflexion critique sur ce projet, puis sur sa non-réalisation et donc aussi son irréalité, qui devient le témoignage de l’événement, traduit en expérience de terreur, en menace de mort et de folie. L’écriture d’Essayan est hallucinée. L’écriture d’Oshagan est interrompue.
Ainsi la terreur subjective dont je parle, de l’un à l’autre auteur, connaît une sorte de mutation, liée aux circonstances de rédaction de leurs textes, et à leurs situations respectives. Essayan écrit au plus près des massacres qui précèdent la Catastrophe de 1915. Oshagan écrit à distance de la Catastrophe elle-même. Or cette distance ne fait disparaître en rien le sentiment de terreur, qui semble au contraire intériorisé, porté à une puissance d’abstraction extrême, mais dotée d’effets sensibles immédiats, violents, organiques : il révèle là une puissance de destruction comme inentamée, décuplée et potentialisée par la conscience critique.
Essayan et Oshagan n’ont pas vécu directement les massacres dont ils parlent : visitant les rescapés d’Adana, Zabel n’était pas visée mais elle n’était pas en sécurité, et elle dut revenir rapidement à Constantinople23 – qu’elle dut fuir au contraire en 1915, car cette fois son nom figurait sur la liste des écrivains à éliminer : elle n’a échappé à la rafle des intellectuels le 24 avril que grâce au hasard d’une absence, puis elle a vécu dans la clandestinité jusqu’à sa fuite en Bulgarie. Oshagan a connu lui aussi la clandestinité, et pour lui la sortie du pays a donné lieu à un périple qui n’a jamais cessé : la vie en diaspora, qu’il a voulu assumer jusqu’au bout, contrairement à Essayan, l’a fait passer par Beyrouth, Chypre et Jérusalem. Tous deux ont échappé de justesse à la mort, mais ils n’ont pas subi la déportation et les camps-mouroirs des bords de l’Euphrate, comme ce fut le cas d’Aram Andonian et de Yervant Odian, dont les témoignages viennent eux aussi d’être édités en français24.
Le degré de présence à l’événement rapporté importe dès lors qu’il y va du travail de l’imagination, qui se nourrit d’une absence à laquelle elle donne forme. L’écrivain suit l’événement à la trace et tente de faire entendre son écho terrifiant dans un texte qui en devient la caisse de résonance, tout en se frayant le chemin propre à l’intégrer dans une construction capable de re-vectoriser l’histoire, de replacer l’expérience de pure destruction dans une structure à nouveau dynamisée par les pôles du passé et de l’avenir – que cet avenir soit politique, comme chez Essayan, ou qu’il relève d’une tâche intellectuelle, celle de la sauvegarde esthétique et critique du passé, comme chez Oshagan. Ce « faire-écho » est aussi un faire-œuvre, ou un effort vers l’œuvre : c’est un travail pour partie raisonné, qui s’effectue vaille que vaille dans la langue en suivant sa propre « organisation », ou tentative d’organisation du réel par une forme narrative censée soumettre la loi de la terreur à un rythme, un cadre, une composition, un style. On ne saurait pourtant parler ici d’une poétique de la terreur, mais plutôt d’une poétique terrorisée, produite dans le heurt violent de sentiments de haine et de pitié, chez Essayan, et dans la peur d’être écrasé sous la tâche de sauvetage, chez Oshagan. Une extrême tension traverse ces écritures nerveuses, tendues par l’effort de concevoir une souffrance et un crime impropres à toute unité de mesure esthétique ou morale.
Une forme littéraire se cherche en l’absence d’aucun modèle antérieur adéquat, mais elle recourt à certains codes culturels, tout en se plaçant sous l’emprise de la terreur. On ne s’étonne donc pas que cette forme soit étrange, difficile à appréhender aujourd’hui. Cette forme et ce style semblent claudiquer entre un langage désuet ou décalé – l’idée de « sacrifice » chez Essayan, celle d’« esprit du peuple » chez Oshagan – et une réalité nouvelle qui exige son dû et fracture l’unité de ton et de style. Chez Essayan des moments saisissants dans le rendu des visages et des sentiments alternent avec d’autres, pleins d’emphase, où l’hyperbole accentue l’image martyrologique ou héroïque, à contretemps de l’effroi qui s’éprouve en pleine anomie. Chez Oshagan l’obsession d’une forme totalisante, vouée à restituer l’âme d’un peuple dans les termes des nationalismes d’époque, fait éprouver et formuler puissamment des apories constitutives du témoignage littéraire de la Catastrophe, et qui auront raison de son projet. Ce qui rend ces textes précieux est ce décalage avec eux-mêmes, ce qui les rend conscients de leur insuffisance, voire de leur impossibilité : insuffisance de l’imagination comme de la compassion, constamment rappelées par Essayan ; inadéquation de la forme cathartique, éprouvée par Oshagan au moment d’affronter le récit de l’extermination.
Les deux écrivains ont senti une forme de folie les traverser en observant les ruines d’une nation et d’un peuple, et témoignant de cela ces œuvres parviennent à faire penser l’anomie constitutive du génocide. L’un et l’autre se confrontent à la terreur que fait régner dans leur corps et leur âme l’imagination des ruines, ruines dont ils font eux-mêmes partie alors qu’ils tentent de les regarder en face, cherchant un principe de vie et une forme d’« esprit », sinon une raison d’espérer. Car ces écrivains postés dans les ruines y cherchent aussi les traces de l’espoir. Leurs textes fébriles témoignent de démêlés intimes entre terreur et pitié, entre désespoir et espoir. C’est à cette tension que s’abreuve l’écriture, qui chez Essayan, se livre à une irrésistible logorrhée, comme si la pensée devait détailler à l’infini la réalité pour ne pas céder à la tentation de s’arrêter pile devant elle. C’est ce qui se passe pour Oshagan, dont la construction esthétique a finalement volé en éclats devant ce sentiment de terreur mué en angoisse croissante.
Cette terreur ne naît pas seulement de ce qui vient de s’accomplir, mais de ce qui continue de s’accomplir, ou de ce qui menace : chez Essayan, l’espoir politique semble vouloir faire taire le pressentiment d’une Catastrophe à venir, plus grave et définitive – que l’auteur envisageait clairement dans sa correspondance, mais qu’elle ne pouvait expliciter sans danger pour sa vie. Exilé dans les années 30, Oshagan, lui, est libre d’écrire ce qu’il veut, mais, éloigné d’une diaspora européenne dont il se sent trahi, il sait qu’il prêche dans le désert, et ce n’est pas pour rien qu’il donne un nom biblique, Paralipomènes, à son projet romanesque. Lui, c’est à la négation instituée à l’échelle mondiale qu’il s’affronte : l’Histoire, dit-il, est un « tissu de dénégations ». L’écrivain n’a pas à répondre par des « preuves », mais il aurait dû pouvoir recueillir les témoignages à l’échelle du territoire dévasté, et composer une œuvre à partir d’eux. Ces deux auteurs, lus ainsi en enfilade, nous font saisir encore quelque chose d’une forme de terreur politique qui n’est pas le génocide, mais qui l’accompagne : la loi du silence, du déni organisé. Lorsque cette loi, munie de techniques rodées de dissimulation, règle une Realpolitik internationale, le déni aggrave encore l’emprise de l’événement sur les esprits. Le témoin va contre. Mais sa parole ne peut être que terrifiée, menacée par le silence qui l’a fait naître, et qui se perpétue dans la longue durée de la négation, empêchant d’écrire l’événement au passé, le projetant sans cesse vers un futur caché.
La volonté d’anéantissement, inaugurant un nouvel ordre de possibilités humaines, produit une terreur intime d’une nature singulière, que l’écrivain éprouve et fait éprouver par un travail d’imagination concentré sur la vie survivante comme reste, mais aussi comme sursis. Lorsque se rencontrent ces deux perspectives du sursis et du reste, un effroi s’exprime dont l’objet est le temps catastrophique lui-même : un temps terrifique, mais nullement mythique, où se télescopent le passé, le présent et l’avenir, et qui structure l’imagination appliquée à la démesure génocidaire dans l’élaboration du récit de la survivance.
Cette perspective du sursis qui se superpose à celle du reste, apparaît chez Essayan et Oshagan sous deux formes bien distinctes, dont la signification historique diffère profondément. Chez la première, en 1911, l’horizon d’une disparition totale se manifeste par éclairs, en creux et en repoussoir d’un texte occupé à garder la raison malgré la folie qui gagne à la fois les acteurs du crime, les survivants et les témoins eux-mêmes. Ces afflux d’angoisse repoussés se révéleront pure clairvoyance, puisque les massacres de Cilicie furent non l’ultime « sacrifice » des Arméniens à la cause de la citoyenneté, mais l’annonce du plan d’extermination Jeune-Turc.
Chez Oshagan, la perspective du sursis, censément périmée dès lors que le génocide a eu lieu, s’exprime avec une violence imprévue dans l’après-coup de l’événement, oblitérant la démarche littéraire sous la forme d’un pressentiment qui plombe désormais le projet de raconter « L’Enfer », vécu comme menace de mort : la perspective de la disparition totale se montre comme incorporée et assimilée, transformée en catégorie de la perception. Le pire semble encore à venir, même lorsque le pire a eu lieu. Ce qui nourrit cette perception subjective des choses n’est pas un simple fantasme dû au traumatisme : si l’écrivain se dit malade ici, comme l’écriture de Essayan disait l’être en 1909, c’est que l’Histoire avec laquelle ils avaient l’un et l’autre à traiter était et allait être pour longtemps un puissant « tissu de dénégations ». La formule d’Oshagan était aussi clairvoyante que celle qui avait fait dire à Essayan en 1917, préfaçant le témoignage d’un déporté, alors qu’elle était réfugiée dans le Caucase :
On peut dire sans crainte de se tromper que parmi les atrocités universelles provoquées par la guerre, quand les sentiments humains sont émoussés presque partout en ce monde à cause des secousses dues aux malheurs quoti diens, la souffrance du peuple arménien est telle qu’elle étonnera malgré tout l’humanité en tière et qu’elle ébranlera sa conscience terrifiée. […] mais en même temps je suis convaincue que l’immensité, l’improbabilité même de ces meurtres sont telles qu’ils resteront impunis25.
Avec ces textes traduits, une documentation importante vient nourrir le dossier critique de manière à modifier nos regards sur la fameuse « littérature de témoignage ». La teneur et la forme de ces textes sont propres à nous faire vaciller dans nos réflexes de lecture, habitués que nous sommes à d’autres codes issus d’une « littérature concentrationnaire » devenue canonique pour de bonnes et de mauvaises raisons. Car un processus de canonisation ne fait pas que recouvrir et déformer ce dont il assure la sauvegarde : il restreint le terrain d’étude à un choix de textes commentés en boucle au détriment d’autres, produisant d’énormes points aveugles qui infléchissent et obstruent la réflexion sur le témoignage comme « genre » au moment où elle tend à produire des théories. Toute théorie du témoignage comme « genre littéraire » est frappée de précocité tant que n’a pas été réalisé un travail de recollection et d’exégèse qui devrait être, en toute logique s’il existe bien une « ère du témoin », trans-événementielle et internationale. Cette précocité théorique ne se laisse pas mieux voir que dans la fièvre des « philosophies du témoignage » qui recyclent des esthétiques du sublime ou des herméneutiques du pardon là où il faudrait travailler à une archéologie du témoignage, au sens historique et critique du terme.
Cette cécité ne vaut pas seulement pour les témoignages du génocide arménien. Elle s’est abattue longtemps sur un grand nombre de textes moins propices à la digestion culturelle, comme les chroniques de ghettos de l’Est et les témoignages de la « Shoah par balles », qu’on redécouvre aujourd’hui avec la constitution de Baby Yar en pôle mémoriel distinct de celui d’AuschwiT. Mais cette cécité continue de résister à la mise au jour de la production arménienne – qui, en revanche, commence d’être traduite en Turquie : le témoignage de Zabel Essayan a été édité à Istanbul en 2010 en arménien, et il y sera bientôt traduit en turc26.
==================
NOTES
- Le texte arménien a été rédigé en 1909 à Constantinople, publié en 1911, et il a été réédité plusieurs fois à Beyrouth, dont en 1957 et 1987. Sa réédition en 2010 à Istanbul (aux éditions Aras) est un fait. Dans les ruines. Les massacres d’Adana, avril 1909, traduit par Léon Ketcheyan, Phébus, 2011. Le traducteur et préfacier, Léon Ketcheyan, a consacré une thèse sur Z. Essayan soutenue à l’École des Hautes Études, qui donnait accès à sa volumineuse correspondance. Le livre comporte une postface de G. Chaliand. J’ai évoqué cette parution, ainsi que celle d’une série d’autres témoignages arméniens, dans « Aghet (1895-1909-1915). Des écrivains arméniens témoignent. Mémoire de la Turquie future », revue Raison publique, 23 avril 2011 (https://www.raison-publique.fr/article432.html).[↩]
- L’extermination des Arméniens de l’Empire ottoman s’est faite en trois étapes : – en 1895 sur le haut-plateau ; en 1909 en Cilicie ; puis en 1915-16 sur tout le territoire : rafle des intellectuels de Constantinople le 24 avril, massacres et déportations dans les déserts au long de l’Euphrate, liquidation des derniers camps de survivants, et élimination de rescapés jusqu’en 1922. Les massacres de Cilicie se sont déroulés pendant une période de mutation politique, de la dictature du sultan Abdul Hamid au régime des Jeunes-Turcs. Abdul Hamid tenta de renverser le régime issu de la révolution constitutionnelle de juillet 1908, puis fut déposé : les massacres furent officiellement imputés au mouvement hamidien dit « réactionnaire », et donnèrent lieu à des commissions d’enquêtes et des jugements truqués, mais ils furent encouragés et poursuivis par l’aile radicale des Jeunes Turcs. S’affichant libéral, le régime bascula vite dans un ultranationalisme hostile aux minorités, qui porta au pouvoir les membres du Comité Union et Progrès.[↩]
- Le terme qui désigne en arménien la catastrophe du génocide est « Aghet », le grand désastre.[↩]
- Ce livre est le troisième tome d’une trilogie critique intitulée Entre l’art et le témoignage. Littératures arméniennes au XXe siècle, Métispresse, 2006, 2007, 2008.[↩]
- « À l’Ombre des cèdres », entretien mené par Benjamin Tashian au cours de l’été 1931, a paru dans la revue Hayrenik, mars 1932, et fut repris en volume à Beyrouth en 1983 dans l’édition du Centenaire. Des extraits de cet entretien, ainsi que du roman, traduits par M. Nichanian figurent dans Le Roman de la Catastrophe, dans l’Annexe 2 (pp. 324-333 et 384-344, après un « Synopsis de Mnatsortats », pp. 309-320).[↩]
- Les massacres de 1909 furent suivis du discours secret de Talaat Pacha en août 1910 où l’historien V. Dadrian voit s’annoncer l’intention génocidaire, et qui marque le passage de la « Question d’Orient » à la « Question arménienne ». V. Dadrian, Autopsie du génocide arménien, trad. M. Nichanian, Paris, 1995.[↩]
- Je renvoie sur ce point à mon étude « Violence sacrificielle, violence génocidaire », in Corps en guerre, 1, revue Quasimodo, n° 8 (www.revue-quasimodo.org). Voir également sur le génocide « sans raison », Philippe Bouchereau, « Du génocide et de la guerre », et « La désappartenance », in revue L’Intranquille, n° 4-5, Paris, 1999.[↩]
- Marc Nichanian, La Révolution nationale, op. cit., p. 231.[↩]
- Cette deuxième phase du génocide a été restituée avec précision à partir de témoignages par Raymond Kévorkian dans Le Génocide des Arméniens, Ed. Odile Jacob, 2006.[↩]
- Dans les ruines, op. cit., p.32[↩]
- L’hypocrisie et les basses manœuvres du Patriarcat arménien qui la déléguait furent dénoncées par elle violemment dans des articles qui figurent en annexe du livre paru en France. Mais elle n’en dit rien dans son récit lui-même, ni non plus – le texte n’aurait pu être imprimé – de la tartufferie des Commissions d’enquête dépêchées par le gouvernement pour punir les coupables : elle évoque ce point en creux dans le chapitre sur les pendaisons, évoquant les Arméniens arrêtés et condamnés au prétexte qu’ils ont pris les armes pour se défendre.[↩]
- L’expression réapparaît p. 255 lorsque le témoignage d’un Juste fait reprendre un moment espoir : le « cœur » se dit « submergé de sentiments d’un genre nouveau » (p. 255).[↩]
- M. Nichanian traduit ici très différemment : « J’entendais un hululement tragique, confus, indécis, indéfini, exprimé par la totalité de ces regards encore enfantins, encore sidérés, qui n’avaient toujours pas compris ce qui s’était passé. »[↩]
- Z. Essayan fournit à Henry Barby les documents présentés dans Au pays de l’épouvante. L’Arménie martyre, Paris, Albin Michel, 1917.[↩]
- « À l’ombre des cèdres », in Le Roman de la Catastrophe, op. cit. p. 325.[↩]
- Ibid., p. 329.[↩]
- Ibid., p. 327[↩]
- Ibid., p.330[↩]
- Ibid. Le mot « pointillisme » est en français et en caractères latins dans le texte.[↩]
- Ce Panorama parut en dix volumes aux Éditions du Patriarcat de Jérusalem, puis du Catholicossat de Cilicie à Antélias, entre 1945 et 1982.[↩]
- Marc Nichanian commente en détail ce relais critique entre témoignage littéraire et témoignage philologique dans le dernier chapitre du Roman de la Catastrophe : « La critique comme témoignage », p 271-308.[↩]
- Panorama X, op. cit. p.128[↩]
- Elle a craint pour sa vie du fait des comptes rendus qu’elle publia dans la presse, en un temps d’instabilité politique périlleuse pour tous les libéraux issus de minorités non-turques, mais étant stambouliote elle ne faisait pas partie de la population ciblée à ce moment-là, quand le projet d’extermination n’était encore que dans les têtes.[↩]
- Aram Andonian, En ces sombres jours, traduit par H. Georgelin, Genève, Métispresse, 2009 ; Yervant Odian, Journal de déportation, traduit par L. Ketcheyan, Paris, Parenthèses, 2010. (Le titre initial du livre est Années maudites. Voir le compte rendu évoqué note 1).[↩]
- Z. Essayan, préface à L’Agonie d’un peuple. Les Arméniens déportés en Mésopotamie. Ce texte, transcrit par Z. Essayan à partir du témoignage oral de Haig Toroyan, a paru en février et mars 1917 dans la revue Gortz (Travail). La traduction de l’extrait est celle, inédite, de M. Nichanian.[↩]
- Comme vient de l’être le cycle de conférences qu’a prononcé Marc Nichanian à l’université Sabanci d’Istanbul sur l’ensemble des témoignages de la Catastrophe arménienne : Edebiyat ve Felaket, Istanbul[↩]
 ©bruno levy
©bruno levyCatherine Coquio
Catherine Coquio est professeure de littérature comparée à l'université Paris Cité. Elle s'intéresse particulièrement à l'étude des génocides, appréhendés sous l'angle du témoignage des survivants et de la littérature.
