Un plaidoyer de gauche pour la sortie de l’Union Européenne

Jean-Fabien Spitz se penche sur The Left Case for Brexit (Polity press, 2020) de Richard Tuck et demande si des progressistes ont encore des raisons de rester dans l’Union européenne. Sur cet ouvrage, lire également la recension de Patrick Savidan, « Brexit de gauche: Aucune île n’est une île«
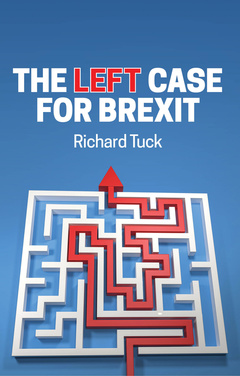
Aux yeux de l’opinion publique européenne et de la plupart des observateurs, le vote de 2016 par lequel les électeurs du Royaume Uni ont voulu la sortie de leur pays de l’Union Européenne est un témoignage de la prégnance d’une idéologie « nationaliste » et « populiste » dominée par le rejet de l’immigration et de la libre circulation des personnes. C’est aussi un témoignage de repli identitaire ennemi du progrès, d’un archaïsme qui rêve d’un retour à la souveraineté de l’État-nation, alors que celui-ci est devenu aujourd’hui profondément inadapté au développement de l’économie dans un monde globalisé, exposé aux défis climatiques et géopolitiques de notre temps.
Dans un essai publié en 2020 – qui reprend des chroniques rédigées tout au long de la saga du Brexit – le politologue anglais Richard Tuck tente au contraire de présenter ce qu’il appelle un plaidoyer de gauche en faveur du Brexit, un plaidoyer qui s’appuie sur une critique dévastatrice du projet européen ainsi que sur une réhabilitation de l’idée de souveraineté. La lecture de ces chroniques n’est pas sans intérêt à l’heure où la gauche française se déchire sur la question européenne et en particulier sur la possibilité de désobéir aux règles de l’union qui sont en contradiction avec une politique de progrès social et écologique, de renforcement des services publics, de limitation de la puissance du marché, et de réduction des inégalités.
L’objectif premier de ces chroniques aura été de convaincre la gauche anglaise que sa tentation de soutenir le vote en faveur du maintien dans l’union reposait sur une ignorance de deux idées essentielles. La première est que l’existence d’une souveraineté étatique est indispensable à une politique de progrès social, et la seconde est que les institutions de l’union européenne, loin de souffrir de ce que l’on appelle un « déficit démocratique » sont en réalité un puissant outil de dévitalisation ou d’éviscération de la démocratie1. En soutenant le maintien dans l’UE, la gauche anglaise risquait donc, selon Richard Tuck, de rejeter la seule institution qu’elle a été historiquement en mesure d’employer de manière efficace pour promouvoir ses propres objectifs de justice sociale et d’égalité, à savoir l’État-nation démocratique. Et elle risquait de l’abandonner au profit d’un ordre constitutionnel fait sur mesure pour entraver la promotion de ces buts et pour favoriser au contraire le développement du capitalisme dérégulé et des profits qu’il engendre.
Constitution et souveraineté
Des structures constitutionnelles qui sont largement hors d’atteinte des citoyens ont, dans le monde contemporain, presque invariablement eu tendance à bloquer le genre de politique radicale dans lequel la gauche avait traditionnellement placé sa confiance. Le fait central, à propos de l’UE, c’est que cette dernière crée une constitution ainsi que des structures juridiques qui en dépendent, extrêmement difficiles voire impossibles à amender ( Tuck, 16)2. Plus exactement, c’est la jurisprudence de la cour de Justice de Luxembourg qui a, selon l’expression de Dieter Grimm « constitutionnalisé les traités » et qui en a interprété les dispositions pour miner les politiques classiques de la gauche comme le soutien de l’État aux industries et les nationalisations, les négociations collectives dans le droit du travail et qui, plus largement, a obéré la possibilité même de politiques sociales étendues en faisant systématiquement prévaloir les règles de la concurrence3.
Pour Richard Tuck, les constitutions sont donc, d’une manière générale, un obstacle à la politique radicale, parce qu’elles mettent les droits fondamentaux de la propriété et du contrat hors de portée de la volonté collective et favorisent ainsi une économie dérégulée. Mais l’Angleterre a une chance de ce point de vue, dit-il, parce qu’elle n’a pas de constitution au sens propre, pas de loi fondamentale que le Parlement ne puisse amender par une loi ordinaire. C’est ce non-assujettissement du parlement de Westminster à une loi fondamentale protégeant le droit de propriété qui a par exemple permis, après la seconde guerre mondiale, la création du service national de santé. Celle-ci aurait été impossible dans un pays pourvu d’une constitution parce qu’elle exigeait une très large expropriation des hôpitaux privés. Et, dans le contexte de l’époque, la chambre des Lords s’est elle-même convaincue qu’elle ne pouvait s’ériger en tribunal suprême et juger la décision du peuple souverain au nom de principes de droit privé.
L’essence même des structures constitutionnelles comme celles de l’UE est en revanche de favoriser l’économie néolibérale et son agenda social de démantèlement de l’État providence en internationalisant la régulation de l’économie de manière à la mettre hors de portée de la démocratie4. C’est selon Tuck la position par défaut de ce genre d’institutions dont l’objet a toujours été de réprimer ce que les politiciens continentaux appellent avec dédain le populisme, c’est à dire la démocratie. C’est pour cette raison que Tuck rejette toute idée selon laquelle des politiques de gauche pourraient être promues par l’intermédiaire des institutions européennes. Pour lui, « l’union européenne n’est pas le genre d’entité politique qui peut être changée par une politique populaire car la politique populaire est précisément ce à quoi l’Union européenne est destinée à faire obstacle » (Tuck, p.23). Les mesures progressistes ne peuvent en effet être promues que dans le cadre d’un État-nation qui possède la capacité de lever des impôts et d’opérer des redistributions, mais l’union européenne est bien moins qu’un État de ce genre, tout en disposant à l’inverse du pouvoir de paralyser l’action législative et redistributive des États-nations en les faisant passer, selon l’expression de Chris Bickerton, du statut d’États souverains au statut d’États membres, limités par des règles sur lesquelles ils n’ont aucune prise, et donnant ainsi au capitalisme la possibilité d’échapper à la tutelle de la démocratie et de se procurer la liberté à laquelle il a toujours aspiré5. Dire que l’union européenne n’est pas un État, c’est affirmer qu’elle n’est pas un moyen démocratique, pour les peuples européens, de modeler leur propre destin, mais qu’elle est en revanche un système institutionnel qui est non seulement capable de rendre inopérante l’action des États et de réduire à néant le pouvoir de ce qui est pourtant le seul instrument possible du progrès social, mais qui a également été conçue dans ce but. Le projet même de l’union européenne, pour Tuck, était de délivrer le capitalisme des entraves que l’État – c’est-à-dire la démocratie politique – pourrait lui imposer et qu’il est le seul à pouvoir lui imposer (Tuck, p. 28)6. L’union subordonne ainsi en pratique l’attention aux droits des salariés à son objectif de protection de la liberté des grandes entreprises de faire leur marché entre les différents États membres à la recherche des formes les plus faibles et les moins coûteuses pour elles de protection sociale7. En ce sens, l’union n’est pas un État supranational mais un anti État, une machine de guerre contre l’État, lieu de la démocratie et outil de progrès social. Dès le début de la construction européenne (1950), il était clair qu’il s’agissait d’un projet destiné à paralyser la démocratie, à éliminer le pouvoir de décision des peuples européens et à le transférer aux forces du marché (Tuck, p. 103-104)8.
En 2016, les anglais qui souhaitaient demeurer dans l’union – et en particulier ceux qui souhaitaient y rester pour la faire évoluer de l’intérieur vers un État capable de promouvoir plus de justice sociale – n’ont pas compris que la question n’était pas de choisir une politique mais de choisir entre la possibilité et l’impossibilité de la politique. Rester dans l’union, cela signifiait en effet accepter de demeurer sous l’emprise d’une forme invisible de constitutionnalisation de règles qui rendent la politique démocratique impossible, alors que sortir de l’Union ouvrait au contraire la possibilité de remettre les questions essentielles de la vie démocratique au centre du débat et d’en faire dépendre la solution d’une décision collective : Quel statut pour des services d’intérêt général comme la santé, l’éducation, le logement ? Quelles régulations économiques ? Quelle protection de l’environnement ? Quel droit du travail ? Quels accords de libre-échange ? Quelle politique en matière d’inégalités ? La raison de cette incompréhension est que les anglais ne sont pas habitués à vivre dans une société dont les règles fondamentales sont constitutionnalisées et ne sont pas ou peu amendables. Ils pensaient par conséquent qu’il n’existait pas de choix irréversible, pas de politique sur laquelle on ne puisse revenir. Ils ne comprenaient donc pas que voter pour rester dans l’Europe signifiait se lier les mains pour l’avenir, s’en remettre à des constitutions qui ne sont pas modifiables par la volonté démocratique, puisque les traités et les règles contraignantes qu’ils comprennent – interprétées par la cour de Luxembourg – ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité des États membres. En votant pour l’Europe, dit Tuck, on ne votait pas pour une politique à propos de laquelle on pourrait ensuite changer d’avis, on votait pour la fin de la politique, pour la fin de la démocratie. On votait en quelque sorte pour qu’il ne soit plus jamais possible de voter, pour que les questions essentielles qui préoccupent les citoyens ne puissent plus être tranchées par eux, mais pour que les solutions leur soient imposées par un texte constitutionnel sur lequel ils n’ont aucun pouvoir d’amendement. Vous voulez nationaliser les chemins de fer ou le secteur de l’énergie, vous pensez que ce type de solution est plus favorable à l’intérêt général que le principe de la concurrence appliqué à ces secteurs essentiels ? C’est devenu impossible, car contraire aux principes constitutionnels contenus dans les traités européens. Mais il convient de le rappeler, la question n’est pas tellement de savoir si un monopole des chemins de fer ou de l’énergie est la bonne solution ou si la concurrence est préférable, mais elle est de savoir à qui appartient la décision. C’est le principe de la démocratie qui postule que des questions de ce genre sont des questions politiques parce qu’elles influent sur la répartition des richesses, sur le type de société dans lequel nous vivons et, en dernière instance sur le destin et la liberté des individus vis-à-vis des acteurs économiques. Or, cela a été remarqué depuis longtemps, l’union européenne s’est forgée sur l’idée que des questions de ce genre sont des questions techniques et non politiques dont la solution doit être laissée à des experts qui se fondent exclusivement sur des considérations de bien-être des consommateurs et de maximisation de la production de richesse9.
Cependant, une telle idée est doublement contestable. Elle l’est avant tout parce que le mode de régulation de l’économie est une question de pouvoir et de liberté et parce qu’il est faux de prétendre que cette régulation est neutre, qu’elle ne fait que coordonner les acteurs économiques de manière optimale sans jamais les subordonner les uns aux autres ni trancher une quelconque question de distribution de richesses ou de pouvoir. Loin de là, tous les choix en la matière sont aussi des décisions de répartition, des manières d’appuyer par la loi les positions de certains acteurs par rapport à d’autres, par exemple lorsque la cour européenne déclare que les grèves de solidarité et les boycotts sont inconstitutionnels et représentent une entrave aux règles de libre concurrence qui définissent l’Union. Il s’agit donc de choix essentiellement politiques dont la décision doit appartenir à ceux qui sont affectés par eux, et donc à l’ensemble des citoyens concernés10. Mais cette idée est contestable également parce qu’il n’est même pas certain que la concurrence la plus libre soit le plus sûr moyen de maximiser la satisfaction des consommateurs dont, au demeurant, les préférences sont endogènes au système dans lequel elles se manifestent. On comprend en effet de plus en plus que cette recherche de la maximisation du bien-être a des effets externes très coûteux, en matière environnementale et sociale, qui infirment le théorème selon laquelle il s’agit d’une « politique » dont l’optimalité serait incontestable.
Qu’est-ce en effet que l’Union Européenne ? La réponse de Tuck est sans ambiguïté : c’est un ensemble de principes constitutionnalisés : les quatre libertés de circulation – personnes, biens, services, capitaux – ainsi que la concurrence libre et non faussée. Établis dans une position qui les met hors d’atteinte des gouvernements et des législateurs nationaux, ces principes sont intégrés au système juridique de chaque pays et s’imposent à ses juridictions dans les termes – radicalement favorables au marché – dans lesquels ils sont interprétés par la cour de Luxembourg (Tuck, p. 45)11. Avalisés par les parlements nationaux – quoique pas sous la forme de principes constitutionnels qui leur a été imprimée ensuite par la juridiction de la cour de Luxembourg – ces principes ne peuvent cependant être amendés par ces mêmes instances, puisque seul un processus de négociation intergouvernementale, aboutissant à des changements qu’aucun État ne peut décider par lui-même, pourrait altérer le caractère essentiel de la structure constitutionnelle européenne. Parce qu’une telle issue – qui exigerait l’unanimité des États membres – est absolument improbable, il s’agit donc bien d’une constitution qui ne peut que très difficilement être amendée. Le seul choix c’est de la répudier entièrement.
Cela ne signifie cependant pas que les États membres aient perdu leur souveraineté car il convient selon Richard Tuck de distinguer deux sens de ce mot. La souveraineté peut désigner l’indépendance étatique et en ce sens, les « États » membres de l’Union demeurent souverains car l’Union elle-même, comme on l’a dit, n’est pas un État supranational et ne tend absolument pas à le devenir. Elle n’a pas pour objet d’exercer au niveau supranational les prérogatives de décision politique en matière de distribution des richesses et de détermination des pouvoirs des différents groupes sociaux qui caractérisent un État. Elle vise au contraire à faire disparaître ce type de prérogatives au profit d’une régulation prétendument spontanée qui n’est en réalité qu’un ordre politique dissimulé sous les oripeaux d’une régulation purement technique. Mais, et c’est le second sens de la souveraineté, la forme d’État « souverain » qui demeure sous la prise paralysante de cette machinerie constitutionnelle qu’est l’Union n’est plus tout à fait un État souverain puisque c’est un État qui est privé de la prérogative qui devrait le caractériser et qui consisterait en une possibilité démocratique de se donner les règles de son choix en matière de pouvoir, de libertés, de distribution des richesses (Tuck, p. 109-111). Les États membres n’ont pas d’autre possibilité que d’accepter la conception de la liberté en termes de droits de propriété et de contrat qui leur est imposée par les règles constitutionnalisées des traités européens. Ils n’ont pas le loisir, en particulier, de pratiquer une conception de la liberté en termes de non domination, qui ambitionnerait de limiter le pouvoir que la propriété et les règles de contractualité et de concurrence permettent à la richesse concentrée d’exercer sur l’ensemble des citoyens et sur leurs choix d’existence. Ils n’ont pas le loisir non plus de reformuler les droits des individus de manière à y inclure des droits sociaux – à la santé, à l’éducation, au logement – ni la garantie de l’accès à ces biens fondamentaux qui caractérisait par exemple la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Comme des travaux récents l’ont montré, l’inspiration conservatrice de la convention européenne des droits de l’homme – qui est significativement en retrait par rapport à la déclaration Universelle – a été au demeurant marquée dès son origine par ce refus délibéré12.
Richard Tuck plaide par conséquent pour un retour à une politique réellement démocratique qui ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un État muni des prérogatives essentielles à ce type de réalité institutionnelle. Les conservateurs peuvent alors proposer des mesures conservatrices axées sur la prévalence de la propriété et du marché, et les progressistes peuvent proposer des mesures destinées à contenir le pouvoir de la propriété et de l’oligarchie, à limiter la contractualité en conférant des capacités de négociation collective aux salariés, et en imposant aux acteurs économiques l’internalisation des coûts que leurs entreprises imposent à l’environnement et à la société. Les stratégies destinées à mettre les décisions de ce genre hors de portée de la volonté collective – sous le fallacieux prétexte que l’objectif en fonction duquel elles doivent être prises ne souffre aucune discussion et qu’elles relèvent donc d’une expertise technique consistant exclusivement à calculer les moyens optimaux pour arriver à une satisfaction maximale des préférences des consommateurs – ont en réalité pour objet de dépolitiser et de constitutionnaliser les solutions conservatrices. Le résultat de l’appartenance à l’UE, selon Tuck est que les solutions progressistes à ces débats sont tout bonnement impossibles, parce qu’elles sont contraires à des dispositions constitutionnelles dont la cour de justice est la gardienne.
Il est beaucoup question, dans ce contexte, d’un déficit démocratique de l’Union que l’on souhaite pallier par une augmentation des pouvoirs du parlement européen (Tuck p. 133). Mais ce déficit n’est pas dû à ce défaut de pouvoir des parlementaires. Il est dû au fait que les principes directeurs de l’UE sont enfermés dans des traités qui ne peuvent, en aucune circonstance, être modifiés et dont l’interprétation est entre les mains d’une cour qui échappe à toute espèce de contrôle politique (les citoyens européens, dit Tuck, seraient bien en peine de citer le nom d’un seul des juges qui siègent dans cette cour, alors qu’une bonne partie de leur existence quotidienne dépend de ses arrêts). Le parlement européen, quel que soit le mode de son élection et quels que soient les pouvoirs dont il disposerait en matière de législation, demeurerait impuissant à changer ces règles constitutionnelles comme à contourner les jugements de la cour de Luxembourg en votant de nouveaux textes de loi. Aux États-Unis, en revanche, la nomination des juges de la cour suprême est une procédure publique qui demeure sous le contrôle du législatif et il existe des possibilités d’amender le texte constitutionnel dans les cas où la position du juge constitutionnel serait en opposition ouverte avec la volonté du peuple réaffirmée avec constance et détermination. Aujourd’hui, par exemple, il serait possible d’introduire dans la constitution des États Unis un amendement protégeant le droit à l’avortement pour contrer la position que la Cour suprême s’apprête à prendre, et certains analystes ont même affirmé que la procédure d’amendement ne se limitait pas nécessairement à celle qui est prévue à l’article 5 et qui prévoit le concours d’une partie des pouvoirs constitués. L’article 5, selon eux, décrit seulement une manière possible – mais non exclusive – d’amender la constitution qui pourrait aussi être amendée, par exemple, par un referendum national13. Mais en Europe, de tels amendements sont quasiment impossibles puisqu’ils supposeraient la révision des traités à l’unanimité des États membres.
Le danger de la constitutionnalisation est donc de fossiliser les attitudes culturelles et idéologique non seulement d’un moment donné mais aussi d’un groupe social spécifique celles des rédacteurs de la constitution, et de mettre ainsi à l’abri de toute volonté collective des principes qui devraient au contraire, parce qu’il s’agit de principes politiques qui commandent la vie et la liberté des individus, demeurer exposés au débat public démocratique : « Ceci signifie, écrit-il, que des groupes dont les intérêts sont dans un certain sens en phase avec les intentions originelles des auteurs de la constitution deviennent des intérêts privilégiés parce qu’ils ne peuvent plus être remis en question. Parce que le capitalisme en tant que système s’accorde par exemple parfaitement avec un régime de défense vigoureuse de la propriété privée, les constitutions modernes penchent nettement du côté opposé à une politique de gauche » (Tuck, p. 161). Cela peut être d’une importance mineure lorsqu’il est possible de modifier la constitution assez aisément, mais cela devient préoccupant dans un contexte où l’amendement de la constitution est quasiment impossible comme c’est le cas en Europe. Et Richard Tuck rappelle que, au XXième siècle, les avancées sociales ont été le fait de mouvements politiques démocratiques non entravés par des règles constitutionnelles (Tuck, p. 72-73).
La souveraineté n’est pas capable de protéger les minorités ?
On a souvent suggéré que la limitation de la souveraineté de l’État – y compris et peut être surtout de l’État démocratique – par des principes constitutionnels quasiment impossibles à amender serait plus en mesure de protéger les droits des minorités qu’un État pleinement démocratique. La constitution allemande, qui proclame que certains droits son inamendables et qui, au demeurant, ne tient pas sa légitimité d’une ratification populaire, est censée illustrer ce principe, et la vulgate veut qu’un régime d’omnicompétence du Parlement comme celui qui existe en Angleterre soit incompatible avec une vigoureuse défense des libertés civiles. L’exemple anglais prouve au contraire, selon Tuck, que l’on peut très bien, en l’absence de principes constitutionnels élevés au rang de normes très difficilement amendables, associer un régime de toute puissance du mécanisme démocratique et une société tolérante vis à vis des minorités. Pour Tuck, c’est précisément l’omnicompétence du Parlement qui, en Angleterre, a nourri une culture politique très attachée à la défense de libertés civiles, et c’est parce que les citoyens ont eux-mêmes voulu l’institution des droits et des libertés individuelles, parce qu’ils ne leur sont pas imposés par un texte qui serait inaccessible à leur volonté, qu’ils en saisissent la portée –mais aussi la fragilité – et qu’ils sont déterminés à les défendre. Dans un système comme celui-ci, il n’y rien de gravé dans le marbre, rien qui soit définitif, aucune victoire qui ne soit susceptible d’être inversée et qui n’exige par conséquent une attention de tous les instants à en préserver les fruits : « Contrairement à ce que les gens supposent souvent, écrit Richard Tuck, la démocratie est en réalité un moyen de la paix civile et de la tolérance et non pas en opposition potentielle avec elles. Le fait d’amener le plus grand nombre possible de personnes dans la sphère de la décision politique et de leur allouer autant de liberté que possible pour déterminer le résultat a pour effet de calmer les passions politiques au lieu de les enflammer » (Tuck, p. 108) . Ce qui, en revanche, enflamme le mépris des droits et les passions que l’on appelle aujourd’hui « populistes », c’est le sentiment de dépossession qui anime les citoyens lorsqu’ils sont privés du pouvoir de décider par eux-mêmes. Les peuples privés d’expression démocratique finissent en effet par se retourner contre les minorités qu’elles croient voir bénéficier de structures politiques non représentatives, et cela avec une plus grande âpreté que ce ne serait le cas si les mécanismes démocratiques fonctionnaient efficacement. Plus on tente de limiter les mécanismes démocratiques pour instituer des droits protecteurs des minorités, plus les citoyens se retournent contre ces mêmes minorités pour leur faire payer le prix de leur propre impuissance, en sorte que le procédé est contre-productif. D’une manière générale, plus on vide les procédures démocratiques de tout contenu, plus le populisme progresse. Plus on tente de protéger les droits des minorités en recourant à des procédures contre majoritaires, plus la majorité se raidit parce qu’elle se sent dépouillée de son pouvoir et plus et se retourne contre les minorités elles-mêmes(Tuck, p. 69). La démocratie, c’est-à-dire l’inclusion des citoyens dans le processus de décision, a en effet pour conséquence de métaboliser la violence, tandis que le discours moral sur les droits de l’homme n’a aucun impact de ce point de vue et tout le monde sait bien que les droits qui nous sont garantis par d’autres que nous-mêmes n’ont aucune valeur.
La question de l’avortement est emblématique à cet égard selon Richard Tuck. En Angleterre, le droit à l’avortement a été établi par un acte du parlement qui peut être inversé à tout moment. Si cette inversion n’a pas lieu, c’est qu’il est indubitable que les anti-avortement ne sont pas en mesure de mobiliser pour cela une majorité parlementaire représentant une majorité de citoyens, et qu’ils acceptent leur défaite. En revanche aux États unis, les adversaires du droit à l’avortement ont l’impression que la décision a été prise par une élite de juges non démocratiquement élus et cela enflamme leur opposition (Tuck, p. 110). Dépolitiser une question et la déplacer sur le plan judiciaire n’est donc certainement pas la meilleure manière de la rendre moins brûlante. On est au demeurant en droit de penser que la manière dont, en France, les juges disposent d’une législation qui leur permet de pénaliser les propos racistes et xénophobes de certains artistes ou hommes publics est loin d’être la meilleure manière de calmer les passions dont ces propos sont le reflet. Cela donne aux citoyens le sentiment que c’est une élite non élue qui a le droit de décider à leur place ce que l’on peut dire et ce que l’on ne peut pas dire, et surtout, qu’on ne peut pas dire ce qui déplait à cette élite au moment même où le président de la république a le droit d’insulter publiquement une partie des citoyens14.
Accepter ou partir. La raison du déclin de la social-démocratie
Pour Richard Tuck, la situation de l’Union au moment du vote sur le Brexit était claire : il n’existait aucune possibilité d’une transformation interne de l’Union en vue d’y promouvoir des politiques sociales plus égalitaires et d’y contenir le pouvoir de la propriété. La raison en est facile à comprendre. La jurisprudence de la cour de Luxembourg a conféré aux traités une valeur constitutionnelle, et ces traités consacrent des principes incompatibles avec des politiques sociales égalitaires. La conséquence est qu’une majorité progressiste au parlement européen pas plus que l’accès d’une telle majorité au pouvoir dans une majorité d’États membres ne permettrait de faire sauter le verrou des traités constitutionalisés, lesquels ne pourraient être amendés que par une impossible unanimité des membres de l’Union. Il était donc vain de prétendre demeurer dans l’union pour la réformer de l’intérieur comme le souhaitait une partie de la gauche travailliste. « Pour l’essentiel, écrit Tuck, l’UE est un ordre juridique dans lequel les décisions les plus importantes sont prises par une cour qui interprète une constitution, car le traité de Lisbonne est une constitution ». A cet égard, l’Union a quelque chose de commun avec les États Unis même si sa constitution, « parce qu’elle a été créée pour sanctuariser une certaine forme de société de marché et non pour façonner un État, sa constitution a, sur le plan économique, des conséquences bien plus importantes que la constitution des États Unis » (Tuck, p. 147-148). Il y a cependant entre la constitution de l’UE et celle des États Unis, deux différences essentielles. La première est que, aux États Unis, les problèmes que pose la constitution, l’obstacle qu’elle peut représenter pour certaines politiques, la question de la nomination des juges, la possibilité de réformer la constitution etc. , sont des problèmes connus et publiquement débattus, alors qu’en Europe, personne ne connaît les juges de la cour, personne ne sait comment ils sont nommés, personne ne discute de leurs opinions. Et la seconde est que, depuis les Pères Fondateurs, l’interprétation de la constitution américaine est l’objet d’un débat permanent parce que, si certains y voient une défense en bonne et due forme de l’ordre propriétariste, d’autres la lisent comme un document qui subordonne les règles de fonctionnement de l’économie à la promotion et à la préservation d’une liberté de forme républicaine. Dans un ouvrage récent, William Forbath et Joseph Fishkin reconstituent cette tradition de lecture en montrant que la constitution américaine est avant tout un document anti-oligarchique et qu’elle fait obligation à l’ensemble des organes du gouvernement, et pas seulement à la cour suprême, de lutter contre une concentration du pouvoir économique qui se transforme en pouvoir politique de domination, de promouvoir l’accès de l’ensemble des citoyens aux conditions de vie décente qui caractérisent la classe moyenne, et d’assurer l’inclusion des minorités dans ce mouvement15.
Mais en Europe, une telle lecture de la constitution est radicalement impossible et la voie de la réforme des institutions est quasiment fermée. C’est la rançon d’une différence majeure avec les États-Unis. En Amérique la constitution est avant tout le signe que le peuple est souverain et que sa volonté l’emporte sur celle des pouvoirs constitués. En Europe, elle est avant tout le signe du contexte conservateur dans lequel elle a pris naissance et qui se caractérise au contraire par une méfiance viscérale à l’égard de la démocratie ainsi que par la volonté d’élever des principes de droit privé au-dessus de toute volonté collective. Lors de sa première adresse inaugurale, Abraham Lincoln posait la question suivante : « Pourquoi n’aurions-nous pas confiance dans le fait que, en dernier ressort, le peuple est juste ? Existe-t-il au monde un espoir qui soit meilleur que celui-ci, ou qui lui soit égal ? » Ce n’est manifestement pas dans cet esprit que l’Union Européenne a été fondée.
La conclusion de Tuck est limpide et elle devrait interroger ce que l’on appelle aujourd’hui en France la gauche de gouvernement pro-européenne : les contraintes constitutionnelles européennes étant à la fois solidaires et quasiment inamendables, un État peut certes les rejeter en bloc, mais il ne peut pas amender une disposition qui ne lui convient pas comme il pourrait le faire dans une constitution nationale (Tuck, p. 92) . La seule manière de rompre le statu quo, c’est de rejeter l’appartenance à l’union. Mais s’il faut l’unanimité des États membres pour changer les principes constitutionnels européens, et si cette unanimité est hautement improbable, voire impossible, en quoi l’union peut-elle servir à avancer des objectifs progressistes ? Et si, par le plus grand des hasards, cette unanimité se produisait, en quoi l’union serait-elle nécessaire ? Les partisans de gauche du vote remain – qui, lors du vote sur le Brexit, entendaient demeurer dans l’union en la réformant – auraient donc dû dire clairement s’ils jugeaient que rester dans l’union valait que l’on sacrifie toute politique progressiste et quelles étaient les raisons qui leur paraissaient justifier ce jugement, au lieu de prétendre que ce sacrifice n’était pas nécessaire (Tuck, p. 149) . Quels sont exactement les avantages apportés par l’union aux citoyens européens qui pourraient légitimer l’abandon du progrès social ? La défense des droits personnels ? Mais pourquoi prétendre que les États sont incapables de les protéger aussi bien que l’Union elle-même et, au demeurant, l’UE tolère des violations ouvertes de la part de la Pologne et de la Hongrie, dans le même temps qu’elle laisse l’agence de surveillance de ses frontières extérieures malmener les droits des migrants16 et qu’elle collabore aux pratiques inavouables des américains dans leur lutte contre les « ennemis combattants »17. Quant à la croissance économique et aux progrès du bien-être ils n’ont jamais été aussi anémiques que depuis le traité d’union économique et monétaire.
C’est précisément parce qu’ils ne sont pas capables de justifier ce sacrifice ou d’expliquer pourquoi il n’est pas nécessaire que les partis sociaux-démocrates européens connaissent un déclin irrémédiable. Ils ne comprennent pas que, parce que la logique des institutions européennes interdit en pratique tout amendement des traités, que le jeu politique dans les États membres ne permet plus que deux positions : l’adhésion sans restriction à l’ordre propriétariste ou le rejet radical de l’Union. La constitutionnalisation des principes du marché explique donc la disparition des partis sociaux-démocrates : leur existence est devenue inutile puisque la politique qu’ils sont censés proposer est impossible dans le contexte européen. Il a fallu, dit Tuck, une génération pour que cette conséquence soit tirée, mais, en fin de compte, la logique des structures de l’UE a fait son effet et reconfiguré la politique du continent : d’un côté des partis qui souscrivent au consensus et, de l’autre, des partis anti-système qui prônent la sortie de l’Union ou la désobéissance à ses règles lorsqu’elles font obstacle à une politique de progrès social. A l’intérieur des règles européennes, une seule politique est possible – la preuve en est que les socialistes l’ont maintenue lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir en France en 2012 – en sorte que ceux qui rejettent cette politique rejoignent des partis opposés à ces règles et qui prônent une rupture avec elles.
La question de l’identité nationale
Pourquoi, demande Tuck, la gauche anglaise s’est-elle cependant montrée si hostile au Brexit ? La raison essentielle est qu’elle ne voulait pas être associée aux politiciens conservateurs qui prônent la sortie de l’Union, en particulier avec leurs positions sur l’immigration. Elle ne voulait pas être associée aux xénophobes et aux partisans du repli identitaire. Mais quelle doit être la position de la gauche sur la question de l’immigration ? Il faut tenter de comprendre que, pour beaucoup de gens, le rejet ou la peur de l’immigration est le signe du fait qu’ils ont perdu le pouvoir, que la démocratie n’existe plus. Le rejet de l’immigration est un symptôme de ce sentiment d’impuissance car, devant l’abondance de l’immigration illégale, les gens se disent que les mécanismes démocratiques qui sont censés leur donner collectivement le pouvoir de contrôler leurs conditions d’existence ne fonctionnent plus. Peter Mair avance de même, à propos des soi-disant institutions démocratiques européennes, l’idée que le spectacle de leur impuissance conduit les citoyens à douter de la capacité des institutions démocratiques d’une manière générale. Il va même jusqu’à dire que, du point de vue des institutions européennes, il aurait mieux valu ne pas avoir de parlement européen parce que le spectacle d’une démocratie sans pouvoir réel, qui fonctionne à vide, abîme le prestige de la démocratie et engendre l’idée que le peuple est de toute façon impuissant à obtenir ce qu’il veut18.
Il n’est donc pas possible de réduire cette peur et ce rejet sans remédier à ce sentiment très bien fondé de dépossession, sans redonner à l’électorat populaire la conviction que les questions de ce genre, comme toutes les questions importantes, seront décidées démocratiquement et non par des experts cachés dans des constitutions dont le but est de réduire la démocratie à une apparence. La lucidité veut donc que l’on dise clairement que le populisme et la xénophobie sont engendrées par ce que Peter Mair a appelé « the hollowing of democracy », l’évidement ou l’éviscération d’une démocratie dont il ne reste que les signes extérieurs. Selon Tuck, il est inutile et absurde de moraliser sur les programmes de l’extrême droite xénophobe et tout aussi absurde de lui opposer des arguments fondés sur des principes de droit. Ces arguments sont impuissants car les tentations racistes, xénophobes et identitaires sont la conséquence de la dépossession démocratique et de la conviction que les questions essentielles ne sont plus du ressort des citoyens eux-mêmes, mais qu’elles sont tranchées par des experts et des technocrates au nom du dogme selon lequel il ne s’agit pas de questions politiques mais de questions purement techniques où les buts ne sont pas en discussion – il s’agit d’optimiser le fonctionnement du marché et de maximiser la satisfaction des consommateurs – et où seuls les moyens doivent être étudiés en recourant à l’expertise19. Ce qui fait le lit du « populisme », ce sont des institutions qui privent le peuple de la maîtrise de son destin, et ceux qui pensent qu’il est judicieux de s’abriter derrière des remparts constitutionnels dont l’objet avoué est de mettre la démocratie – et ce qu’ils appellent le « populisme » – à distance pour faire barrage à l’extrême droite se trompent.
C’est une leçon qu’il conviendrait d’essayer de retenir : plus on tente de contenir des mouvements politiques qui s’affirment ennemis des droits individuels par des moyens constitutionnels ou culturels, c’est à dire par le dénigrement consistant à accuser ces mouvements d’être fascistes, de cultiver la nostalgie du passé et un nationalisme dépassé, d’être fermés au progrès et aveugles aux vents de la mondialisation, plus ces mouvements se renforcent. Leurs partisans se voient en effet confortés dans leur conviction qu’ils sont l’objet d’un mépris, qu’on se défie de leurs capacités civiques et qu’on veut les déposséder de toute possibilité de peser sur les décisions les plus importantes qui les concernent et affectent leurs existences, approfondissant ainsi une dépossession démocratique qui est à l’origine de leur sécession. (Tuck, p. 39). En d’autres termes, plus on tente de faire obstacle au racisme et à la xénophobie par des moyens judiciaires, plus on met en avant l’idée que la constitution interdit toute expression directe du pouvoir souverain du peuple, plus on alimente ces idéologies qui sont nourries par l’idée que les décisions sont prises derrière des portes closes par des juges ou des experts mais pas par le peuple.
Le socialisme dans un seul pays ?
L’argument essentiel des gens de gauche qui sont opposés à toute rupture avec l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme, est qu’il ne peut exister d’issue nationale aux questions sociales, que l’idée qu’un pays seul puisse disposer ainsi d’une véritable souveraineté sur lui-même et imposer ses propres solutions en matière économique et sociale est une utopie en raison de l’intégration économique mondiale (les règles de l’OMC, la convention européenne des droits de l’homme demeurent de toute manière des contraintes etc)20. Les partisans de cette thèse se disent eux-mêmes réalistes pour affirmer qu’une politique progressiste telle qu’elle a été mise en œuvre en Angleterre et dans d’autres pays européens après la seconde guerre mondiale a cessé d’être possible en raison de l’ouverture des frontières et de l’intégration économique.
Richard Tuck fait cependant remarquer que, après la guerre, la Grande Bretagne n’était pas isolée, pas plus que les États nordiques lorsqu’ils ont construit leurs systèmes de protection sociale. Est-ce qu’il est impossible aujourd’hui d’avoir un système d’États interdépendants mais indépendants les uns des autres et maîtres de leur politique en matière de distribution des richesses et de structuration des rapports de pouvoir21 ? Les partisans de l’intégration européenne ne cessent au demeurant de souligner l’utilité de l’union qui a permis, dans la crise sanitaire, de réaliser des achats groupés de vaccins et qui permet, dans la crise ukrainienne, d’affronter en commun les problèmes d’approvisionnement en énergie. Mais ces avantages pourraient être obtenus par une coopération entre États indépendants qui ne seraient pas tenus par les règles d’une constitution européenne dont les articles ne sont quasiment pas amendables. De même que l’on a indument solidarisé la défense des droits personnels et celle des droits économiques de propriété et de contrat dans une constitution qui rejette les droits sociaux, on solidarise indument la nécessité d’une action coordonnée pour affronter des problèmes que les États isolés sont incapables de résoudre – les problèmes géopolitiques, les pandémies, l’action contre le réchauffement climatique – et des règles de fonctionnement de l’économie qui devraient relever de la compétence de chaque État.
Ce qui est certain, dit Tuck, c’est que, si une plus grande justice sociale et une plus grande égalité doivent attendre un État mondial ou même un État européen, elles peuvent toujours attendre, et ceux qui se réclament de cette forme de progressisme sont invités à abandonner leur conception de ce que doit être une société pour être légitime, car il n’existe aucun chemin envisageable vers le but auquel ils aspirent, à savoir une promotion des objectifs de justice par les instances supranationales que sont les institutions européennes. C’est cette espérance qui est une véritable utopie irréaliste alors que l’idée d’utiliser les institutions démocratiques nationales pour instaurer une politique progressiste est sans doute une utopie beaucoup plus réaliste (Tuck, p. 38).
Cette difficulté oblige toutefois à affronter une question de fond. Si l’Union européenne, et au-delà, l’ensemble des phénomènes de globalisation et d’ouverture des frontières impliquent la mort de l’État comme outil de structuration de la société en fonction de critères de justice et de légitimité, et si cette forme d’ouverture apporte à la fois des avantages matériels douteux – en raison de leurs effets externes sur l’environnement naturel – et si inégalement répartis que cela entame la légitimité de la régulation sociale qui les produit et la cohésion des sociétés, pourquoi y persister ? Surtout quand le prix à payer est cet évidement de la démocratie comme forme de pouvoir qu’une collectivité exerce sur elle-même auquel nous assistons aujourd’hui. Faut-il accepter cette mort de la politique comme activité de choix raisonné entre des finalités alternatives, et comme recherche d’une forme d’affranchissement de l’existence humaine par rapport aux pouvoirs publics et privés qui tendent à la dominer ? Faut-il accepter cette redéfinition qui conduit à une démocratie sans demos, où le peuple acteur de son destin a disparu pour laisser la place à des individus munis de droits abstraits qui ne garantissent en rien leur indépendance et les assujettissent au contraire au pouvoir de l’oligarchie et de la propriété ?
==================
NOTES
- Cf. P. Mair, ‘Popular Democracy and the European Union Polity » in Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy, Londres, Verso 2013. P. Mair entreprend de montrer que le projet de démocratisation des institutions européennes est une contradiction dans les termes parce que, selon lui, si l’Europe était susceptible d’être démocratisée au sens conventionnel de ce terme – c’est-à-dire en se fondant sur la souveraineté du peuple – elle ne serait plus du tout nécessaire. Selon lui, les institutions de l’UE reposent en effet sur l’idée que la démocratie en son sens classique (la démocratie définie par la politique électorale, par l’origine du pouvoir) est devenue obsolète et incapable, en raison de son caractère partisan, de résoudre les problèmes qui se posent à la fois dans le long terme et sur une échelle bien plus vaste que ceux que devaient résoudre les États Nations. Le projet européen, tel qu’il est devenu aujourd’hui, serait donc de dépasser la démocratie classique, et de lui substituer une forme de gouvernement qui se définit comme démocratique en raison des résultats auxquels elle est en mesure d’aboutir. Seule cette « démocratie » non électorale, abritée des passions partisanes et fondée sur l’expertise serait, selon cette approche, capable de promouvoir le bien commun, d’avoir une cohérence à long terme et de régir un ensemble continental où la complexité des problèmes à résoudre excède par principe les capacités de la démocratie au sens classique du terme. [↩]
- Cf J. Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999; id. Law and Disagreement, Cambridge University Press, 1999 id. ‘Constitutionalism, A skeptical view’ in Political Political Theory, Harvard Uiversity Press, 2016. [↩]
- D. Grimm, The Constitution of European Democracy, Oxford University Press, 2017; F. Scharpf, ‘The double asymmetry of European integration: Or: why the EU cannot be a social market economy’, MPIfG Working Paper, No. 09/12, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne; M. Wilkinson, ‘Authoritarian Liberalism in Europe: A Common Critique of Neoliberalism and Ordoliberalism’ Critical Sociology, 2019, vol. 45, p. 1023-1034; id. ‘Authoritarian Liberalism as Authoritarian Constitutionalism’, in H.A. Garcia et G.Frankenberg,(eds.) Authoritarian Constitutionalism. Comparative Analysis and Critique, Edward Elgar Publishing, 2019. [↩]
- Un projet que F.A. Hayek a théorisé dès 1939 dans « The Economic Conditions of Interstate Federalism », in Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, 1948, p. 255-272.[↩]
- C. Bickerton, European Integration: From Nation States to Member States, Oxford University Press, 2012 [↩]
- C. K. Sabeel Rahman, Democracy against Domination, Oxford University Press, 2016.[↩]
- Cf. P. Dietsch, Catching Capital. The Ethics of Tax Competition, Oxford University Press, 2015.[↩]
- Tuck, p.104 : “It is the disenfranchisement of european peoples and the enfranchisement of market forces “.[↩]
- Cf. G. Majone, Majone, Giandomenico, Temporal Consistency and Policy Credibility: Why Democracies Need Non-Majoritarian Institutions, EUI. Working Paper, RSC n° 96/57, Badia Fiesolanan 1996; A. Moravcsik, On Democracy and Public Interest in the European Union, in W. Streeck and Renate Mainz, eds, Die Reformierbarkeit der Demokratie. Innovationen und Blockaden, Frankfurt, 2002 (avec Andrea Sangiovanni). [↩]
- A. Follesdal, et S. Hix, ‘Why there is a democratic deficit in the EU? Response to Majone and Moravcsik’, Journal of Common Market Studies, vol. 44, n°3, 2006, pp. 533-562 [↩]
- Cf. P. Anderson Ever Closer Union? Europe in the West, Verso, Londres, 2021 qui conteste que les traités aient réellement autorisé l’évolution qui a permis que la juridiction de la cour de justice européenne s’impose aux juridictions nationales. Il s’agit en réalité d’un coup de force judiciaire. Cf. aussi T. Horsley, The Court of Justice of the European Union as an Institutional Actor; Judicial Lawmaking and its Limits, Cambridge University Press, 2018. Dans un entretien, F. Scharpf analyse l’antagonisme entre les décisions de la cour de Luxembourg et l’idée même d’Europe sociale et il en conclut que la seule solution est de refuser d’appliquer ces décisions : ‘The only solution is to refuse to comply with ECJ rulings’ Social Europe Journal, 2008, p. 15-21[↩]
- Cf. M. Duranti, The Conservative Human Rights Revolution: European Identity, Transnational Politics, and the Origins of the European Convention, Oxford University Press, 2017[↩]
- Cf. A.R. Amar, ‘Philadelphia Revisited: Amending the Constitution outside Article V, The University of Chicago Law Review, Vol. 55, No. 4 (Autumn, 1988), pp. 1043- 1104; id., The consent of the governed, Amendment outside Article V, Columbia Law Review, vol. 94 (1994) p. 457-508.[↩]
- Cf. N. Strossen Hate. Why We Should Resist it with Free Speech not Censorhip, Oxford University Press, 2018.[↩]
- W.E. Forbath et J. Fishkin The Anti Oligarchy Constitution, Reconstructing the Economic Foundations of American democracy, Harvard University Press, 2022. Il y a au demeurant de solides arguments historiques pour étayer l’idée que cette orientation anti-oligarchique était l’inspiration essentielle des Pères Fondateurs.[↩]
- Le monde, 03/05/2022 : ‘Au large de la Grèce, comment Frontex a maquillé des renvois illégaux de migrants’.[↩]
- Cf. P. Anderson, ‘Ever Closer Union?’ London Review of Books, vol. 43, n°1 (7/O1/2021): “When America required European co-operation in renditions, EU members complied with assistance in kidnappings and supply of torture chambers on Union soil, documented and denounced by a Swiss prosecutor to the Council of Europe, without a finger being lifted by the EU to bring those responsible to book”. [↩]
- P. Mair, Ruling the Void, op. cit.[↩]
- K.S. Rahman, Democracy against Domination, op. cit., retrace, depuis le New Deal jusqu’aux années 60, la forme de gouvernance fondée sur le recours à l’expertise managériale qui s’est imposée aux États Unis en particulier dans la construction d’une forme d’État social qui, là encore, postule que la maximisation du bien-être est un objectif naturel et exclusif et qui ne se soucie ni des effets politiques de la concentration de la richesse, ni de l’inclusion des minorités dans l’accès à une forme d’existence décente.[↩]
- Cf. Q. Slobodian, Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Harvard University Press, 2018.[↩]
- Cf. R. Bellamy, A Republican Europe of States. Cosmopolitanism, Intergovernmentalism and Democracy in the EU, Cambridge University Press, 2019 [↩]

Jean-Fabien Spitz
Jean-Fabien Spitz est professeur émérite de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
