Jonathan Israel et les origines de la république moderne

A propos de : Jonathan Israel, A Revolution of the Mind, Radical Enlightenment and Intellectual Origins of Modern Democracy (Princeton University Press, 2010)
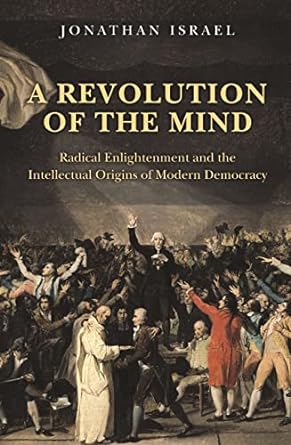
On ne peut qu’être sensible à la manière dont Jonathan Israel veut rompre avec l’orthodoxie dominante lorsqu’il s’agit de retracer les origines de la liberté moderne. Contre la vague anti-totalitaire qui a souligné les mérites de la prudence, du régime mixte, des dispositifs qui entravent le pouvoir de la majorité, exalté Burke au rang d’un auteur libéral, et suggéré que la religion pouvait être l’indispensable facteur de stabilisation des démocraties modernes, il entend en effet réhabiliter la puissance et la fécondité du radicalisme démocratique : égalité, autonomie individuelle, tolérance, séparation stricte de la religion et de l’Etat. D’après lui, ce programme intellectuel de libération universelle et radicale est en train de perdre l’hégémonie qui lui a permis d’engendrer la liberté moderne et il est urgent de lui insuffler une nouvelle vigueur en montrant quelles sont les idées qui lui ont donné naissance et quelles sont les clefs qui ont gouverné sa victoire. Face aux « différentes formes de bigoterie, d’oppression et de préjugé qui semblent inexorablement étendre leur emprise sur le monde d’aujourd’hui », ce programme est en effet la seule base sur laquelle les espoirs de libération de tous ceux qui continuent d’appartenir à des minorités opprimées pourront se concrétiser, mais il est aussi l’arme que doivent posséder et manier tous ceux qui, ayant conquis leur indépendance par rapport à toutes les hiérarchies civiles et religieuses, risqueraient de s’en voir dépouiller s’ils venaient à cesser de comprendre comment il convient de réfléchir pour la conserver.
On commence à bien connaître maintenant la thèse essentielle défendue par Jonathan Israel1 : il existe, dans les lumières occidentales, deux tendances profondément distinctes, l’une modérée et l’autre radicale. Les modérés continuent de concevoir la société humaine existante comme providentiellement instituée et donc comme fondamentalement conforme au droit ; ils excluent toute refondation radicale et plaident pour un aménagement de l’ordre hiérarchique par une injection d’une dose de tolérance et d’égalité qui le rendrait plus stable, mais ils sont convaincus qu’aucun ordre social n’est possible sur la base du refus de toute hiérarchie et de toute providence parce que l’égalité radicale est synonyme d’anarchie. Les radicaux prônent au contraire une réforme complète de l’ordre hiérarchique, l’élimination de toute idée de supériorité naturelle et de toute subordination ainsi qu’une égalité stricte étendue en particulier aux peuples non européens. A la base de cette opposition entre deux programmes politiques et sociaux se trouve une grande division métaphysique entre les déistes providentialistes – comme Locke – qui pensent qu’il ya un esprit et que tout n’est pas matière, et des spinozistes qui sont convaincus qu’il n’existe qu’une seule substance et que Dieu et la nature ne sont qu’une seule et même chose. Cette ligne de partage gouverne les attitudes sur toutes les questions qui importent : le pouvoir de la raison, la possibilité des miracles, la providence divine, l’autorité d’une Eglise, la démocratie, la liberté de la presse et la tolérance radicale. La thèse d’Israel est que, sur tous ces points, l’adhésion aux positions « progressistes » qui conduisent à la liberté moderne exige l’adoption du naturalisme et du monisme métaphysique de Spinoza. Au-delà d’un certain point, écrit-il il ne peut y avoir que deux formes des Lumières : d’un côté les lumières modérées ( deux substances ) qui postulent un équilibre entre raison et tradition et qui, globalement parlant, soutiennent le statu quo et, de l’autre côté, les lumières radicales (une seule substance ) qui fondent l’esprit et le corps en une seule entité, réduisent dieu et la nature à une seule et même chose, excluent l’hypothèse des miracles et des esprit séparés des corps, invoquent la raison comme seul guide de la vie humaine et rejettent la tradition. »2
Analysant la théorie politique de ces « lumières radicales » Israel affirme que non seulement elle pose le consentement du peuple comme seule source possible de l’autorité – aux dépens de toute tradition et de tout ordre divinement institué – mais qu’elle est aux antipodes de la fascination des républicains anglais pour le modèle de la constitution mixte qui, à ses yeux, n’est qu’une manière de corrompre le gouvernement et de sauver le principe hiérarchique sans permettre la représentations authentique du peuple3. Montesquieu n’est donc pas ici un modèle. Mais, selon Israel, d’Holbach, Diderot et leurs élèves radicaux rejettent également l’idée rousseauiste de volonté générale dans laquelle ils voient une recette pour un désastre parce que, selon eux, toute démocratie directe conduit à la démagogie. Lorsque le peuple est appelé à se gouverner lui-même, la raison est absente, et l’on ne peut compter que sur une illusoire pureté de la volonté ou des sentiments qu’il faudra préserver contre les démagogues – sans aucune garantie de succès – en recourant à la censure des mœurs et à la surveillance des opinions. Mieux vaut donc une démocratie représentative gouvernée par la raison et le débat, car elle seule pourra promouvoir une liberté conçue en termes de droits universels et non pas comme une série de franchises et de privilèges dont les Anglais sont si friands et qu’ils prennent à tort pour la liberté.
Mais la démocratie politique et civile n’est que le premier étage volet de l’égalitarisme radical car, selon Israel, les animateurs des lumières « spinozistes » auraient compris que l’égalité sociale est nécessaire à la réalité de l’égalité civile et que le marché seul – une invention intellectuelle des lumières modérées – ne peut suffire à assurer une telle égalité sociale. Sans revendiquer l’égalité complète – car ils demeurent partisans de l’idée que chacun devrait recevoir conformément à son travail et à ses talents – les radicaux souhaitent limiter la transmission de la richesse et tempérer des écarts de fortune trop préjudiciables à la liberté, tout en soulignant que les gouvernements devraient accorder une égale valeur aux désirs de tous les citoyens et se soucier également de respecter leur « droit au bonheur ». Helvétius, d’Holbach et leurs disciples auraient donc, sans être pour autant des niveleurs, plaidé pour une transformation de la distribution existante des richesses vers une plus grande équité, contrairement à des modérés comme Turgot ou Smith. Ceux-ci – en accord avec une vision demeurée providentialiste du caractère naturel des hiérarchies sociales – ne voyaient aucune objection à ce que l’égalité de droit se traduise par une inégalité de situations matérielles sans cesse plus grande mais qui, de toute manière, si toutes les barrières à la liberté du marché sont levées, sera aussi accompagnée d’une augmentation telle de la prospérité que tous, y compris les plus pauvres, y trouveront avantage.4 Les partisans des lumières radicales n’adhéraient donc pas au dogme des bienfaits sans partage de la liberté du marché, même si Diderot avait d’abord été partisan de la politique libérale de Turgot. Sous l’influence de Galiani, il voit par la suite – en 1769-17715 – à quel point les conséquences sociales de la liberté du commerce des grains pourraient être négatives en particulier parce que, dans un contexte de liberté, la puissance économique de certains acteurs leur donne un pouvoir exorbitant.
Mais c’est évidemment dans le domaine de la philosophie morale que le gouffre entre modérés et radicaux est le plus profond. Les modérés ne croient pas au pouvoir de la raison de fonder une morale et pensent qu’il convient de faire confiance à une forme de tradition, de coutume, de sentiment, d’habitude ; les philosophes écossais du sens moral sont ainsi convaincus que les idées éthique dérivent d’une faculté distincte, sens ou conscience, mais qui n’est pas la raison et rejettent toute idée de reconstruire la moralité humaine sans faire appel à cette faculté spécifique. Ils ne font qu’amplifier, selon Israel, une tendance qui existait déjà non seulement chez Hume mais aussi chez Locke à nier toute possibilité de trouver un fondement rationnel à la moralité et à privilégier au contraire, dans le domaine moral, la déférence envers la tradition théologiquement et politiquement instituée. Les radicaux, à l’inverse, naturalisent toutes les passions, se reposent sur une morale matérialiste faite avant tout du désir d’être heureux, d’une éducation qui fait l’apprentissage des conséquences, d’une raison qui calcule, et de la crainte du déshonneur et de la punition. L’intérêt et l’appétit pour le plaisir sont donc la base d’une morale qui apprend à chacun à être juste envers les autres pour que les autres le soient avec lui, et d’une politique qui enseigne que le bonheur est un droit et que la masse s’en accroît d’autant plus que la répartition en est plus égale. Rejetant tout ancrage dans la tradition ou dans un sentiment appuyé sur la coutume, ils sont en outre capables d’affirmer que l’homme est partout le même, que ses droits sont partout identiques, que la moralité n’est pas fonction des climats et des mœurs, et que l’humanité forme une seule société dont toutes les diverses parties sont les membres.6
Le schisme est donc avant tout métaphysique : unité de la substance, équation de Dieu et de la nature, refus des causes finales et de tout providentialiste, rejet de l’argument du dessein, fondation de la moralité dans les désirs, la raison calculatrice, la peur de la punition et la notion de réciprocité intéressée, tels sont les postulats de base des lumières radicales. Naturalisation de l’homme, déterminisme, refus du fixisme entre espèces et évolutionnisme, telles sont quelques-unes des inquiétantes conséquences qu’ils en tirent aux yeux des a partisans de l’ordre établi et de ceux qui, comme Voltaire, veulent limiter le mouvement des lumières à l’élite et à un toilettage des institutions hiérarchiques qui, tout en les rendant plus acceptables, demeure compatible avec un ordre social qui ne saurait supporter l’égalité radicale et la réduction matérialiste de toute moralité autonome.
D’après Israel, le triomphe de ces lumières radicales dans les années 1770 est une « révolution de l’esprit » qui a présidé au bouleversement social de la fin du XVIIIè siècle et qui en largement été à l’origine. La réalité de ce lien peut nous paraître étrange, dit-il, mais il était évident, aux yeux des contemporains que cette philosophie moderne – le spinozisme naturaliste, matérialiste et athée – était à l’origine du ferment révolutionnaire et de l’aspiration égalitaire à une société délivrée des hiérarchies, des préjugés, du pouvoir arbitraire et de l’aristocratie.7 Les lumières radicales sont donc la cause de la révolution mais aussi du tour particulier qu’elle a pris en entreprenant de détruire complètement les institutions et les idées du passé pour les remplacer par les principes nouveaux de liberté, d’égalité et de fraternité, et l’historiographie moderne repose par conséquent sur de sérieuses distorsions lorsqu’elle veut nous faire croire que, dans la période qui a précédé la convocation des Etats Généraux tout le monde était occupé à discuter la crise politique nationale dans les termes des idées traditionnelles et conventionnelles – c’est-à-dire en termes de précédents, d’institutions existantes, de ce à quoi le peuple était habitué, exactement comme dans tous les autres événements majeurs de l’époque moderne – alors que, en réalité, ce n’était absolument pas le cas . Il s’agissait en effet de bien autre chose : d’un conflit tranché entre l’ordre ancien fondé sur la tradition et la coutume, et la vision anti providentialiste, rationaliste, universaliste et égalitaire des lumières radicales.
Lorsque la révolution est venue, elle a certes proclamé la liberté et l’égalité, mais elle a été incapable, d’établir une république démocratique viable. « Robespierre et la terreur ont en totalité ou en partie, écrit Israel, discrédité la révolution aux yeux des contemporains, en France et à l’étranger, mais aussi à ceux des historiens modernes »8. Les partisans des lumières modérées ont immédiatement attribué la responsabilité de cette catastrophe à la perversion de la philosophie par les idées radicales et démocratiques ; Morellet par exemple, incrimine l’injustice de la révolution qui n’a pas respecté les droits de propriété, en particulier ceux de la noblesse et du clergé, ni le droit de représentation spéciale des élites. Mais cette explication n’est pas recevable car, selon Israel, c’est Rousseau – et non les lumières radicales – qui est responsable du dérapage de la terreur ; si la philosophie a bien inspiré les premiers pas de la révolution et repris un rôle dominant après la chute du Comité de salut public, c’est le culte du peuple et de la droiture de ses sentiments qui domine la parenthèse terroriste. On sait en effet à quel point Robespierre et les jacobins n’hésitaient pas à condamner les philosophes et les lumières, à remplacer le culte de la raison par celui de l’être suprême, à piétiner le buste d’Helvétius, à décréter l’arrestation de Condorcet ; on sait aussi que les jacobins ont rejeté la liberté de la presse, condamné le matérialisme, ridiculisé tous ceux qui méprisaient le sentiment et les préjugés du peuple ainsi que les vertus simples et le croyances ordinaires de l’homme du commun. On sait enfin que c’est Robespierre qui a le premier accusé les lumières radicales d’avoir développé une philosophie froidement calculatrice et sans âme , d’avoir ignoré les sentiments naturels et détruit ainsi ce qu’il y avait de meilleur dans l’existence humaine, à savoir la chaleur de la tradition, du sentiment partagé, du préjugé qui unit, du sentiment de la famille, de l’amitié, de la piété filiale, et du patriotisme. Ces thèmes robespierristes, qui allaient devenir le pont aux ânes des anti-lumières, sont le ferment où la terreur est venue s’alimenter et c’est bien cette forme d’anti-intellectualisme et de sentimentalisme qui a armé le bras du bourreau, pas l’excès de la raison et du naturalisme.9 Spinoza est innocent de la guillotine.
L’analyse d’Israel est séduisante mais pas sans risques10.
Pour commencer, on cherche vainement dans ce petit volume la réponse à deux questions qui paraissent pourtant naturelles : est-il vrai que les « lumières radicales » l’ont emporté sur leur concurrent modéré dans les deux décennies qui précèdent 1789 ? Et, si c’est le cas, quel est le fondement de leur succès ? Entre les lignes, le lecteur perçoit cependant une réponse assez surprenante : les lumières radicales représentaient la seule manière cohérente de penser l’alternative au maintien de l’ordre existant parce que la perception de l’injustice ne peut rester en accord avec elle-même sans se radicaliser et comprendre qu’il faut creuser jusqu’à la racine et implanter un égalitarisme total au fond de l’ordre social pour lutter efficacement contre le préjugé, l’intolérance, la superstition et la dépendance qui en résulte.11 Les demi-mesures et le réformisme finissent en effet toujours par laisser la place à une re-coagulation de l’ordre ancien et ils ont au demeurant pour fonction d’en rendre la survie possible. On doit donc comprendre qu’aucune société égalitaire ne serait née si les lumières radicales n’avaient pas triomphé, en sorte que la naissance de la société libre témoigne à elle seule du triomphe préalable des idées sans lesquelles elle était impossible. En ce sens, Israel n’a pas besoin d’apporter la preuve de la réception massive des idées radicales dans l’opinion de la fin du XVIIIè siècle car l’effet ne peut pas exister sans sa cause ; puisque les lumières modérées sont incapables de donner naissance à une société égalitaire, la réalité de cette dernière prouve ipso facto la réalité de la conversion de l’opinion aux lumières radicales qui en était la condition de possibilité.
Mais surtout, on peut avoir des doutes sur la volonté de poser qu’il existe un rapport déductif entre une conception métaphysique ( le monisme naturaliste de Spinoza ) et une série de thèses politiques démocratiques et égalitaristes qui vont jusqu’à la limitation de l’emprise du marché et à la réduction des inégalités de richesse.12 On aurait plutôt tendance à croire qu’il existe à cet égard une certaine sous-détermination et que, pour ainsi dire, il existe plusieurs chemins métaphysiques vers la liberté et l’égalité. L’idée, par exemple, que toute croyance d’ordre religieux et providentialiste est nécessairement favorable à l’autorité d’une Eglise et au maintien des hiérarchies sociales existantes est pour le moins étrange. De même on hésite devant l’idée que l’égalitarisme progressiste et démocratique est nécessairement lié à une moralité rationnelle car celle-ci, semble-t-il, peut aussi donner lieu à des théories comme celle du choix social, où les individus ne sont plus guère que des moyens les uns pour les autres. Inversement, on peut tout à fait penser qu’il est nécessaire de faire appel à un sens autonome de la moralité pour faire obstacle à cette forme d’instrumentalisation des personnes et ériger en principe le concept d’égalité comme limite à certains développements rationnels du désir, comme on est en droit de penser que l’idée morale de l’égalité de valeur est un concept distinct de tout calcul de maximisation de la satisfaction – même agrémenté du sens du compromis auquel nous sommes portés par la perception du danger des représailles – et qu’il est indispensable pour en limiter les excès. S’il y a bien une chose dont nous sommes certains à propos de John Rawls, c’est qu’il n’était pas spinoziste !
Mais l’aspect le plus problématique de la conception proposée par Jonathan Israel demeure la conception de la réalité politique dont il cherche la genèse : la liberté moderne. Qu’est-ce qu’une république démocratique aujourd’hui ? Comment définit-elle la liberté ? A lire Israel, on a le sentiment que sa réponse à cette question est la suivante : la liberté moderne se définit essentiellement par l’affirmation de la souveraineté d’un peuple composé de citoyens égaux en droit et aussi, dans une large mesure, en fait. Elle implique une stricte séparation entre le politique et le religieux, une tolérance radicale, le rejet de toute forme d’élitisme, d’aristocratie de l’argent ou autre, mais surtout une vigoureuse affirmation du principe démocratique fondée sur l’activité des citoyens, la participation à la délibération, le contrôle des représentants et le refus d’accepter que la tradition, les préjugés, les intérêts puissent faire obstacle à une politique dont l’objet doit être le bonheur du plus grand nombre. Cette politique doit par conséquent considérer que tous les citoyens ont une valeur égale – sans distinction de classe, de race ou de sexe – et que toutes les vies et toutes les finalités ont une égale importance et un égal droit d’être satisfaites. Bref une conception « illuministe » et universaliste de la liberté qui affirme que l’extension à tous des droits sociaux ou du droit d’être heureux n’est que le simple prolongement et la simple conclusion logique de la poussée égalitariste initiale et du refus de l’aristocratie.
Cette conception est tellement générale – et généreuse – qu’il est difficile de ne pas y adhérer. Mais si l’on se penche sur les ennemis que Jonathan Israel lui attribue, les choses se compliquent quelque peu.
Elle a en effet deux types d’ennemis.
D’un côté les partisans de ce qu’il appelle les lumières modérées, qui sont convaincus que la société ne peut pas être intégralement « moderne », qu’elle ne peut pas vivre sur la base de la seule raison et de l’égalité et qu’elle doit accepter une dose d’élitisme et de hiérarchie, sinon de la naissance du moins de l’argent et de l’ éducation ; cette forme de libéralisme conservateur pense que la liberté ne doit pas se confondre avec la démocratie et qu’il est nécessaire de disposer de freins institutionnels pour empêcher la volonté collective de devenir tyrannique, en particulier d’un judiciaire indépendant qui fait un peu plus que veiller à la régularité des procédures et qui est capable de froncer les sourcils lorsqu’un certain nombre de droits dont l’effet est de protéger la position privilégiée d’une élite – comme le droit de propriété ou celui de financer le parti politique de son choix – tendrait à être mis en cause.
L’autre ennemi est un radicalisme de mauvais aloi que l’on pourrait appeler post-moderniste. Comme il voit le pouvoir partout, il le voit aussi dans la raison et dans la démocratie et pense que la liberté comporte un droit d’adhérer à une communauté de sentiments – voire de préjugés – que la raison ne peut chercher à démanteler sans manifester un impérialisme indu.
Dans les deux cas, l’affirmation sans phrase de la conception « illuministe » de la liberté pose des problèmes qu’il n’est pas possible d’ignorer si l’on entreprend une recherche sur les origines de la liberté moderne.
Prenons les « lumières modérées ». La distinction entre démocratie et liberté ne peut pas être prise à la légère pas plus que la question de la légitimité des inégalités dans une société de liberté. Il est en particulier difficile de passer sous silence la question suivante : les individus sont-ils les propriétaires de leurs talents, l’égalité des chances qui donne aux plus talentueux la possibilité de se hisser à des positions très favorables par rapport aux moins doués est-elle la forme adéquate de la liberté ou est-il légitime d’égaliser aussi les résultats des qualités personnelles des individus et de ne laisser subsister, comme le propose John Rawls, que les inégalités qui ont pour effet d’améliorer le sort des moins favorisés ? Dans le premier cas, le respect de la personne et de ses qualités implique qu’elle soit soustraite à tout calcul d’utilité et qu’elle conserve des droits contre toute forme de maximisation du bonheur du plus grand nombre même sous la forme du principe de différence. Il n’est pas indispensable d’être libertarien pour penser que cette forme de respect du « caractère séparé » des individus pourrait avoir une importance dans la conception de la liberté et que l’hypothèse d’une possible tension entre la valeur de l’égalité et celle de liberté n’est pas nécessairement une pure invention des conservateurs. En revanche, on voit vraiment très mal comment cette forme de respect de l’indépendance morale de chacun pourrait s’intégrer à un dispositif intellectuel fondé sur le naturalisme spinoziste. Il est facile d’accuser Kant de ne pas être un ennemi décidé de toute forme d’autorité13, mais plus difficile d’affirmer sans preuve que la tradition intellectuelle dont il est porteur – celle qui insiste sur l’appartenance de l’homme au royaume des fins et son irréductibilité à une partie de la nature – est entièrement étrangère à la « république moderne ». Pour le dire en d’autres termes, si une partie de la liberté contemporaine consiste dans la protection qu’elle accorde à l’autonomie individuelle contre la puissance de la majorité démocratique, on peut douter que l’éducation rationnelle du citoyen qui apprend à ne pas faire à autrui ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fasse suffise à la garantir, en particulier parce que, dans un monde complexe comme le nôtre, les positions sont trop peu réversibles pour que ce raisonnement soit réellement applicable de manière universelle et les minorités trop structurelles pour que ceux qui n’en font pas partie puissent s’en imaginer membres et agir en conséquence. En tout état de cause, qu’il faille des outils intellectuels plus puissants que l’affirmation rationnelle de la réciprocité pour garantir l’autonomie de chacun est une proposition qui mérite d’être discutée, et l’on ne peut accuser ceux qui soulèvent la question de vouloir le rétablissement de l’aristocratie, du pouvoir de l’église et de toutes les formes de la déférence ancienne envers l’autorité.
Disons ensuite un mot – un seul – du radicalisme dévoyé qui constitue le post modernisme. On peut certes dauber sur sa tendance à voir partout l’emprise impériale et tyrannique de la raison et objecter à juste titre que les effets en sont souvent d’abandonner les individus aux préjugés de leurs communautés fermées, au moralisme paternaliste, au sexisme, et au sentimentalisme irraisonné qui est la porte ouverte à la manipulation et à la domination. On peut faire de Condorcet un héros et penser que l’éducation aux valeurs de la modernité rationnelle est la clef du progrès et de la liberté. Ce jugement est très sain mais il ne peut faire l’économie des objections qui lui sont adressées : les sociétés modernes n’auraient-elles pas intérêt à entretenir une petite dose de scepticisme sur leurs propres valeurs ? Le désir de domination ne se cache-t-il pas parfois dans l’affirmation de la supériorité de la raison sur les préjugés et le sentiment ? Dans le chapitre qu’il consacre à la paix perpétuelle et aux rapports entre les nations, Israel rappelle que les partisans des lumières radicales sont les premiers à avoir appelé de leurs vœux un code de bonne conduite internationale dans lequel chaque nation devrait observer les mêmes devoirs et les mêmes règles avec toutes les autres et imiter en cela le principe de réciprocité et d’égal droit au bonheur qui doit prévaloir entre concitoyens. N’est-ce pas un pieux mensonge ? Car on voit mal comment on peut entretenir des rapports d’égalité et de réciprocité avec des peuples dont on considère que les coutumes sont barbares et que l’on conçoit comme emprisonnés dans leurs préjugés et leurs idées irrationnelles. Le colonialisme a toujours justifié sa domination en disant qu’il traiterait les peuples dominés en égaux quand ils seraient enfin rationnels tout en considérant bien souvent que leur bêtise indécrassable les empêchait de toute manière de le devenir ! Ces questions se posent et on ne peut les évacuer d’un revers de main en se contentant de répéter que c’est en devenant rationnel qu’on accède à la liberté ; là encore, il n’est pas nécessaire d’être communautarien pour se demander si l’ignorance des différences est toujours favorable à la liberté de ceux qui en sont porteurs.
Certes, on comprend bien les motivations d’Israel : au début du XXIè siècle, alors que prend fin la période qui s’est ouverte à la fin de la seconde guerre mondiale et qui a vu – avec la déclaration universelle des droits de l’homme – ce qu’il pense être le triomphe intellectuel des « lumières radicales », il peut paraître indispensable de réaffirmer avec force la validité de l’idéal rationaliste, universaliste et égalitaire. Mais l’urgence de la réaffirmation de la fécondité de l’un des courants qui ont donné naissance à la liberté moderne au moment où son importance tend à être gravement minorée ne doit pas être confondue avec une analyse historique et philosophique des fondements de cette liberté ; ceux-ci sont certainement complexes et sans doute contradictoires, puisqu’ils comportent apparemment l’affirmation conjointe de la naturalité de l’homme et celle de son autonomie morale, l’affirmation de l’égalité et celle de la légitimité de certaines inégalités engendrées par l’exercice de l’autonomie de la personne. Les réalisations institutionnelles de la liberté que nous connaissons aujourd’hui sont sans doute plus le reflet d’un équilibre instable entre différents apports que l’incarnation monolithique d’une thèse métaphysique exclusive et il n’y a certainement rien à gagner à la négation de cette complexité. Les mots d’ordre ont une grande importance dans le combat politique – et l’on doit savoir gré à Jonathan Israel d’attirer notre attention sur l’entreprise modérantiste de réhabilitation de l’autorité et de minoration de la démocratie à laquelle on assiste aujourd’hui – mais ils en ont moins dans le cadre d’une analyse de la genèse intellectuelle d’un phénomène aussi complexe qu’une société qui s’essaie à équilibrer les droits de tous et l’autonomie de chacun et à laquelle tous ceux qui ont apporté leur pierre n’étaient peut-être pas des disciples du philosophe d’Amsterdam.
==================
NOTES
- Elle est développée dans les deux premiers volumes de la trilogie qu’il consacre à l’histoire des lumières radicales: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 (Oxford University Press, 2002 ; traduc. fr. Les Lumières radicales : La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750) Editions Amsterdam, Paris, 2005 ; Enlightenment Contested : Philosophy, Modernity and the Emancipation of Man, 1670-1752 (Oxford University Press, 2006) [↩]
- Jonathan Israel, A Revolution of the Mind, op. cit. p. 19[↩]
- Cf. J. Israel, “The Intellectual Origins of Modern Democratic Republicanism (1660–1720)”, The European Journal of Political Theory, 3 (2004), p. 7-36[↩]
- Israel, ibid, p. 107 [↩]
- Diderot publie l’Apologie pour l’abbé Galiani en 1771.[↩]
- Israel, op. cit., p. 185[↩]
- Israel, Ibid,, p. 49 et p. 87, cf. aussi p. 224.[↩]
- Israel, op. cit., p. 230.[↩]
- Contrairement à la thèse défendue par Dan Edelstein, The Terror of Natural Right: Republicanism, the Cult of Nature and the French Revolution (Chicago, 2009).[↩]
- On ne revient pas ici sur les nombreuses objections à la méthode historique de Jonathan Israel. Cf. en particulier A. LaVopa, A new intellectual history? Jonathan Israel’s enlightenment. The Historical Journal, 52, 3 (2009), pp. 717–738 ; A. Lilti, Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières ?. Spinozisme, radicalisme et philosophie Annales. Histoire, Sciences sociales 2009/1.[↩]
- Israel, ibid, p. 52. [↩]
- Cf sur ce point la recension particulièrement critique de Samuel Moyn, ‘Mind the Enlightenment’ The Nation, 31 mai 2010, ainsi que la réponse de Jonathan Israel, ‘Spinoza and Vultures and Gnats, Oh My!’, The Nation, 5 juillet 2010 ; S. Moyn, ‘A response to Jonathan Israel’, George Mason’s University History News network, 28 juin 2010.[↩]
- Israel, Revolution of the Mind, op. cit., p. 86[↩]

Jean-Fabien Spitz
Jean-Fabien Spitz est professeur émérite de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
