Quel avenir pour l’Etat Providence ? Une leçon américaine

À propos de: Jefferson Cowie, The Great Exception and the Limits of American Politics, Princeton University Press, 2016, 276 pages.
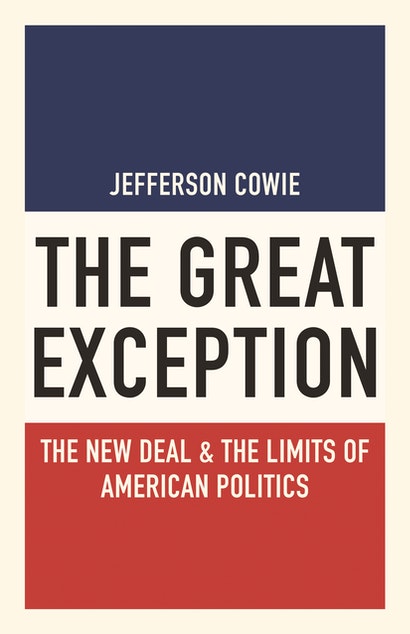
Dans The Great exception, l’historien américain Jefferson Cowie – spécialiste du monde du travail – tente d’expliquer à ses lecteurs pourquoi le mot d’ordre d’un nouveau New Deal, ou d’une réactivation de la politique sociale et économique des années 1930 et 1940, n’est pas à l’ordre du jour pour la gauche progressiste aujourd’hui. A ses yeux, le New Deal est un « hapax » dans l’histoire des Etats Unis, une exception singulière qui s’explique par des causes conjoncturelles et qui, parce qu’elle va à l’encontre des courants profonds de la culture politique américaine, ne peut être ni réitérée ni réactivée.
Parmi les arguments avancés par J. Cowie, il en est qui débordent largement le cadre dans lequel il se cantonne – la politique américaine – et qui pourraient inciter les lecteurs européens à s’intéresser à son travail pour tenter de poser la question essentielle qui devrait les préoccuper aujourd’hui : quel avenir pour les démocraties de marché ? Une fuite en avant vers le moins d’Etat, vers un surcroît de libéralisation des échanges avec, à la clef, une dégradation croissante des normes sociales et environnementales, des inégalités sans cesse moins tolérables, une démocratie corrompue par l’argent, et un risque très présent de voir ces sociétés devenir incapables de métaboliser les sources potentielles de violence qu’engendre une telle évolution ? Ou bien, seconde option impliquant l’appel à un modèle inspiré du New Deal, une tentative de réaffirmation du keynésianisme, assortie d’une consolidation des droits sociaux, d’une forte dimension écologique, d’une réduction des inégalités et d’une lutte déterminée contre l’évasion fiscale et la corruption de la politique démocratique ? Ou bien enfin, troisième option, un repli vers une politique de l’identité ethnique et religieuse doublée d’un protectionnisme économique et d’une réaffirmation de l’Etat nation, option qui risque fort d’être une issue en trompe l’œil si, comme on peut le penser, elle ressemble comme un frère à la première du point de vue des choix sociaux et environnementaux ? Pour les citoyens du vieux continent, cette troisième option signifie la mort de l’union européenne sans autre avantage tangible, puisque les effets ravageurs du néo-libéralisme sur le plan des inégalités, de la précarité, des droits sociaux et de l’environnement, seront toujours là, sans parler de la dégradation de la politique démocratique qui risque de tomber du Charybde de la corruption dans le Scylla de l’autoritarisme. Les deux autres options représentent quant à elles deux conceptions radicalement opposées de l’avenir de l’Union. On sait que les conséquences de l’option néo-libérale sont de moins en moins acceptables pour un nombre croissant de citoyens européens, à la fois sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan politique parce que l’idée même de démocratie, c’est à dire l’idée qu’un peuple doit pouvoir contrôler son propre destin, semble subir une éviscération de plus en plus affirmée. C’est la raison pour laquelle beaucoup, en France et ailleurs, rêvent d’une Union européenne qui serait comme un Etat-nation des Trente Glorieuses gonflé aux dimensions d’un continent, et pouvant même essayer d’entraîner dans son aire ses marges turque, moyen-orientale ou nord-africaine. La souveraineté des citoyens y serait réaffirmée, les inégalités maîtrisées, les droits sociaux renforcés, l’environnement protégé. Noble projet assurément mais, dans ces conditions, il vaut la peine de se pencher sur le raisonnement d’un historien qui, dans le contexte d’une culture nationale sans doute moins singulière qu’elle ne le paraît, conclut à l’impossibilité de réactiver cette option, du moins sous la forme sous laquelle nous la connaissons, où l’Etat joue nécessairement un rôle majeur.
Le premier New Deal : le poids du passé
Comment définir le New Deal ? La réponse à cette question n’est pas simple car, comme le montre J. Cowie, il y a eu en réalité deux séries distinctes de mesures sociales et économiques pour tenter de surmonter les effets de la crise de 1929. La première correspond au premier mandat de Roosevelt, donc aux années 1932-1935, et la seconde aux années 1936-1937.
Le premier New Deal est en réalité, selon J. Cowie, une série d’improvisations assez traditionnelles : une réforme du système bancaire, une législation qui limite la production agricole pour faire remonter les cours, une politique de grands travaux. La seule innovation réelle était une législation visant à stabiliser l’industrie en mettant un terme à la concurrence sauvage (le NIRA1 ) qui supposait, dans chaque branche, la rédaction d’un code bonne conduite associant les entreprises du secteur. Mesure inefficace qui a favorisé la cartellisation et qui n’a pu vaincre les résistances à toute intrusion de l’Etat dans l’économie que parce qu’il s’agissait d’un plan sans cohérence, d’une auberge espagnole où chacun pensait pouvoir trouver son compte. Certes, la loi permettait l’organisation des travailleurs et la négociation collective, mais ces droits nouveaux n’étaient pas protégés, et rien n’était prévu pour les organiser concrètement. Dans les faits, les grèves déclenchées en 1934 pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail n’ont apporté que la répression ordinaire (les injonctions, les envois de troupes etc…) sans jamais permettre de rompre avec le principe de la soi-disant liberté du travail et de l’open shop, principe qui interdit de faire de l’appartenance à un syndicat la condition de l’embauche et qui enlève aux organisations ouvrières tout poids réel dans la négociation.
Le premier New Deal était donc un faux départ. Le NIRA, en particulier, prétendait bien s’attaquer à la monopolisation de l’économie, mais il ne se donnait pas réellement les moyens de rétablir l’équilibre entre employeurs et employés. Lorsque la loi a été déclarée inconstitutionnelle par la cour suprême en 1935 (Shecter Poultry Corporation v. US) personne n’a réellement regretté cette décision, car le NIRA n’avait pas réussi à augmenter les salaires, ses codes n’ont jamais été réellement mis en application, et l’économie n’avait pas redémarré.
Cowie est convaincu que ces incertitudes ne sont pas seulement le résultat d’une certaine inexpérience et de l’improvisation qui a présidé à ces premières mesures. Même déterminés à prendre la crise à bras le corps et à trancher dans le vif, les new dealers demeuraient imprégnés des représentations sociales et politiques qui avaient marqué l’époque précédente et, pourrait-on dire, la république américaine depuis ses débuts. Or ces représentations étaient en contradiction ouverte avec l’idée que la Dépression de 1929 était une crise systémique qui appelait des remèdes collectifs et une correction centralisée des déséquilibres par le recours à l’action de la puissance publique.
Quelles sont ces représentations ? D’abord ce que Cowie appelle l’individualisme jeffersonien, à savoir l’idée qu’un régime de liberté est avant tout le produit d’un Etat qui intervient aussi peu que possible dans les interactions entre les individus, et qui se contente de garantir l’impartialité de la loi et le caractère sacré des droits de propriété et des contrats. Dans un régime de ce genre, chacun assume personnellement la responsabilité de ses actions et de sa situation, sans jamais demander à la puissance publique de compenser ses erreurs, ni même un manque de chance qui fait partie du jeu, qui stimule l’attention et l’énergie, et qui représente un risque identique pour tout le monde. Pour cette forme d’individualisme, tout appui de la puissance publique à un acteur particulier est une rupture de l’égalité et une entorse au principe du droit, et toute idée selon laquelle la société pourrait constituer un ensemble d’interactions dont les effets affectent certains acteurs indépendamment de leur volonté est exclue. Le destin et la situation de chacun sont la conséquence de ses propres efforts et de ses propres actions, et non pas l’effet structurel d’un ensemble de facteurs sur lesquels il n’aurait pas de prise. Le maître mot est ici l’indépendance, qui doit être effective pour tous, tant par rapport à l’Etat qui doit se borner à poser des règles impartiales pour empêcher la fraude et la violence, que par rapport aux autres acteurs privés, à la pression desquelles la liberté du marché, du choix de la profession, du lieu de résidence, permet toujours de se soustraire. Cet individualisme s’incarne en particulier dans l’idéal du free labor, free soil2. Le free labor, c’est le rejet de toute forme d’esclavage, de toute contrainte légale, de toute entrave à l’emploi, qu’elle vienne des employeurs ou des syndicats qui tentent d’imposer la syndicalisation et d’empêcher l’accès au lieu de travail en cas de grève. Non seulement cette idée du free labor ne permet pas de contenir la concentration économique et d’en combattre les effets de contrainte, mais elle favorise ces phénomènes en faisant du travail salarié un modèle d’activité libre par opposition aux formes de travail contraint. De même, l’idée de free labor conduit à voir l’effort pour négocier collectivement les salaires et les conditions de travail comme une atteinte à la liberté de contrat, comme une forme de conspiration illégale, et même comme une forme de saisie indue ou d’atteinte à la propriété qui réduirait le capital à une situation de servitude bannie par la constitution. Là où le capital a eu le droit de se regrouper pour agir collectivement – obtenant la reconnaissance de la corporation ou de la société anonyme comme un individu qui jouit des mêmes droits constitutionnellement protégés que les personnes physiques3) – le travail continue donc de voir qualifier ses propres tentatives de regroupement et de collectivisation comme une atteinte à la liberté du travail et du marché. Quant au free soil, c’est l’accès possible aux terres vierges de l’ouest ouvertes à la colonisation, qui permet à chacun d’échapper à terme à la contrainte de salariat et de construire une vie indépendante en accédant à la propriété. Lincoln lui-même avait expliqué au moment de la guerre civile que le salariat ne constituait pas un état durable, et qu’il devait mener pour tous à la propriété indépendante d’un champ ou d’un atelier.
Avant la révolution industrielle et ce que Alan Trachtenberg a appelé l’incorporation de l’Amérique4, cette vision d’une nation de petits producteurs indépendants échappant aux contraintes collectives d’une économie fondée sur les grandes entreprises et l’interdépendance des individus et des branches pouvait correspondre à une certaine réalité. Ce n’est plus le cas au lendemain de la guerre civile, au moment où la frontière se ferme, et où la concentration économique confère à certains acteurs une puissance de pression qui vide de sa substance l’idée que l’économie est une coexistence d’acteurs égaux, dont chacun possède toujours la faculté d’échapper à la contrainte des plus puissants que lui et de vivre dans l’indépendance. Le fait le plus surprenant est précisément, comme Jefferson Cowie le rappelle, que cet individualisme ait survécu aux conditions matérielles dans lesquelles il avait une certaine réalité, et qu’il ait persisté au sein d’une société industrialisée qui en niait la prémisse essentielle, à savoir la possibilité de l’indépendance5. Mais, comme on va le voir, cette survivance paradoxale est une partie de la réponse à la question qui nous intéresse.
Cette forme classique d’individualisme entraîne dans son sillage un anti-étatisme qui est une constante de la culture politique américaine. L’Etat, en particulier l’Etat fédéral, est par définition l’ennemi de la liberté, l’instance qui réglemente, entrave, paralyse les énergies. C’est aussi l’instance qui engendre la corruption, car plus l’Etat assume de missions, plus il aiguise les appétits des politiciens corrompus qui s’entendent à le faire fonctionner pour leurs propres intérêts et ceux de leurs clients. En revanche, moins l’Etat agit et moins il est l’objet des ambitions qui se détournent d’une institution qui n’a ni moyens ni influence. Dans le contexte du fédéralisme américain, le meilleur Etat Fédéral est donc celui qui gouverne le moins. A à cet égard, les Etats fédérés sont plus proches des citoyens, plus aisément contrôlables, et plus aisément réduits aux fonctions élémentaires auxquelles les institutions publiques doivent être cantonnées.
Outre cet individualisme anti-étatiste, d’autres éléments profondément ancrés dans la culture politique des Etats-Unis faisaient obstacle à l’idée même d’une intervention du gouvernement central pour réguler fortement l’économie et construire des droits sociaux solides. Jefferson Cowie met en particulier l’accent sur la vigueur des idées évangéliques et le sens du péché qui l’accompagne. Pour une religion ainsi structurée, les individus sont toujours responsables de leurs actions et, s’ils sont dans une situation dégradée, ils doivent incriminer leurs propres fautes et non les effets systémiques d’une forme sociale. C’est Jésus qui sauve, qui régénère les hommes, qui les remet sur le droit chemin en leur enseignant la tempérance, l’économie, le sens du travail, mais ce n’est pas l’Etat. Même les progressistes de la fin du XIXè siècle étaient touchés par cette représentation religieuse de la société. Alors que certains voudraient voir dans ces mouvements de réforme des précurseurs de l’Etat social, J. Cowie souligne à quel point les efforts déployés par ces éducateurs sociaux ont porté sur l’amélioration des individus, des conditions de logement, d’éducation, d’hygiène, bien plus que sur des réformes structurelles visant à redistribuer d’une classe à l’autre à la fois les richesses produites et les instruments de contrainte et de négociation. Les quelques ambitions de réforme du système de la concurrence qui ont vu le jour avant le New Deal visaient ainsi plus à accroître l’égalité des chances et à permettre à l’individualisme de se déployer de manière plus authentique, qu’à faire passer les Etats-Unis dans une ère post individualiste où il aurait été admis que les destins individuels sont la conséquence de leurs positions sociales et de leur place dans le système des interdépendances. De ce point de vue, l’idée qu’il existerait une sorte de progression continue de l’égalité des droits personnels à celle des droits politiques, puis de l’égalité des droits politiques à celle des droits sociaux, censée rétablir une équivalence relative des places que la concurrence tend sans cesse à détruire, est une idée à laquelle il faut renoncer. Les progressistes demeuraient ainsi, selon Cowie, prisonniers d’une vision morale fondée sur la responsabilité individuelle, qui les mettait aux antipodes de l’idée que la société doit assumer collectivement la responsabilité de ses effets et les réguler par le biais de l’Etat qui la représente6. Le New Deal n’a donc pas été le couronnement d’une marche uniforme vers une représentation post individualiste de l’existence sociale, mais une parenthèse dans une culture politique profondément marquée par le libéralisme classique.
Outre l’individualisme et la religiosité évangélique, un autre facteur faisait obstacle à la fois à la formation d’une conscience collective de ceux qui sont affectés par les effets de la concentration économique, et au regroupement des énergies derrière l’idée que l’Etat, instrument du bien commun, pourrait agir pour contrebalancer ces effets : le racisme, l’immigration, la diversité ethnique. La classe ouvrière blanche des années 1930, comme cela a été le cas depuis l’affranchissement des esclaves et comme cela continuera d’être le cas après la guerre, voit d’un très mauvais œil des avantages sociaux et des outils de négociation collective qui ne lui seraient pas exclusivement réservés. De la même manière, la superposition des vagues d’immigrants et leurs différences rendent la cohésion plus difficile, et chaque groupe installé depuis un moment voit la dernière vague à la fois comme une masse de manœuvre que le patronat emploie pour casser les salaires, et comme une horde sale et déguenillée – non américaine – qui importe dans cette terre de vertu les vices du vieux continent, la débauche, l’alcoolisme, la paresse, les maladies. Qu’une nation d’immigrants ne soit pas la mieux placée pour unir tous ceux que la concentration de la richesse et du pouvoir affecte négativement et qu’elle ait, plus que d’autres, une tendance à laisser se diluer la « conscience de classe » en « conscience de race » – pour reprendre l’expression de Cowie – n’a rien pour nous étonner7. Mais cette dimension nous aide à comprendre pourquoi, aux Etats Unis, la conscience commune qu’il pourrait exister des intérêts collectifs du monde du travail, et dont ce dernier pourrait confier la défense à une puissance publique, a été constamment battue en brèche par les loyautés partielles des individus envers leur race et leur religion. Elle nous aide aussi à comprendre pourquoi, dans une nation ethniquement diverse, la tentation est grande d’imputer au groupe le plus faible la responsabilité des difficultés rencontrées par tous ceux qui sont exposés aux pressions du capital et aux effets des crises qu’il engendre.
Individualisme, anti étatisme, évangélisme, racisme identitaire, rejet de l’immigration, autant d’obstacles à la coagulation d’une action collective et publique pour réguler le régime de la liberté économique et de la concurrence sauvage. Il aura fallu l’approfondissement de la crise et l’inefficacité du premier New Deal pour que les Etats- Unis se résolvent à faire l’essai de méthodes plus radicales profondément étrangères à leur tradition, mais avec combien de réticences et combien d’arrières pensées ?
Le second New Deal : les conditions de possibilité
Le second New Deal est en effet, selon Cowie, le produit des circonstances plutôt que le résultat d’un mouvement continu de la société vers une prise de conscience de la réalité des interdépendances, de l’illusion individualiste, et de la nécessité d’une gestion collective d’une économie d’essence systémique8. Certains au moins des membres de l’équipe qui entourait Roosevelt, dit-il, demeuraient profondément rétifs à cette idée de faire intervenir l’Etat pour produire de la liberté, ou à l’idée que les travailleurs en tant que classe pourraient avoir un intérêt commun contre le business. Il a donc fallu, pour impulser une redistribution des richesses, et pour mettre enfin en œuvre une réelle action collective organisant effectivement les droits des salariés et leur permettant de peser dans les négociations au sein des entreprises, surmonter l’ancien individualisme dont John Dewey avait pourtant dénoncé le caractère obsolète dès 19309.
Pour essayer de repenser la place de l’individu dans la nouvelle société industrielle, le premier impératif était d’abandonner la tradition anti-monopoliste, d’oublier le fantasme du retour à la petite propriété grâce au démantèlement des trusts. Contre le courant profond de la culture politique américaine – qui ne voit de salut que dans une restauration de l’indépendance des petits producteurs et donc dans une lutte contre le Big Business – Roosevelt avait compris que les grandes entreprises étaient là pour rester et qu’il ne s’agissait plus de les démanteler, mais de les réguler en essayant de limiter leurs capacités de pression sur le marché et sur les salariés.
Le second impératif était d’abandonner toute idée de réduire l’Etat Fédéral à un rôle de gardien de la propriété et des contrats pour lui confier une fonction active de régulation des équilibres. Il fallait donc rompre avec l’idée que toute intervention de la puissance publique constituait une atteinte à la liberté, une manière de conférer des privilèges indus à certains groupes sociaux au détriment de certains autres, et relégitimer ainsi l’action d’un gouvernement fédéral dont, auparavant, tous pensaient qu’elle ne pouvait qu’aller toujours dans le même sens : au profit des gros, au détriment de la liberté, dans le sens de la corruption. Un tel aggiornamento allait clairement à contre-courant d’un siècle et demi de méfiance envers l’Etat central.
Mais, avec le Second New Deal, il y a bien eu une timide acclimatation – même si c’est, comme le montre J. Cowie, de manière superficielle – de l’idée qu’il n’y a pas lieu de rendre les individus responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent, et que c’est le système capitaliste qu’il s’agit de réformer pour porter remède à la crise. Ainsi, le Wagner Act de 1935 ne se contente plus de proclamer abstraitement le droit des salariés de s’organiser collectivement, mais il pourvoit aux modalités concrètes de cette organisation. La loi définit et prohibe les pratiques inéquitables en matière d’emploi (salaires insuffisants, travail des enfants etc..) et elle établit une commission pour trancher les conflits (National Labor Relations Board). Le but est bien d’encourager la négociation collective pour rétablir un certain équilibre dans les relations entre employés et employeurs10. Et l’effet a suivi : à la fin de la seconde guerre mondiale, plus d’un tiers de l’ensemble des salariés sont syndiqués. Complétant le Wagner Act, une loi (le Social Security Act) pourvoit désormais aux retraites de salariés et aux allocations chômage.
On peut mesurer l’ampleur de la mutation opérée par le second New Deal en remarquant la manière dont il s’empare du thème du Forgotten Man pour en inverser totalement le sens. L’homme oublié, pour les chantres de l’individualisme classique, c’était l’ouvrier, le fermier ou l’employé blanc, honnête, tempérant, travaillant dur, payant ses impôts, à qui les divers progressistes et partisans de la solidarité sociale voulaient imposer de prendre sur ses épaules la charge d’entretenir les pauvres, les nouveaux immigrants et les anciens esclaves. Mais pour les new dealers, le forgotten man n’est plus ce travailleur honnête qui veut que l’Etat cesse d’intervenir dans ses affaires pour le contraindre à aider les pauvres non méritants, mais celui qui a besoin au contraire que l’Etat intervienne à ses côtés pour lui garantir sécurité et niveau de vie décent11. Le concept de liberté subit ici une véritable mutation car, au lieu de désigner le fait d’être délivré de toute interférence non consentie et de toute obligation d’assumer la responsabilité des actions des autres, il désigne désormais le fait de se voir garantir une réelle liberté d’action et une réelle maîtrise de sa propre existence dans un contexte où il devient impossible de dire que les individus sont responsables de leur situation et où, en conséquence, il incombe à la collectivité de faire en sorte que chaque individu, qui n’est qu’un rouage d’une immense machine, se voie garantir une existence indépendante et une protection contre les pressions excessives du marché, de la concurrence et de l’argent.
Qu’est ce qui a rendu possibles ces mesures, qui ont correspondu à une rupture de ce que François Ewald12 a appelé le « diagramme de la responsabilité », et permis l’introduction, dans la gestion de la société, d’une certaine dose de « collectivisme », c’est à dire de la conviction que les difficultés rencontrées sont des effets structurels appelant une réponse systémique, donc publique.
J. Cowie montre que les quatre obstacles qui s’y opposaient – individualisme, anti étatisme, évangélisme, racisme – avaient perdu une partie de leur puissance pour des raisons purement conjoncturelles au milieu des années 1930, sans cependant avoir complètement disparu, loin de là.
Commençons par la fin. Les Etats Unis ont mis un coup d’arrêt à l’immigration en 1924 en sorte que la décennie qui a suivi a vu un relâchement de la constante tentation d’incriminer les derniers arrivés et de leur faire porter la responsabilité des bas salaires et des mauvaises conditions de travail. La xénophobie peut donc perdre de sa puissance pendant que les différents groupes ethniques « caucasiens » peuvent prendre lentement conscience de l’homogénéité de leurs situations et apaiser les conflits qui les opposent. Quant à la question raciale, elle a été purement et simplement mise sous le boisseau. Les New Dealers ont passé avec les démocrates du sud un compromis honteux, obtenant l’appui politique de cette section du parti en échange de l’assurance que les afro-américains ne seraient pas concernés par les mesures sociales envisagées. Et de fait, le secteur de l’agriculture a été soigneusement tenu à l’écart de la réorganisation des rapports de travail.
L’évangélisme a lui aussi subi un coup d’arrêt – provisoire – car, lorsque les juges du Scopes Trial ont condamné l’enseignement de l’évolutionnisme en 1925, l’effet public a été, par réaction, de donner un vaste écho au darwinisme et de désigner l’attitude du tribunal comme un archaïsme injustifiable. Les héritiers des progressistes ont dès lors été contraints de se distancier nettement de la religiosité conservatrice dont ils étaient restés tributaires, et de se convertir à une vision de la société à la fois plus moderne, moins moralisatrice et moins centrée sur la responsabilité et la régénération de l’individu aux dépens de la prise en compte des effets du système économique.
L’individualisme a quant à lui perdu un peu de sa superbe parce que la réalité de la crise a permis de percevoir ses effets négatifs, mais aussi parce qu’elle a permis de soulever en partie le voile sur le fait que, dans la période précédente, cet individualisme n’avait que très partiellement correspondu à la réalité. Les slogans du « moins d’Etat » et du « laisser faire » recouvraient en effet une réalité moins idyllique, où la ploutocratie s’alliait à la corruption pour mettre la législation et l’action publique au service des grands intérêts.
Exceptionnellement enfin, devant l’impuissance des relais privés et des Etats fédérés, l’Etat Fédéral apparaissait comme un recours possible, et l’idée que l’action publique pourrait contribuer à rétablir les équilibres perturbés et armer les individus en leur conférant des droits collectifs semblait moins hérétique qu’à tous les autres moments de l’histoire américaine.
Le second New Deal : les raisons de sa faiblesse
Cependant, dit Cowie, même si le second New Deal représente bien un moment où la classe ouvrière accède à une certaine puissance collective et même si, comme le pensait Isaiah Berlin, il a réussi à réconcilier en partie la liberté individuelle avec le minimum indispensable d’autorité organisatrice de l’Etat, il reste traversé de contradictions et de faiblesses. Cowie entend en effet montrer que ce « minimum indispensable », bien qu’il ait eu un puissant effet de transformation, s’est avéré, parce qu’il était une pièce rapportée étrangère à la matrice de la culture politique américaine, vulnérable à certains des instincts les plus profonds de cette culture à mesure que l’après-guerre s’est déployé et que le sentiment d’urgence qui justifiait l’adoption de cette pièce rapportée diminuait13. D’une certaine manière, le New Deal n’a réussi à émerger que parce qu’il a passé avec chacun des courants souterrains qui coulaient dans un sens contraire des compromis qui, pour finir, lui ont été fatals.
Le noyau dur du New Deal était en particulier marqué par une hésitation profonde entre ce que l’on pourrait appeler une logique de l’égalisation des places et une logique de l’égalisation des chances. La première est d’inspiration « collectiviste » et elle postule que la tâche de la puissance publique est de créer une société continue dans laquelle les individus se verraient garantir à la fois une indépendance et un certain niveau de vie, l’idée essentielle étant que la collectivité assume la responsabilité des situations individuelles et les compense sans réellement prendre en compte les comportements ou les choix des individus. La seconde trouve son inspiration beaucoup plus près de l’individualisme classique, et elle tient seulement compte du fait que, dans une société industrielle marquée par des asymétries, les positions initiales sont si inégales que le « diagramme de la responsabilité » personnelle ne peut plus s’appliquer sans correctifs. Or, non seulement la logique de l’égalisation des places est en contradiction avec la culture politique américaine, mais elle est plus profondément en rupture avec l’idée même d’une société de liberté telle qu’elle a été héritée des pères fondateurs du libéralisme. Elle contraint en effet à récuser le principe de l’impartialité du droit et à concevoir la fonction de la puissance publique comme une tâche de production de statuts comparables pour des individus dont les trajectoires spontanées tendent au contraire en permanence à diverger sous l’impact des asymétries du marché. Ceci suppose une intervention permanente pour remodeler les situations objectives et les harmoniser – d’une manière qui reste toujours relative -, intervention qui exclut désormais de se fonder sur des principes stables dont les résultats sont aléatoires et imprévisibles. Le risque est d’avoir ce que les américains eux-mêmes, à la fin du XIXè siècle, dénonçaient comme une « législation de classe », une sorte de discrimination positive avant la lettre destinée à corriger les effets de la concurrence et à soutenir la position des perdants. Pour commencer à considérer qu’une telle action publique est légitime, il faut rompre avec l’idée que la concurrence est équitable, qu’elle se déroule entre acteurs disposant d’atouts comparables, et que le droit est un système de règles authentiquement impartiales. Il faut au contraire adopter l’idée que l’impartialité du droit est un leurre et que, lorsque les acteurs sont placés dans des positions différentes, l’identité des règles et le principe de la sacralité des contrats sont des moyens de contrainte et non des outils de libération uniforme. Or non seulement une telle idée est aux antipodes de la tradition américaine, mais elle ouvre une véritable boîte de Pandore : si le droit n’est pas impartial, cela signifie qu’il a une dimension politique, que chaque règle peut être anticipée comme ayant des effets favorables pour certains groupes sociaux au détriment des autres, et que, par conséquent, la soumission du pouvoir à un droit qu’il ne fait pas – le rule of law – est une illusion. En outre, comme nombre de théoriciens du libéralisme classique l’ont souligné, toute législation « de classe », toute intervention dans le jeu des règles du marché et de la concurrence pour rétablir des situations dégradées et produire, par le biais de l’action publique, une égalité relative que le marché tend lui- même à détruire, a pour effet de fausser le mécanisme, de créer des situations artificielles qui appellent à leur tour de nouveaux artifices, de nouvelles protections, de nouvelles législations spécifiques pour compenser les déséquilibres engendrés par celles qui ont été antérieurement décidées. Non seulement cette forme d’interventionnisme en croissance nécessairement exponentielle est étrangère à la culture politique américaine, mais elle est théoriquement très vulnérable à des objections majeures ; elle casse le mécanisme du marché, elle consacre le règne des lobbies qui cherchent à obtenir des législations avantageuses, elle établit des situations juridiquement protégées, elle oblige à une correction constante des nouveaux déséquilibres qu’engendre inévitablement toute tentative pour porter remède de manière artificielle à ceux qui résultent de la concurrence. La tentation est donc très grande de revenir dans un premier temps à une pure logique de l’égalisation des chances à l’intérieur d’un système de règles qui demeurent impartiales, et d’opérer ainsi un retour vers les dogmes essentiels de l’individualisme classique, puis, dans un second temps, de mettre en cause cette forme d’égalisation minimale, celle qui ne concerne que les situations initiales, pour revenir à une interprétation de la constitution en conformité avec l’individualisme jeffersonien Et cela, en dépit du décalage qui existe entre les principes d’un tel individualisme – chaque individu est un acteur indépendant et doit assumer les conséquences de ses choix – et la réalité d’une économie incorporée où les individus ont cessé de pouvoir échapper aux pressions qui s’exercent sur eux, et qui est donc un authentique rapport de forces et non un système de liberté. Dans l’après-guerre, et en particulier dans les années 1960, les héritiers du New Deal empruntent manifestement une voie consistant à promouvoir des programmes de non-discrimination plutôt que des programmes de redistribution, et Cowie souligne par exemple à quel point L.B. Johnson considérait ces derniers comme une hérésie. Pour lui, la guerre contre la pauvreté ne consistait pas à transférer des ressources aux plus démunis, ou à les munir d’armes juridiques pour être mieux en état d’affronter la concurrence, mais seulement à les mettre en situation de sortir de leur condition par leurs propres efforts. Cette dérive était en germe dans l’origine.
L’anti-étatisme, bien entendu, opère lui aussi un retour spectaculaire dans les fourgons de cet individualisme classique qui impose sa présence non pas en raison de la force propre de ses principes, mais en raison de l’impossibilité de formuler une alternative viable, un « collectivisme » qui serait compatible à la fois avec le libre jeu du marché et avec le dogme de la responsabilité des individus. L’intervention constante de l’Etat – et en particulier des agences bureaucratiques de réglementation et de contrôle des activités privées – paraît en effet incapable de s’inscrire dans une conception cohérente de la liberté individuelle, car personne ne parvient à comprendre, ni aux Etats Unis ni ailleurs, que l’on peut être libéré par la contrainte, idée qui apparaît constamment comme une contradiction dans les termes. La conviction la mieux ancrée et la plus commune demeure – dans le droit fil de l’individualisme classique – que la liberté consiste à subir aussi peu de contraintes que possible, et seuls quelques juristes dont les voix demeurent isolées parviennent à formuler l’idée que toute règle de droit– aussi bien celle qui institue les interventions que celle qui les supprime – favorise certains intérêts au détriment de certains autres14. Ce n’était pas le cas avant l’ère de la grande industrie, où les positions des acteurs économiques demeuraient relativement symétriques, mais cela devient inévitable dans une économie où les acteurs sont si différents les uns des autres que des règles uniformes ne peuvent pas ne pas les affecter de manière différenciée. Pour ces juristes, il ne peut donc plus y avoir de liberté au sens où chacun assume les conséquences de ses propres actions dans une économie où l’asymétrie des positions met certains acteurs en position de contraindre les autres à adopter des conduites pour lesquelles ils n’opteraient pas s’ils n’étaient pas confrontés à des partenaires dont la puissance de négociation et de contrainte est bien supérieure à la leur15.
Mais, à l’évidence, cet essai pour formuler cette philosophie alternative de la liberté individuelle dans une société de masse se heurtait à la difficulté de justifier l’expansion de la bureaucratie, la croissance de la réglementation et le renforcement de l’exécutif dans une culture marquée au contraire par la phobie du pouvoir d’Etat. L’obstacle était de même ampleur lorsqu’il s’agissait de justifier la lente substitution des sujets aux citoyens dans une démocratie présidentialisée, ainsi que la lente érosion de l’auto-gouvernement par l’essor des agences administratives non élues. Les new dealers n’ont pas réussi – ils l’ont en fait à peine tenté – à produire ces justifications et à présenter les réalités politiques nouvelles comme la seule forme possible de la liberté individuelle dans une société industrielle dominée par les « corporations ». La conséquence a été que le langage de l’individualisme classique est devenu un langage de protestation désormais monopolisé par les conservateurs. Ce sont eux, dit Cowie, qui sont désormais en mesure, et qui le seront de plus en plus après la seconde guerre mondiale, de capitaliser à leur profit l’héritage de Jefferson.
Le fait que la baisse d’intensité de la xénophobie, du racisme, et de l’évangélisme conservateur n’ait été qu’un phénomène superficiel et peu durable est l’occasion de réflexions encore plus préoccupantes que celles qui sont liées à la difficulté de faire progresser une représentation post-individualiste de la liberté dans une société industrielle marquée par la présence des grandes corporations. Notre lecture téléologique de l’histoire tend en effet à nous faire croire qu’il existe là aussi un mouvement continu dans le sens du progrès et du modernisme et que, de la même manière qu’il devient de plus en plus manifeste que l’interdépendance des individus dans la société moderne justifie une certaine collectivisation des ressources et de la responsabilité, nous devrions aussi assister à un effacement lent mais progressif – pas seulement à des éclipses temporaires – à la fois de l’exclusion et du mépris sur la base de la race ou de la nationalité, et de l’interférence des idées religieuses dans la régulation sociale.
Or, selon Cowie, force est de constater que, chaque fois que Roosevelt lui-même16, puis Truman dans les années 194017, puis Johnson dans les années 1960, ont tenté de rompre le compromis honteux passé avec les démocrates du sud, ces derniers ont menacé de quitter le navire comme au demeurant une partie de la classe ouvrière et de la classe moyenne des Etats du nord qui entendait se réserver le privilège exclusif des avancées sociales du New Deal18. Les clivages économiques – l’opposition entre riches et pauvres sur le partage de la valeur – n’ont donc pris le pas sur les clivages ethniques et religieux que de manière très superficielle, et il a fallu des circonstances exceptionnelles pour que ce réalignement provisoire soit possible. Il en va de même pour l’évangélisme conservateur. Si, dans un moment de crise aiguë, il paraît possible de penser que les maux sociaux ne relèvent pas de la responsabilité des individus, de leur éthique, de leur attitude face au travail, de leur prudence, ces représentations « collectivistes » sont rapidement submergées par une moralité plus en phase avec l’individualisme à mesure que la crise s’efface de l’horizon: nul ne peut exiger d’être soutenu et secouru par les autres, chacun doit se reposer sur ses propres efforts, la famille est la structure d’entraide et de formation morale essentielle, l’assistance n’est une vertu qu’aussi longtemps qu’elle relève de la volonté de chacun et qu’elle ne se transforme pas en obligation légale.
Une des raisons de l’éclipse des idées religieuses pendant la grande dépression avait été l’incapacité des organisations religieuses à faire face à des problèmes dont l’ampleur paraissait dépasser les possibilités d’une initiative privée et exiger l’appel à l’Etat19. Malgré cela, dit Cowie, les semences d’une réaction fondamentaliste contre le New deal étaient présentes dès les années 1930, car la pensée apocalyptique était de toute manière nourrie par la crise. La Dépression alimente en effet un discours religieux qui dénonce pêle-mêle l’hypertrophie de l’Etat, les sombres manœuvres du business, les visées dictatoriales de l’exécutif, la bureaucratie envahissante, l’affaiblissement des valeurs familiales, de l’éthique du travail et du sens de la responsabilité personnelle. Rendre l’Amérique aux petits, ressusciter les valeurs traditionnelles, délivrer les individus des affres de la société de masse, tel était le programme de ce que Alan Brinkley a appelé les « great depression populists » (Townsend, Coughlin, Huey Long)20. Il s’agit là d’un courant profond issu d’un passé qui ne passe pas, fondé sur la volonté de défendre l’autonomie de l’individu et l’indépendance des communautés locales contre les empiètements de l’Etat et de l’industrie. Ces courants sont ouvertement allergiques à toute forme de collectivisme, à toute velléité de réfléchir en termes de classe ou d’effets de structure. Viscéralement individualistes, ils exigent que chacun demeure le maître de sa propre existence et recueille le fruit de ses propres efforts, et que le pouvoir demeure logé dans des institutions proches des citoyens et contrôlées par eux. A tout autre moment de l’histoire que celui de la grande dépression, ces idées auraient fait obstacle aux réformes d’inspiration post-individualiste. Qu’elles aient baissé la garde au moment de la « grande exception » n’autorise cependant pas l’illusion consistant croire que la page était définitivement tournée sur ce populisme, et que le modernisme étatique et collectiviste s’était installé de manière définitive, en phase avec une mutation sociale qui reléguait l’indépendance individuelle au rayon des antiquités pour souligner la réalité des interdépendance et la nécessité d’une gestion collective – donc publique et politique et non plus privée et morale – de ses effets. Très loin de là, et cette religiosité évangélique n’a cessé de reprendre de la vigueur depuis la guerre.
Les catholiques étaient sans doute plus disposés à envisager l’idée de destin collectif et à faire appel à l’Etat pour l’organiser, car l’idée de justice sociale a toujours exercé une certaine séduction sur l’Eglise. Mais leur soutien au New Deal n’était pas non plus dépourvu d’ambiguïté car ils ont toujours vécu dans la défiance de la modernité, dans la défiance de la forme d’individualisme séculier et libéral que Roosevelt voulait promouvoir. Chez eux aussi, la volonté de protéger les valeurs familiales aux dépens de l’Etat, et l’idée que chacun est responsable de son propre sort ont toujours été puissantes, ce qui les a toujours conduits à mettre l’accent sur la famille et les valeurs communautaires et à rejeter un avenir qui serait fait uniquement de consumérisme et d’amélioration du bien-être
Les leçons d’un échec
On voit à quel point l’étude des raisons pour lesquelles l’affaiblissement des quatre obstacles qui s’opposaient au « collectivisme » n’était que conjoncturel impose une remise en cause de toute vision linéaire du progrès des sociétés modernes.
Progrès uniforme des droits personnels aux droits politiques et des droits politiques aux droits sociaux selon le schéma proposé par T.H. Marshall ? Non, certainement pas, et pour deux raisons différentes.
La première est que, historiquement, les droits sociaux en question ont été l’apanage de la classe ouvrière blanche, à l’exclusion des femmes, des noirs, et des minorités. Dans les années 60, cette limitation devenait très perceptible, mais elle n’était au fond que l’indice d’un malaise plus profond. La mise en œuvre des mesures du second New Deal avait consisté à sauver le système en « achetant » certaines catégories sociales par l’octroi de quelques avantages matériels et au prix d’un clivage entre ceux qui sont inclus et ceux qui sont exclus. L’édifice commence à se fissurer lorsqu’il devient clair que ce compromis suppose un renforcement et une bureaucratisation de l’Etat central aux dépens de l’indépendance des individus, mais aussi une forme de trahison par rapport à l’égalisation des chances et à la non-discrimination qui apparaissent comme des idéaux politiques et sociaux d’autant plus attractifs que l’égalisation des places se révèle réservée aux hommes blancs. Il vient donc un moment où les avantages distribués ne suffisent plus à compenser la perte de citoyenneté due à la bureaucratisation de l’Etat social, ainsi que la persistance sans cesse plus visible des discriminations à l’égard des noirs et des femmes. C’est d’autant plus vrai que, dès la fin des années 1960, le mouvement de désindustrialisation réduit la taille des groupes avantagés au moment même où les salaires commencent à stagner en valeur réelle et où les femmes entrent en masse sur le marché du travail. La « grande société » de Johnson, la guerre contre la pauvreté, le mouvement des droits civiques des années 1960 et 1970, traduisent donc un glissement de l’idéal du New Deal des concepts collectivistes à une vision beaucoup plus proche de l’individualisme : égaliser les chances, lutter contre les discriminations. Comme si, dit Cowie, la gauche libérale commençait à rentrer dans le lit principal de la culture américaine et rompait avec un épisode « collectiviste » dont les conséquences négatives devenaient perceptibles21.
La seconde raison découle de la première. Le virage vers une politique de lutte contre les discriminations est concomitant, à la fin des années 70, d’un accroissement considérable des inégalités. Alors que la désindustrialisation réduit le nombre de salariés protégés, le nombre de pauvres a tendance à augmenter au moment même où l’impératif majeur semble être de les assister pour qu’ils puissent bénéficier de chances égales. Le résultat est que, comme l’écrit J. Cowie, la classe moyenne et la classe ouvrière blanche ont eu le sentiment d’avoir à payer des impôts considérables pour assister les minorités, en particulier les noirs. On comprend que la situation leur soit apparue très différente de celle qui prévalait lorsque, au lendemain de la guerre, le gouvernement taxait les plus riches pour doter la classe ouvrière d’un statut protégé et de revenus en hausse22. On comprend aussi pourquoi cette conjoncture rend possible un retour en force des composantes xénophobe et raciste de la culture politique américaine. En outre, les portes de l’immigration – principalement en provenance de l’Asie et de l’Amérique latine – ont de nouveau été ouvertes après 1965, alors que l’intégration raciale promue d’en haut par les juges et par l’Etat fédéral paraît porter atteinte, pour certains, à des dimensions essentielles de la « liberté » individuelle (en particulier l’intégration forcée des écoles).
Cette seconde raison, pas plus que la première, n’est propre aux Etats Unis. Dans tous les pays développés, l’ouverture des frontières et la croissance des inégalités ont profondément modifié la donne. Les grandes entreprises échappent de plus en plus à l’impôt grâce à leur mobilité transfrontalière, elles utilisent les Etats pour la promotion de leurs propres intérêts ( ce qui renforce l’anti étatisme ), elles capturent la démocratie dans un mouvement de spirale qui rend le personnel politique de plus en plus vulnérable à la tentation de l’argent à mesure que la verticalisation et la complexification de l’Etat repoussent toute possibilité de contrôle des citoyens et que, en conséquence, ceux-ci se détournent de plus en plus d’une puissance publique qui leur apparaît comme un problème et non comme une solution. Dans le même temps, la croissance vertigineuse des inégalités convertit de plus en plus l’Etat social en Etat d’assistance et non plus de solidarité. Or cette conversion provoque une désadhésion des classes moyennes qui ont le sentiment de soutenir seules une fonction d’assistance qui leur paraît injustifiable23. Dans ce contexte, la conversion d’une politique de classe à une politique de l’identité devient plus explicable pour des groupes sociaux désormais convaincus que leurs impôts servent non pas à garantir une solidarité entre tous mais à assister les immigrés récents et à résorber les discriminations dont ils sont victimes.
==================
NOTES
- National Industrial Recovery Act [↩]
- E. Foner, Free Soil, Free Labor, Free Men, The Ideology of the Republican Party before the civil War, Oxford, Oxford University Press, 1970.[↩]
- Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad (1886[↩]
- A. Trachtenberg, The Incorporation of America. Culture and Society in the Gilded Age, New York, 2007 ; cf. aussi H.W. Brands, American Colossus, The Triumph of Capitalism 1865-1900, Anchor Books, 2011 ; A.S. Miller, The Modern Corporate State. Private Governments and the American Constitution, GreenWood Press, 1977.[↩]
- J. Cowie, The Great exception, op. cit., p. 26 et p. 82.[↩]
- Ibid., p. 87-89.[↩]
- Ibid.., p. 24.[↩]
- Ibid., p. 100.[↩]
- John Dewey, Individualism Old and New, New York, 1930 ; cf. aussi Liberalism and Social Action, New York, 1935. [↩]
- J. Cowie, The Great exception, op. cit. p. 112.[↩]
- Ibid.. p. 93.[↩]
- F. Ewald, L’Etat Providence, Paris, Grasset, 1986.[↩]
- J. Cowie, The Great Exception, op. cit. p. 97 ; cf. aussi p. 123.[↩]
- Robert L. Hale, Morris Cohen.[↩]
- J. Cowie, The Great Exception, op. cit., p. 136.[↩]
- Ibid., p. 118.[↩]
- Truman a tenté de combattre le lynchage dans le sud ainsi que la ségrégation dans les forces armées.[↩]
- Ce que Cowie (p. 29) appelle « a return to a working class fragmented by race, religion, immigration and culture »[↩]
- Ibid., p. 136.[↩]
- A. Brinkley, The End of Reform. New Deal Liberalism in Recession and War, New York, 1996.[↩]
- J. Cowie, The Great Exception, op. cit., p. 185.[↩]
- Ibid., p. 181.[↩]
- Cf. C. Offe, The contradictions of the welfare state, edited by J. Keane, MIT Press, 1984.[↩]

Jean-Fabien Spitz
Jean-Fabien Spitz est professeur émérite de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
