Une vie engagée
 Photo Hermance Triay. Opale. Leemage
Photo Hermance Triay. Opale. Leemage
À propos de : Anne Weber, Annette, une épopée, Paris, Le Seuil, 2020, 240 pages.
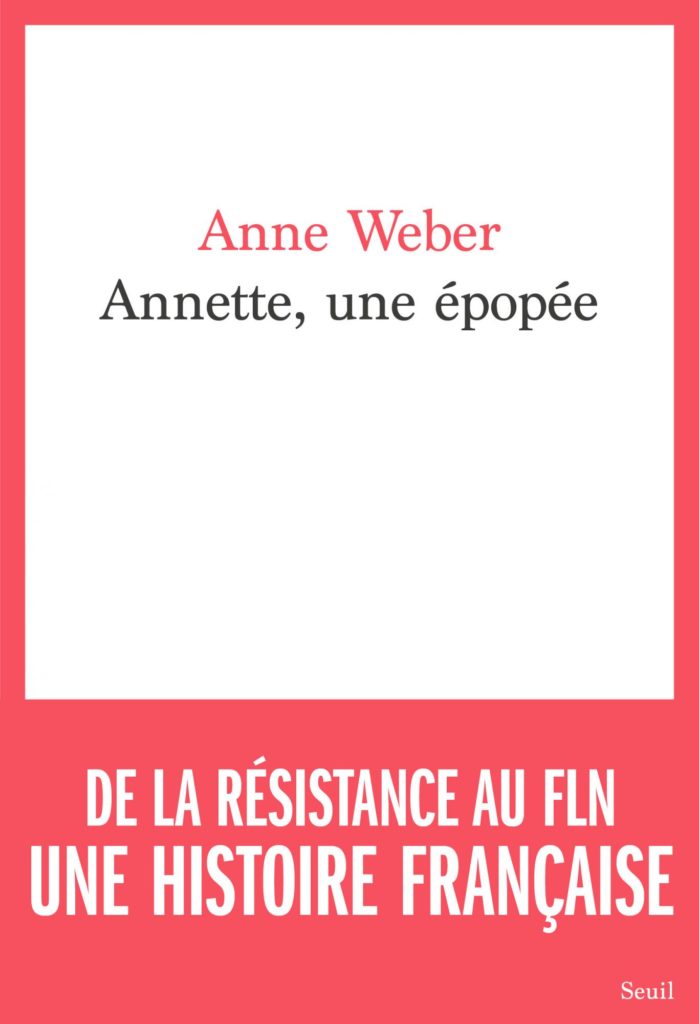
À l’origine du récit d’Anne Weber Annette, une épopée, il y a une rencontre : celle, évoquée dans les dernières pages du livre, d’Anne weber avec Anne Beaumanoir, alias « Annette », dans le cadre d’« un petit festival de cinéma » (Annette, une épopée, p. 230) à Dieulefit, dans la Drôme – une rencontre que la narratrice d’Annette apparente à ce que « dans d’autres / circonstances, on appelle volontiers un / coup de foudre » (p. 232). De ce coup de foudre, Annette, une épopée est donc le fruit, et l’éclaircissement.
Il faut dire que la vie d’Anne Beaumanoir, ou d’Annette, telle que la rapporte Anne Weber, a de quoi retenir l’attention, provoquer la réflexion, voire susciter l’admiration. C’est, avant tout, une vie d’engagements : dans la résistance à l’occupation allemande quand Annette n’était encore qu’une adolescente, dans le soutien aux combattants pour l’indépendance de l’Algérie, dans l’aide à l’Algérie devenue indépendante – et dans bien d’autres « tentatives […] / pour transformer le monde » ( p. 228), que le récit d’Anne Weber laisse dans l’ombre. C’est l’histoire d’une femme qui lutte pour ses principes dans un monde où les hommes tiennent les rênes de la politique et de la guerre ; à qui l’Histoire enlève son amant, que ses combats séparent de son mari, et de ses enfants ; qui doit fuir, pour l’avoir trahie, sa patrie de naissance, la France, qui l’a condamnée à la prison ; qui doit, quelques années plus tard, faire de même avec sa patrie d’adoption, l’Algérie, où elle n’est plus la bienvenue. À la fois romanesque et tragique, en prise directe avec l’Histoire, guidée par un idéal de justice ignorant les frontières, comment la vie d’Annette pourrait-elle ne pas fasciner, et la personne de celle qui l’a vécue ne pas attirer la sympathie ?
Tout au long d’Annette, une épopée, la sympathie de la narratrice pour son personnage est évidente. Mais le récit d’Anne Weber, qui n’a rien d’une biographie – et notamment dans sa prétention à l’exhaustivité –, n’a rien non plus d’une hagiographie héroïque. La narratrice d’Annette ne fait pas que nous communiquer son admiration pour la femme libre, généreuse et rebelle qu’a été Anne Beaumanoir ; elle cherche également à cerner la complexité de ses motivations, les limites de son idéalisme, les failles de son action – en admiratrice authentique, qui ne juge pas, mais n’idolâtre pas non plus. Œuvre « de transmission », au sens où il a pour but de transmettre au lecteur l’exemple et la mémoire de la vie d’Anne Beaumanoir, le récit d’Anne Weber est aussi éminemment réflexif : à travers la narration des engagements et des tribulations de son personnage, il s’interroge sur la manière dont une vie s’infléchit, se conduit, s’égare, au croisement de l’Histoire et des idéaux.
Ainsi, la description du cadre social et familial dans lequel Annette a grandi, laisse entendre qu’il n’a pas peu contribué à la formation de son caractère généreux et combatif. Elle a vu, par exemple, ses parents secourir les épouses de républicains espagnols venues trouver un asile jusqu’en Bretagne, alors que leurs « maris sont blessés ou morts ou prisonniers » (p. 22). Ces mêmes parents, durant la guerre, accepteront sans hésiter de recueillir, à la demande de leur fille, deux adolescents juifs que celle-ci a sauvés de l’arrestation et de la déportation – Annette ignorant que, par ailleurs, son père « travaille / […] pour le BCRA, Bureau central de renseignement / et d’action, plus spécialement pour le réseau Gallia / qui s’occupe d’espionner l’armée allemande afin / que les bombardements alliés soient ciblés » (p. 56). Pour ce qui est de l’indépendance d’esprit, du sens de la solidarité, et du courage, Annette serait donc « bien née »1. Mais la narratrice récuse l’explication de son personnage par sa naissance, ou la réduction de son personnage à sa naissance – sans quoi la vie d’Annette n’aurait plus le pouvoir d’interpeller le lecteur : « S’il était vrai / que les conditions initiales d’une vie déterminent / entièrement la suite, alors adieu conscience, adieu / toute responsabilité. Déjà nous commencions à respirer et / à nous réjouir – les jeux sont faits – mais ce n’est pas si / simple finalement puisqu’il s’avère que l’essentiel est devant nous et reste toujours à réinventer » (p. 13).
Cependant, comme le fait ressortir le récit de la résistance d’Annette, prendre ses responsabilités, ou plutôt sa responsabilité,n’a pas nécessairement, dans la réalité, la simplicité et l’éclat des mots : « résister résulte, comme la plupart des / choses qu’on fait, non pas d’une décision qu’on prend / une fois pour toutes mais d’un glissement pour ainsi dire / imperceptible, progressif, vers quelque chose / dont on n’a pas encore idée » (p. 26). Cela commence « par de petites choses » (p. 25), comme « réceptionner », à la demande d’un prisonnier croisé dans la rue, et dont l’escorte se montre distraite, « quelques paquets devant le mur de la caserne transformée en prison et les porter à l’adresse indiquée sur le paquet le plus petit » (Ibid.) Cela suppose de la persévérance, et de la chance, comme lorsqu’Annette, montée de sa Bretagne à Paris, se met en quête « d’indociles » (p. 31), qu’elle « déniche / […] boulevard Raspail un groupe autour de / Marc Sangnier qui réunit toute une jeunesse mouvementée où elle soupçonne des germes de / résistance » (Ibid.), et qu’une personne de ce groupe la met en relation avec le « contact qu’elle cherche » (Ibid.). Cela suppose, aussi, d’endosser la discipline de l’action clandestine, et d’en appliquer sans faiblir, à la demande, les austères commandements : « que tous les ponts vers le passé / et l’avenir soient bien coupés. Mot d’ordre : retranchement » (p. 65). C’est le mot d’ordre qu’Annette suit quand, passée de la capitale à Lyon avec son contact, devenu son mentor et son compagnon, elle se retrouve séparée de lui ; un mot d’ordre suivi au risque de se perdre : « tel / Ulysse qui voit ses compagnons mourir / les uns après les autres, elle est de plus en / plus coupée de son histoire et de ses origines : / parmi ceux dont tous les jours elle croise le chemin, / personne ne connaît son passé ni son vrai nom, / et c’est à peine si à la fin elle s’en souvient elle-même. / Elle habite moins sa chambre que sa propre ombre » (p. 66). Et la narratrice de s’interroger sur ce qui fait consentir à vivre, comme Annette, la vie aveugle et séparée d’une clandestine ; et de se demander s’il ne faut pas expliquer ce consentement non seulement par toutes les « bonnes raisons » que l’on peut en donner, comme « vouloir se battre contre / l’oppression, pour la justice, contre le règne des nazis » (p. 67), mais aussi par « l’aventure, la sensation d’abandonner / l’existence grise et monotone, les habitudes et les / coutumes bien connues » (p. 68). Plus loin, alors qu’elle entame le récit de l’engagement algérien d’Annette – qui commence aussi par « un petit pas, une enveloppe par-ci / par-là contenant des billets de banque qu'[Annette] va / porter dans des endroits qu’on lui indique » (p. 119) –, la narratrice, à nouveau, se demande quel rôle a pu jouer dans cet engagement le désir de retrouver la vie intense et risquée de la Résistance – ce que l’on pourrait appeler le « côté Malraux » d’Annette. Elle a lu La Condition humaine à quinze ans ; séduite par le personnage de Tchen, le terroriste, et son jusqu’au-boutisme sacrificiel, elle n’a plus jamais été « pacifiste » (p. 22). Malraux suscite, ou nourrit, l’idéalisme de l’adolescente, son aspiration à une vie héroïque : « ce qui [l’]enchante, ce sont les / sentiments, l’exaltation, l’idée de sacrifier sa / vie pour une idée tout idéale » (p. 23) ; il nourrit, selon la narratrice, son impatience de résistante précoce, avide d’action, mais aussi de transformation politique et sociale : « Quand est-ce qu’on chassera / enfin ces vert-de-gris, ces uniformes nazis ? Et / quand les rues rennaises ressembleront-elles vraiment / aux cantonaises des Conquérants, roman de l’éternel / Malraux ? Et la révolution, c’est quand ? » (p. 27). Les aspirations d’Annette la conduisent vers le Parti communiste – dont l’Algérie la détachera ; elles lui font aussi « [fermer] les yeux devant les morts et la terreur et / tout ce qui s’ensuit communément en cas de révolution » (p. 29). Mais elle est également celle qui sait passer outre les consignes de prudence et se laisser toucher par la détresse des autres, comme lorsqu’elle improvise le sauvetage de deux adolescents juifs, dont le récit compte parmi les pages les plus prenantes du livre d’Anne Weber.
En racontant la résistance d’Annette, la narratrice met donc en lumière les voies, les difficultés, les comlexités d’un engagement – sans oublier sa grandeur. Tout cela, on le retrouve dans le récit de la participation d’Annette au combat pour l’indépendance de l’Algérie – mais en plus sombre. Cet engagement-là, la narratrice nous fait comprendre qu’il prolonge et radicalise à la fois le précédent. Annette n’a pas résisté seulement pour que les Allemands cessent d’occuper la France, mais pour un idéal de justice indifférent aux frontières. Ce même idéal la conduit à se tenir aux côtés des Algériens luttant pour leur indépendance. Il la conduit aussi, du même coup, à rompre les amarres de la nationalité : d’abord « porteuse de valises » pour le compte du FLN, Annette en devient membre, en tant que « courrier » (p. 130) ; arrêtée, détenue, puis jugée pour sa trahison, elle s’évade avant la fin de son procès, et rejoint le siège du FLN à Tunis. Dans l’affaire, ce sont également les amarres familiales qu’elle a rompues : elle ne pouvait emmener ses enfants. L’indépendance acquise, elle met son dévouement militant, et le savoir du médecin qu’elle est devenue après la guerre, au service de l’édification du socialisme en Algérie, que promettent les nouveaux dirigeants du pays. Elle occupera même « une fonction dans l’administration, au ministère de / la Santé » (p. 205), où elle sera chargée de « tout ce qui est enseignement, recherche » (p. 206). Puis elle est rattrapée par les luttes de pouvoir qui, du FLN, sont passées à l’État de l’Algérie indépendante. Elle qui avait mis sa confiance en Ben Bella doit se cacher, puis quitter le pays, quand Ben Bella est démis par l’armée de Boumédiène. Désormais, elle doit vivre avec cette évidence : « elle a définitivement perdu ses trois enfants pour / un pays qui s’est changé très vite, en trois années – et / pour des décennies, ce que, par chance, elle ne peut / pas savoir – en dictature militaire » (p. 225). Elle va vivre avec la culpabilité de s’être trompée, son rocher de Sisyphe : « l’erreur qui fut la sienne devient / douleur, et cette douleur, elle va la porter / toute sa vie, c’est un rocher qu’elle pousse en / haut de cette colline qui est sa vie et qui finit / montagne. Et à chaque nouvelle crête qu’elle / aperçoit elle pense être arrivée à un sommet / mais une crête en cache toujours une autre / qu’elle doit escalader » (p. 226). On pourrait dire que ce dessillement tardif – et qui, une fois qu’il s’est produit, n’en finit pas, d’une certaine façon, d’avoir lieu – pèse sur le récit de la période algérienne d’Annette, comme si la narratrice le projetait sur tout ce qui l’a précédé. Celle-ci, en effet, pose de manière répétée la question de savoir si Annette a eu des doutes sur le parti qu’elle a rejoint, si les violences du FLN l’ont ébranlée, si elle n’a pas voulu voir, plutôt que pas vu, sa face autoritaire. Un épisode en particulier de cette période algérienne fait ressortir les ambiguïtés morales de l’engagement d’Annette. Elle croit savoir qui est le traitre responsable de son arrestation, et de celle de l’homme pour qui elle travaillait au sein du FLN de France, Mohamed Daksi, alias Georges. Et voilà qu’un jour, à Tunis, « on lui annonce un visiteur qui s’appelle / Younès ou Younsi » (p. 176), en qui, dès qu’elle le voit, elle reconnaît le traitre. Elle le signale à « deux hommes de sa / connaissance qui sont ce qu’on nomme alors des / Boussouf boys, ce qui n’est pas un groupe pop / mais bien le service d’espionnage et puis de contre-/espionnage d’une Algérie qui n’est pas un pays encore / mais qui en déjà les structures policières et militaires » (p. 178). Arrêté en France, interrogé « six semaines durant » (Ibid.), torturé, jugé – sans les formes – et reconnu coupable, Younès, ou Younsi, est étranglé, puis « [on jette] son cadavre / dans la Seine » (p. 179). Commentaire de la narratrice : « La peine de mort, Annette la combat. / Même dans ce cas ? / Dans tous les cas. / Son indignation est plutôt modérée, toutefois » (p. 180). Elle ajoute que Younès, ou Younsi, « cet homme insignifiant, / cette sorte de spectre qu'[Annette] connaît très peu, est bien / l’obstacle sur lequel sa vie sera venue buter » (Ibid.) – ce qu’on peut, me semble-t-il, comprendre de deux manières : responsable, à supposer qu’il le soit, de l’arrestation d’Annette, il est à l’origine de la coupure entre celle-ci et son pays, entre celle-ci et sa famille, et de tout ce qui s’en suit, jusqu’à la désillusion ; par sa fin, dont elle n’est pas innocente, il assombrit l’engagement d’Annette. On ne sera pas étonné que la narratrice, s’interrogeant sur les angles morts de cet engagement, fasse référence à Camus, pour qui la guerre d’Algérie avait rendu plus vraie que jamais l’idée qu’aucune cause, si juste soit-elle, ne justifie l’exercice indiscriminé de la violence ; un Camus qu’elle oppose, comme il se doit, à Sartre et Fanon, mais qu’on peut aussi voir comme le contrepoint de Malraux, aimé d’Annette (et sans doute moins de la narratrice : difficile de ne pas entendre une pointe d’ironie dans une qualification comme « l’éternel Malraux »). Mais c’est aussi Camus, non plus celui de L’Homme révolté, mais du Mythe de Sisyphe, qui permet à la narratrice, dans les dernières lignes de son récit, de donner de la vie d’Annette une image débarrassée du doute et de l’amertume : « à cet instant où l’homme / se retourne sur sa vie, Sisyphe retrouvant son rocher, / contemple un instant la suite d’actions sans liens / qui devient son destin, créé par lui, uni sous le / regard de sa mémoire et bientôt scellé par la mort. / La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur / d’homme – et, tel que nous le voyons là, il est heureux2 » (p. 233). Elle semble ainsi nous dire que le combat toujours repris pour la justice confère à la vie d’Annette une plénitude qui serait, en définitive, ce que nous devons en retenir.
Il faut, pour finir, dire un mot de la mise en forme donnée à son récit par Anne Weber : celle d’un texte poétique – mais sans rimes, sans même d’effets sonores particuliers, sans recherches métriques discernables, sans que le passage à la ligne paraisse, sauf exceptions, obéir à des impératifs de rythme ou de sens3. Sans doute le choix de cette disposition s’explique-t-il par la référence à l’épopée dans le titre du récit – même si le caractère clandestin d’une large part de l’action d’Annette n’a, pour cette raison, rien d’épique (la seule figure épique que mentionne la narratrice dans le cours de son récit, c’est Ulysse, notamment pour le nom qu’il se donne face au Cyclope : Personne, qu’elle met en lien avec l’expérience d’effacement personnel d’Annette alors qu’elle est seule à Lyon, durant la guerre). Reste que cette disposition confère une certaine allure à la narration de l’histoire d’Annette, celle, me semble-t-il, d’une histoire contée plutôt qu’écrite. Cette allure s’accorde bien avec la « manière » de la narratrice : respectueusement familière avec son personnage (ne la nomme-t-elle pas par son diminutif ?), partageant avec son lecteur ses réflexions, parfois didactique (je pense à certains rappels historiques sur l’Algérie), régulièrement digressive – la manière d’une raconteuse qui, tombée sous le charme de la parole et de la vie d’une femme engagée dans son siècle, a jugé qu’il valait la peine de transmettre au nôtre son histoire.
==================
NOTES
- Comme, si je ne me trompe, la recherche en sciences humaines l’a montré pour un certain nombre de résistants, ou de sauveteurs de personnes persécutées. [↩]
- Le texte d’Anne Weber suit d’assez près celui des dernières lignes de l’essai de Camus : « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux » (Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, p. 304). Resterait à commenter le passage d’« il faut imaginer » à « il est ». [↩]
- Cela dit, en recopiant certains passages, il m’est arrivé de « sentir » que j’avais oublié un passage à la ligne. À noter : Anne Weber est la traductrice en allemande d’Une Vie ordinaire de Georges Perros.[↩]

Jean-Baptiste Mathieu
Jean-Baptiste Mathieu est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm). Professeur agrégé de lettres modernes, il enseigne actuellement au Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Il est rédacteur en chef de la rubrique « Critiques » au sein de la rédaction de la revue Raison publique.
