Sécularisme et Cosmopolitisme. Héritages, controverses, perspectives
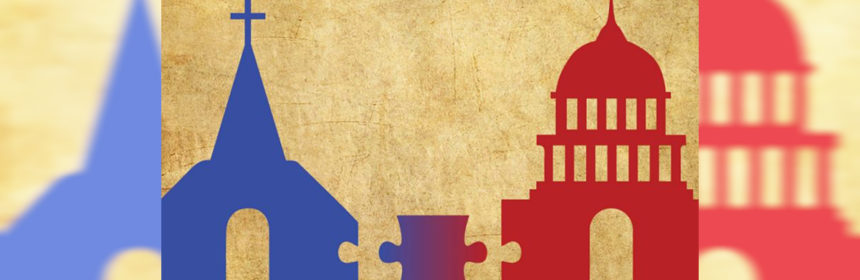
Il m’a semblé qu’aucune circonstance ne conviendrait mieux que celle-ci1 pour proposer à la discussion et, s’il le faut, à la réfutation quelques hypothèses relatives à une question qui, à travers tout notre espace méditerranéen, provoque aujourd’hui des débats passionnés, en engendrant plus de doutes et de malentendus que de certitudes et de notions communes. Son intérêt et ses enjeux sont pourtant évidents. Pour ma part, je viens d’une tradition épistémologique dont le principe était qu’on n’apprend bien que de ses erreurs : encore faut-il arriver à le mettre en pratique, et je compte sur vous pour m’y aider. Tous, nous avons aussi retenu d’Edward Said que la différence des cultures et des origines ne fait pas obstacle à la compréhension, mais à condition d’être prise en compte et de soumettre à une critique systématique les préjugés qu’elle peut recouvrir.
Venons au fait. Dans le titre que je vous ai soumis : « Sécularisme et cosmopolitisme », ce que semble annoncer la conjonction, c’est une complémentarité à découvrir ou à construire, au prix d’un effort de définition et de proposition. Je ne me cacherai pas de penser que ces deux notions correspondent pour moi à des valeurs essentiellement positives : elles font partie de ce qui caractérise la politique démocratique. Pourtant, à mesure que se développent les débats contemporains, dans un cadre désormais transnational, force est d’admettre que leur combinaison recouvre de profondes contradictions : et je me suis convaincu que, dans la situation actuelle (point d’aboutissement d’une longue histoire), chacune d’entre elles remet en question la validité de l’autre2. Ou du moins elle en mine la stabilité et en « déconstruit » la signification apparemment acquise. De sorte qu’il est devenu beaucoup plus difficile de les considérer comme autant d’aspects complémentaires d’un même programme civique ou démocratique. C’est pourquoi mon intention ici n’est pas d’associer simplement cosmopolitisme et sécularisme au sein d’une même problématique – qu’on rattacherait assez naturellement à la tradition des Lumières, ou au projet même « inachevé » de la modernité : ce qui conduit certains de nos contemporains à en proclamer la valeur permanente, et d’autres au contraire, avec des intentions diverses, à y dénoncer la trace indélébile d’un discours hégémonique, qui serait celui de la conquête du monde par une idéologie eurocentrique. Mais c’est d’en discuter les présupposés, et par conséquent d’en compliquer la représentation.
D’où les questions rien moins que naturelles que je me propose d’explorer ici. Par exemple celle-ci : à supposer que, dans les conditions de la politique contemporaine, il n’y ait pas de « projet cosmopolitique » tenable en dehors d’une perspective de sécularisation (autrement dit que l’idée d’un « cosmopolitisme religieux » soit intenable), comment se fait-il donc que le fait de proposer une perspective séculière ou sécularisée pour la construction de la cosmopolis ne fasse (pour commencer au moins) qu’ajouter des difficultés et des contradictions à celles que recèle déjà l’idée d’un passage de la citoyenneté du niveau national à un niveau transnational ? Pourquoi, en d’autres termes, l’idée d’une sphère publique « sécularisée » ou libérée de l’emprise religieuse, qui pouvait sembler claire (sinon faire l’unanimité) au niveau d’une cité ou d’une nation, devient-elle confuse, impraticable, voire autodestructrice quand nous déplaçons notre concept du politique au niveau du « monde » ou de « l’humanité », c’est-à-dire dans un espace a priori sans limites et sans exclusives ? Et comment faire en sorte que les obstacles surgissant au-devant d’une telle représentation ne fassent pas qu’en souligner le caractère désespérément utopique, mais ouvrent à la discussion les tâches politiques et les procédures institutionnelles qui inscrivent nos sociétés dans un horizon cosmopolitique ? Mais inversement, à supposer que – dans certaines parties du monde, à moins que cela ne vaille pour toutes, mais de façon à chaque fois différente – il ne soit plus vraiment possible de mettre en œuvre une conception séculière ou sécularisée de la politique, d’instituer des modalités séculières de régulation des conflits sociaux, de développement des services publics (éducation, santé, urbanisme, etc.), sans inclure une dimension « cosmopolitique » dans la définition même du politique – de sorte qu’aucune politique démocratique réellement sécularisée, socialement progressiste, ne puisse se tenir en deçà du cosmopolitisme, ce qui revient à admettre qu’un sécularisme (ou une « laïcité ») se définissant de façon nationaliste, essentiellement guidée par des impératifs d’unité, d’identité ou de sécurité nationales, ne tarde pas à se contredire et à se détruire lui-même -, comment se fait-il donc que toutes ces constatations ne dégagent pas la voie, mais semblent multiplier les obstacles idéologiques et obscurcir la possibilité même de solutions institutionnelles ?
Je m’explique : non seulement je ne pense pas qu’on puisse isoler l’un de l’autre le sécularisme et le cosmopolitisme, en tant que concepts politiques, mais les discussions véhémentes auxquelles ils donnent lieu me persuadent plus que jamais de la nécessité qu’il y a à étudier chacun en fonction et dans les termes de l’autre3. Cependant il est (ou il devrait être) désormais bien clair qu’une telle conjonction introduit une terrible incertitude dans chacune des déterminations que nous avons l’habitude de ranger sous ces noms : si violente en vérité qu’on peut se demander s’ils demeureront reconnaissables par delà les épreuves auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui. Ici je suis tenté (avant de revenir plus loin sur certaines des analyses qu’elle a consacrées au problème de la « laïcité » française) de reprendre à mon compte le titre du livre que l’historienne américaine Joan Scott avait naguère consacré à la « citoyenneté des femmes » dans la constitution française : « Only paradoxes to offer »4. Je crois qu’on touche ici une fois de plus à ce que, en d’autres lieux, j’ai tenté d’analyser comme le caractère antinomique du développement de la citoyenneté en tant qu’institution historique : la citoyenneté entretient une relation intrinsèque avec les processus de démocratisation de la politique, mais elle demeure irréductible à la démocratie « pure ». Il s’agit là, bien entendu, d’un raccourci brutal, mais qui peut aider à faire comprendre dans quelle intention je représente le cosmopolitisme et le sécularisme comme deux aspects d’un projet de démocratisation de la démocratie qu’il n’est possible ni d’écarter arbitrairement l’un de l’autre ni d’additionner sans les remettre en question. Nous touchons là, en d’autres termes, à des limites internes du projet démocratique que nous n’avons aucune certitude de pouvoir surmonter dans un avenir prévisible. Il importe d’autant plus d’en discuter à fond la nature5.
Doubles contraintes
Mais en voilà assez avec les abstractions, alors que tout ici relève des situations concrètes, dépend des circonstances. Je voudrais donc me tourner vers un exemple dans lequel l’interférence du cosmopolitisme et du sécularisme apparaît avec évidence, obligeant aussi à proposer des distinguos. Je l’emprunte à l’histoire française récente, sans croire pour autant que sa portée soit purement locale : plus exactement je considère que l’écho qu’il a produit au-delà de nos frontières (au prix, souvent, de fortes simplifications) contribue à en éclairer la signification, car cet écho ne relève pas seulement de la malveillance, même quand il prend la forme de critiques radicales des conceptions françaises. Il s’agit, on l’aura deviné, de revenir un instant sur les controverses dont s’est accompagnée l’interdiction par l’Etat français du port du « voile islamique » ou hidjab par les jeunes filles fréquentant les écoles publiques, au nom du « principe de laïcité » entendu comme un principe constitutionnel. En pratique l’interdiction place les jeunes filles qui – pour diverses raisons – ont décidé de porter le voile devant l’alternative (aliénante au sens propre du terme) de se dépouiller d’un vêtement qui revêt pour elles une valeur d’intimité et d’identité, ou de se trouver exclues du système public d’éducation (donc de leurs chances de réussite professionnelle et de reconnaissance sociale). Notons au passage que les critiques juridiques, morales et politiques dont cette législation a fait l’objet, très répandues dans le monde entier (des conservateurs aux libéraux, des universitaires aux militants des droits de l’homme ou porte-paroles des communautés religieuses, et de l’Amérique du Nord au Moyen Orient et au sous-continent indien), font elles-mêmes partie de ce cadre cosmopolitique et produisent d’importants effets en retour dans le débat français.
Passons vite, par nécessité, sur les considérations qu’appellerait la question de l’équivalence entre le français « laïcité » et l’anglais « secularism ». Il faudrait les replacer dans un paradigme historique beaucoup plus général. Les deux termes, évidemment, ne sont pas substituables, mais ils ne sont pas non plus totalement extérieurs l’un à l’autre. Si l’on prend comme référence la chaîne secular-secularism- secularization, ce que la notion de laïcité institutionnalisée (et même constitutionnalisée) en France met au premier plan n’est pas l’égalité des droits entre confessions religieuses dans la sphère publique, mais la séparation de l’Eglise (plus généralement des religions) et de l’Etat, et par extension des pratiques ou croyances religieuses et des fonctions sociales placées sous l’autorité de l’Etat (ou sous son contrôle normatif), en particulier l’éducation6. En d’autres lieux, j’ai suggéré de rattacher cette orientation à une conception hobbesienne du « contrat social » plutôt qu’à une conception lockienne. Ce primat de l’Etat (ou de la puissance publique) sur la société civile correspond certainement à une tendance générale des Etats-nations modernes, mais il n’en représente pas la seule forme de réalisation, ni même celle qui devient historiquement dominante. Il y a dans la laïcité « à la française » (qui a été prise pour modèle – généralement signalé par la transcription du terme – dans d’autres pays, pas uniquement de culture catholique) un radicalisme ou un extrémisme qui n’est pas représentatif de la façon dont se posent les questions « théologico-politiques » dans l’ensemble de la tradition occidentale, mais qui peut servir de révélateur aux contradictions sous-jacentes à toute réflexion sur le sécularisme et la sécularisation. C’est pourquoi, bien que les commentaires suscités dans le monde par la politique française – qu’ils lui soient hostiles ou non – soient parfois de nature à engendrer l’insatisfaction ou la perplexité de celui qui en a observé de l’intérieur les finalités et les vicissitudes, je les prends très au sérieux et les considère comme éclairants, en tout cas révélateurs7.
J’avais vivement critiqué en son temps la loi française et suis toujours favorable à son abrogation, en dépit des conditions relativement pacifiques dans lesquelles, finalement, elle a été mise en œuvre8. Je ne vois pas, en effet, comment une contrainte exclusivement exercée sur des individus de sexe féminin qu’on se représente comme les victimes d’une oppression religieuse ou d’une domination patriarcale, et qui s’énonce sous la forme d’une alternative sans échappatoire (car la loi c’est la loi…) : ou bien se dévoiler ou bien sortir de l’école publique, pourrait avoir le moindre effet libérateur, la moindre valeur éducative. Elle redouble la disparité de traitement qu’elle prétend combattre, et dénie aux sujets eux-mêmes toute possibilité d’expression de leurs motifs, du sens conféré à leur conduite (nécessairement complexe), toute possibilité d’auto-détermination ou de dialogue. « La loi c’est la loi ». Elle les assujettit de façon distinctive au nom de la liberté et de l’égalité, mais ne les traite jamais comme les citoyen(ne)s que postule l’école « laïque » et qu’elle prétend former. Elle doit donc avoir d’autres mobiles, parmi lesquels – à côté de la manifestation d’autorité administrative qui s’exerce ici aux dépens de la liberté de conscience des jeunes musulmanes – on ne peut exclure, vu les circonstances et la teneur des débats, l’intention de donner satisfaction à certaines composantes racistes et islamophobes de la société française (ce qui revient aussi à les légitimer). Nous nous trouvons donc, semble-t-il, exactement dans la situation postcoloniale décrite et interprétée par Gayatri Spivak au moyen de la formule : « des hommes blancs (européens) entreprennent de libérer les femmes de couleur (indigènes) de l’oppression que leur font subir les hommes de couleur (indigènes)9). ». Mais les choses sont-elles réellement aussi simples ? N’existe-t-il pas au sein de la même situation un scénario inverse, dont il faut certes mesurer au plus juste l’importance et les moyens d’action (ils ne relèvent pas de la loi, mais de la « tradition », qui peut être « inventée » pour les besoins de la cause), mais dont il serait stupide d’ignorer la réalité : « des hommes de couleur (indigènes) veillent à ce que les femmes de couleur (indigènes) ne soient pas libérées par les hommes blancs (européens)10. » On en eut l’illustration presque caricaturale lorsque, pour protester contre l’interdiction, certaines associations islamiques organisèrent des manifestations où des jeunes et petites filles portant ironiquement des foulards tricolores défilèrent dans la rue, soigneusement encadrées par des hommes adultes (clercs ou militants) qui veillaient à empêcher les discussions avec les journalistes ou les passants.
C’est le moment de revenir sur les thèses soutenues par Joan Scott dans son livre Politics of the Veil, consacré à une analyse détaillée du sens et des origines de la loi française d’interdiction11. Pour l’essentiel Joan Scott établit une continuité entre les représentations de la « femme indigène » (en particulier celles de la femme algérienne musulmane) qui structuraient l’imaginaire « orientaliste » de la colonisation, et les stéréotypes appliqués aujourd’hui aux relations entre les sexes dans les familles d’origine immigrées (particulièrement « arabes ») par le discours nationaliste dominant. Ceci me semble difficilement contestable. Mais, tordant le bâton à l’extrême dans le sens du paradigme « postcolonial », cette analyse la conduit à reprendre à son compte l’idée d’une opposition frontale entre la « pudeur » féminine caractéristique de la culture traditionnelle dans le monde musulman, et la « violence » de l’exploitation symbolique à laquelle la Modernité occidentale soumet le corps des femmes et leur image, qui se déchaînerait dans le règne de la publicité commerciale. Elle en vient alors à rassembler sous un seul concept les tendances de la consommation capitaliste de masse (dont fait partie l’industrie du sexe, qui instrumentalise en ce sens la domination masculine) et celles du républicanisme à la française, qui se fonde en particulier sur la neutralisation (voire la dénégation) des différences anthropologiques (qu’elles soient, d’ailleurs, de sexe, de religion, ou de culture) : c’est ce qu’elle appelle « l’universalisme abstrait ». Mais il me semble qu’on court-circuite ainsi les analyses qui seraient précisément nécessaires pour rendre compte des contradictions de l’universalisme – en particulier pour ce qui concerne les influences respectives de l’équivalence marchande et de l’égalité devant la loi. Ledit « universalisme abstrait » se trouve à son tour caractérisé d’une façon redoutablement abstraite et anhistorique12.
Plutôt que d’invoquer alternativement les points de vue inconciliables de la résistance à l’impérialisme culturel et de l’émancipation par rapport à des cultures traditionnelles oppressives, je crois qu’il faut décrire la réalité de situations concrètes de double contrainte. Le fait est que, lors des épisodes successifs de la controverse relative à l’autorisation ou à l’interdiction du port du voile par les lycéennes aussi bien que dans la nouvelle discussion relative à l’autorisation ou à l’interdiction du port de la burqa dans les espaces publics (même si les données juridiques, politiques et sociologiques ne sont pas du tout les mêmes), des sujets-femmes se trouvent prises dans l’entre-deux des conflits et des stratégies de deux groupes qu’on peut caractériser l’un et l’autre comme phallocratiques (ce qui ne veut pas dire qu’ils soient composés exclusivement d’hommes) et qui font de la disposition du corps des femmes le champ d’affrontement et l’enjeu de leurs volontés de puissance, ou de la défense de leur hégémonie (même si, répétons-le, leurs forces sont inégales, ou plutôt ne s’exercent pas dans les mêmes lieux avec les mêmes instruments de contrainte) : l’un parlant le langage de la tradition religieuse (de façon plus ou moins orthodoxe), l’autre parlant le langage de l’éducation laïque et de l’émancipation des femmes (de façon plus ou moins doctrinaire). Je m’attends bien entendu à ce qu’une telle description – surtout présentée sous une forme aussi dépourvue de nuances – ne fasse pas l’unanimité. Mais elle me paraît trop fortement suggérée par l’histoire des affrontements récents pour qu’on puisse se dispenser d’en examiner les implications. Avant de venir au point principal, qui concerne l’usage concurrent des catégories de « religion » et de « culture », je dois néanmoins formuler deux remarques intermédiaires.
Cosmo-politiques et conflits d’universalités
La première concerne l’espace dans lequel se cristallisent les débats et les conflits auxquels je viens de faire allusion. Cet espace est désormais cosmo-politique, expression dans laquelle il faut faire entendre alternativement chacun des deux termes qui la composent. Les différends relatifs à l’interprétation du rapport entre cultures, religions, et institutions publiques sont bel et bien cosmo-politiques, en ce sens qu’ils cristallisent des éléments venant du monde entier et de son histoire au sein d’un microcosme national particulier, ouvert et instable. Plus on cherche à fermer sur lui-même un problème « national », plus en réalité on le dénature et on le déstabilise. Telle est évidemment la logique des troubles qui éclatent dans ce qu’on pourrait appeler des « banlieues-monde », où les conséquences des migrations, des diasporas, des colonisations et des décolonisations ont banalisé la rencontre des héritages culturels et des religions, donc leurs conflits, sur le fond de gigantesques inégalités de statut social et de reconnaissance institutionnelle. L’aspect postcolonial est crucial mais il est ambivalent : le choc des cultures domestiques et diasporiques prolonge l’histoire de la colonie par delà sa mort officielle (et d’autant plus insidieusement qu’elle est refoulée ou travestie dans la mémoire) ; mais il n’en constitue pas la reproduction à l’identique (contrairement à ce que soutiennent parfois des discours militants qui cherchent à lever le refoulement), plutôt une traduction et un renversement des effets (ce qui, naturellement, s’agissant de rapports d’oppression ou de domination, ne peut se faire sans luttes déterminées). Plus que jamais il nous faut donc savoir reconnaître que le milieu social dans lequel nous tentons de donner forme « politique » à nos intérêts ou à nos croyances est le résultat d’un passé violent dont la trace engendre de nouveaux conflits. Il n’y aurait pas de société mondialisée s’il n’y avait pas eu un procès séculaire de « mondialisation du monde » dont les forces motrices ne furent pas seulement des processus capitalistes anonymes d’accumulation et de « marchandisation », mais des histoires d’empire, de colonisation et de décolonisation ou de néo-colonisation – donc des histoires de maîtrise et de servitude. Cela suffirait à faire comprendre pourquoi ce qui nous apparaît comme cosmo-politique est aussi cosmo-politique au sens fort du terme : non seulement objet de qualification juridique et d’intervention étatique, mais dynamique de conflits sociaux et idéologiques, qui n’ont pas une signification univoque. Mais l’exemple dont je suis parti montre davantage : il attire notre attention sur le fait que dans une situation historique et sociale déterminée, lorsque des discours estampillés comme religieux rencontrent un contre-discours (par exemple celui de la laïcité ou du « sécularisme d’Etat »), celui-ci exhibe une tendance inverse à se voir lui-même sacralisé, c’est-à-dire qu’il se trouve surdéterminé par l’une des caractéristiques typiques du « religieux ».
Allons-nous en conclure pour autant que les politiques de sécularisation (et particulièrement les politiques de « laïcisation » de l’éducation, de la vie publique, de l’espace social) relèvent elles-mêmes de la catégorie du conflit religieux ? Au contraire, il n’existe rien de tel qu’un conflit purement religieux dans le monde d’aujourd’hui, et tout affrontement entre des représentations et des communautés religieuses, ou entre elles et leurs antithèses séculières, est toujours fondamentalement politique. On peut penser qu’il en alla toujours de même, mais il y a aussi quelque chose de nouveau dans les modalités de ce complexe théologico-politique, qui tient à ce que la relativisation des frontières nationales et des souverainetés qu’elles isolent les unes des autres, ainsi que l’importance croissante des migrations, rendent de plus en plus artificielle l’assignation du religieux à la sphère du particulier (ou des « particularismes »), tandis que le séculier (sous les espèces de la « raison publique ») occuperait par définition la place de l’universel. Mais ceci ne conduit pas à une relativisation généralisée : il s’agit plutôt de conflits entre des universalismes concurrents13. Plus précisément, la crise des universalismes théologiques, commencée à l’aube de la modernité, se poursuit indéfiniment, tandis que celle des universalismes politiques a irréversiblement débuté. On s’explique du même coup pourquoi la distinction juridique des sphères « publique » et « privée », exclusives l’une de l’autre, s’applique de plus en plus difficilement à la différence de la communauté des citoyens et de l’appartenance religieuse. A moins d’un supplément de contrainte politique. Un discours et une institution « publics » qui tirent essentiellement leur légitimité d’une formation historique nationale (et donc nationaliste, y compris sous la forme « républicaine ») n’est pas en lui-même plus universel ou universaliste que le discours d’une religion transnationale. En tout cas son degré supérieur d’universalité ne peut se proclamer a priori : il faut le démontrer expérimentalement, en particulier sur le terrain des possibilités d’émancipation qu’il offre à ses citoyen(ne)s. Lorsqu’une différence religieuse ou théologique devient conflictuelle (et il nous appartient à chaque fois de déterminer les conditions qui cristallisent le conflit ou le rendent antagoniste), il s’agit d’un conflit qui est virtuellement cosmo-politique. C’est pourquoi les notions de « cosmopolitisme » (hérité de la tradition philosophique ancienne et classique) et de « cosmopolitique » (intensifiée par les effets de la mondialisation), très proches l’une de l’autre, ne peuvent plus s’articuler de façon linéaire. La cosmopolitique est une forme de politique particulièrement équivoque, elle n’est faite que de conflits sans solution préétablie : elle ne préfigure pas la réalisation d’un « cosmopolitisme » philosophique, mais elle ne détruit pas non plus purement et simplement la possibilité de s’y référer14. Il est plus juste de dire qu’elle ouvre tout grand le champ de la concurrence entre des cosmopolitismes alternatifs. Et de la même façon je voudrais essayer de montrer qu’elle forme le siège d’une concurrence entre des « sécularismes » alternatifs.
Ceci m’amène à une seconde proposition, tout aussi hypothétique. Parmi les variétés de « cosmopolitisme » qui inspirent des programmes politiques à l’époque contemporaine, on comptera sans hésiter le « multiculturalisme ». Mais n’est-ce pas au passé qu’il faudrait désormais décrire sa puissance politique et philosophique ? Ce ne serait pas en diminuer l’importance historique (moins encore se rallier à un discours franco-centrique qui l’a toujours ignoré ou dénigré), mais poser que sa fécondité dépend désormais d’une critique interne de ses propres limitations et équivoques. On sait bien, naturellement, que le terme a couvert un vaste spectre de positions opposées entre elles dans l’utilisation même de l’idée de « culture ». Ce n’est que par homonymie qu’on peut réunir sous un même concept un « multiculturalisme » comme celui de Charles Taylor ou de Will Kymlicka, pour qui les cultures sont des totalités extérieures les unes aux autres, propriété de communautés historiques auxquelles on appartient par tradition (occasionnellement par assimilation), et dont il s’agit de favoriser la coexistence au moyen d’un pluralisme constitutionnel, de sorte que pour chaque individu « son » appartenance communautaire demeure en dernière instance le véhicule de l’éducation et de la subjectivation, et un « multiculturalisme » comme celui de Homi Bhabha et de Stuart Hall, dont l’horizon historique ultime est un processus incessant d’interaction entre communautés et de métissage culturel, conduisant à l’idée que ce qui rend les sujets capables d’individualisation et de transformation historique est leur capacité de traduction, donc de désidentification15. On sait aussi que les nations modernes postcoloniales ont été très inégalement réceptives à l’une ou l’autre de ces conceptions du multiculturalisme au cours du temps. Mais de toute façon le phénomène contemporain décrit comme « retour du religieux » ou « du sacré » semble bien devoir bouleverser irréversiblement le débat et déterminer une crise de l’idée du multiculturalisme comme réalisation de l’idéal cosmopolitique16. Je ne pense pas tant ici aux effets de discours nationalistes ou xénophobes qui n’ont de cesse de faire prévaloir à nouveau – contre toute évidence historique – l’idée selon laquelle l’homogénéisation culturelle à l’intérieur de certaines frontières de « souveraineté » ou « d’alliance » constituerait la condition de survie des communautés politiques, mais à l’idée plus difficilement contestable que les projets de « constitution multiculturelle » pour la société démocratique sous-estiment considérablement la violence des conflits religieux (ou à base religieuse) et surtout en méconnaissent la nature. Ce que j’interpréterai pour ma part à partir, précisément, de l’idée que ces conflits n’opposent pas des particularismes (auquel cas la « solution » consisterait soit dans leur séparation sous l’égide d’une universalité supérieure, transcendante, soit dans leur intégration à quelque « spiritualité » syncrétique), mais au contraire des universalismes incompatibles. J’accorderai donc tout à fait qu’il est insuffisant et inopérant de vouloir replacer sur un terrain « culturel » et traiter en termes de « multiculturalisme » des antagonismes dont la détermination est pour une part essentielle religieuse. Mais il n’en résulte pas du tout que la question se trouve prise dans l’alternative d’une « guerre de religions » généralisée17 et d’un « œcuménisme » ou d’un « dialogue interreligieux » dans lequel n’entreraient que des voix qui se définissent comme celles de « communautés religieuses », subsumant la détermination politique sous leur autodéfinition narcissique (ou leur étiquetage réducteur, comme c’est souvent le cas pour « l’Islam », mais aussi pour « la Chrétienté »). Je voudrais plutôt chercher une problématique qui ne nous enferme ni dans le langage du culturalisme ni dans celui du théologisme, ni dans l’anthropologie culturelle ni dans les alternatives classiques de la tolérance et de l’intolérance, mais analyse comme tel un différend de citoyenneté dont les enjeux sont politiques, bien que ses sources et sa conscience de soi soient pour une part essentielle (et sans doute irréductible) de l’ordre du religieux ou de la critique du religieux.
« En finir avec la religion » ?
A ce point cependant une autre objection se lève. Parler de permanence ou de retour du religieux, de détermination « religieuse » ou « théologique » s’étendant à la fois au croyances et à leurs critiques séculières, c’est faire usage d’une catégorie imprécise, sinon trompeuse et qui, nous disent aujourd’hui certains philosophes, anthropologues, critiques, interdit par avance toute compréhension des enjeux cosmo-politiques, parce qu’elle contient toujours déjà en elle-même le principe d’une déformation dogmatique.
En France, une telle critique a été esquissée en particulier par Jacques Derrida et Régis Debray, dans des interventions d’autant plus importantes qu’elles sont prudentes et tendent essentiellement à doubler l’intervention dans les « conflits de civilisation » contemporains d’un scepticisme « déconstructeur » envers les notions mêmes qu’ils mobilisent. Derrida a fait observer (à partir d’une lecture critique des étymologies de Benveniste) que le terme de religion dont la signification est toujours dépendante de ses sources romaines et chrétiennes, est à proprement parler un intraduisible dans d’autres langues et d’autres cultures. Son usage impose donc un code « romano-chrétien » sur toute réalité qu’il sert à nommer, y compris lorsque des confessions non-chrétiennes (Judaïsme ou Islam) s’en servent pour revendiquer l’égalité des droits et la reconnaissance, dans une sphère du « religieux » dont les contours sont déterminés en fait par une instance de jugement ou de connaissance qui prétend s’en excepter en vertu de sa nature « séculière » (mais qui en est historiquement issue)18. Ce qui n’empêche pas le même Derrida de présenter la violence du conflit faisant rage autour de la ville de Jérusalem et de la nationalité de ses lieux saints, non seulement comme un phénomène de type colonial (développement tardif de l’hégémonie européenne en Méditerranée, du à des circonstances historiques dramatiques), mais comme une intensification « souveraine » des représentations élaborées par les trois monothéismes abrahamiques à propos des lieux et du contenu de la révélation qui les unit en les divisant19. Dans un brillant essai, Régis Debray a repris ce thème sous une forme légèrement différenteen dénonçant la confusion moderne (précisément « laïque ») entre religion et croyance en Dieu, qui occulte la plus grande généralité du rapport entre religion et appartenance à une communauté ou un « corps » social qui se reconnaît à lui-même (en la « faisant » ou la construisant) une identité collective dépassant la somme des individualités. D’où la proposition de court-circuiter l’héritage chrétien pour revenir à une définition de type « romain » de la religio, et finalement de lui substituer « communion » qui exprimerait mieux cette signification dans la langue actuelle20. Mais cette proposition présuppose (ce que, dirait sans doute Derrida, il faudrait « déconstruire ») le primat de la dimension communautaire (ou de l’effet d’intégration) par rapport à la dimension individualiste (hérétique, mystique, ascétique ou « virtuose » au sens de Weber), ou du moins suggère que la seconde est toujours une anomalie par rapport à la première….
Tala Asad a proposé une tout autre formulation (bien qu’on ait tenté de les utiliser conjointement) dans une série d’essais relatifs à la « généalogie » de l’opposition entre le religieux et le séculier dont l’influence va aujourd’hui grandissant, en particulier dans les discussions sur l’attitude envers l’Islam dans les sociétés occidentales21. L’idée force d’Asad est que la « religion » est une catégorie purement eurocentrique, forgée pour imposer la domination de l’Eglise sur des pratiques et des croyances qu’il s’agit de réduire ou d’incorporer, mais toujours de subordonner à l’intérieur d’un même champ, bien qu’elles n’aient en elles-mêmes rien de « religieux » (comme l’ascèse, le sacrifice, la contrition ou la prière). Tout découpage, toute interprétation des expériences individuelles et collectives non-occidentales au moyen de cette catégorie « missionnaire » et autoréférentielle est donc le sûr garant de leur dénaturation, même lorsqu’elle prétend les « reconnaître » et les valoriser. Or le discours « séculier » (au sein duquel se formule en particulier un programme d’histoire des religions ou de « connaissance du fait religieux », qui forme la contrepartie théorique du projet politique d’élévation de la sphère publique au-dessus des croyances particulières) n’a aucunement aboli les antithèses théologiques internes à la tradition chrétienne dont il représente à la fois la conservation et la critique : il s’est contenté de les déplacer et de les augmenter, ajoutant l’opposition du séculier et du religieux à celles de l’orthodoxe et de l’hérétique, ou de la religion et de la superstition22. Il a ainsi construit un code, dominant dans certaines sociétés où il est à la fois institutionnellement (juridiquement) établi et intellectuellement élaboré, interdisant d’autres façons de construire l’expérience historique. Je crois que cette argumentation est au bout du compte aporétique, mais qu’on doit la prendre très au sérieux, car elle nous rappelle ce fait essentiel qu’il n’y a pas de reconnaissance sans représentation, ni de représentation sans code représentatif. Or un code est dominant ou dominé, mais il ne peut jamais être neutre. Il organise ce que Rancière appelle le « partage du sensible » entre le représentable et l’irreprésentable, autrement dit il « totalise le monde » selon une règle d’inclusion qui comporte inévitablement une face d’exclusion. Mais aucun code de représentation des différences n’est énoncé de l’extérieur du conflit et des rapports de pouvoir qui le constituent, à partir d’un lieu théorique absolu : il en est partie prenante, et constitue une façon de le gérer. Cette situation ne peut manquer de retentir sur la position du problème des rapports entre démocratie et représentation. Edward Said et d’autres à sa suite, reprenant ou rectifiant ses analyses, ont étendu à tout l’espace de la « culture », avec ses dimensions normatives, performatives et figuratives, l’antithèse classique en philosophie politique entre position dominante et position dominée dans le champ de la représentation (autrement dit la différence entre le fait d’être représenté par des pouvoirs ou des discours théoriques imposés, et le fait de se représenter, c’est-à-dire en réalité de se présenter dans la forme d’une revendication d’émancipation)23. Or non seulement le débat sur « l’orientalisme » n’est pas achevé, mais il se déplace sur le terrain des relations entre la religion et la culture : ainsi lorsque l’Eglise catholique par la voix de son magistère ou d’intellectuels qui en sont proches reprennent à leur compte l’idée des « racines chrétiennes » de « l’identité européenne » et du rapport censément incomparable qu’elle établirait entre la foi et la raison24. Et ainsi de suite, car bien entendu certains critiques de la « domination occidentale » dans le monde extra-européen ou chez les intellectuels qui tentent d’en théoriser l’émancipation des cadres de pensée de la colonisation (y compris la « modernité », le « rationalisme », « l’historicisme ») s’empressent de reprendre l’idée à leur compte pour en faire une application inversée contre ce qu’ils appellent globalement « l’Occident ».
Le fait de prendre au sérieux, comme je l’ai suggéré plus haut, l’idée qu’il puisse y avoir une multiplicité de « cosmopolitismes », et de la mettre en rapport avec la critique interne, ou la déconstruction de ce « sécularisme » qui a été historiquement institué dans le cadre de l’Etat-nation, comme l’un des instruments de sa souveraineté, nous amène cependant à poser encore autrement le problème de « codage » ou de « codification », qui est aussi celui du régime de traduction au moyen duquel des sujets collectifs se représentent les uns pour les autres (en général par la médiation de discours que leurs fournissent des « intellectuels organiques »). Il est clair que la façon dont Asad et d’autres nous enjoignent ici de remettre en question le « code religieux » et à sa suite le « code séculier » hérités de l’histoire du Christianisme, de ses élaborations théologico-juridiques et de ses conflits internes, dont le pivot est la catégorie même de « religion », ne peut être écartée d’un revers de main. Est-ce à dire qu’elle ne comporte elle-même aucune contradiction, et qu’elle suffise à se libérer du « code » dominant qui prescrit et limite les possibilités de traduction, de représentation des différences? Je n’en suis pas sûr, et d’abord pour cette raison logique que l’effort pour se dispenser de la catégorie du « religieux » ne peut être mené à bien qu’en ayant recours à une autre catégorie anthropologique, qui est généralement celle de « culture »25. Or la catégorie de « culture », tout comme celles de « société », de « droit », de « politique » ou même d’ « Etat », si l’on veut aller jusqu’au bout du projet déconstructif, doit nous apparaître tout aussi « eurocentrique » ou « occidentale » que celles de religion et de sécularisme (ou de laïcité). Non moins qu’elles, elle résulte du fonctionnement des grands appareils de pouvoir-savoir mis en place par l’Occident et relayant son hégémonie, comme la science universitaire. Le problème n’est donc peut-être pas tant d’en éliminer telle ou telle que de les rectifier toutes, ainsi que leurs démarcations.
Culture, religion, ou idéologie ?
N’aurions-nous donc fait que tourner indéfiniment dans le même cercle, au risque de n’engendrer qu’un scepticisme stérile ? Je dirai que non, à la condition d’envisager un nouveau dispositif conceptuel, qui ne se fonde pas sur la nécessité de choisir entre une problématique de la « culture » et une problématique de la « religion », ou sur la réduction d’un terme à l’autre. Ce que je propose, c’est de faire un usage critique de la dualité même des concepts en présence, de façon à identifier certaines différences pertinentes, certes subtiles, mais cruciales pour analyser les conflits qui se réfèrent à des enjeux ou à des idéaux relevant de la religion et de la culture. Je ne dissimulerai pas que ceci constitue aussi, de ma part, une façon de réhabiliter une catégorie quelque peu passée de mode aujourd’hui : celle de l’idéologie. Pourquoi cette tentative incongrue, même si le terme désigne ici avant tout un instrument heuristique et formel, dont l’application dépendra de l’objet lui-même26 ? Non pas, sans doute, pour réduire indifféremment tout discours à une fonction « idéologique » qui serait aussi une façon de le disqualifier, mais pour compliquer la « démarcation sémantique » de la culture et de la religion, et ainsi la déplacer dans un nouvel espace. Tout autant que de chercher à éclairer les débats relatifs aux effets politiques de la religion et de la culture, mon objectif est donc, au fond, d’examiner en quoi une théorie de l’idéologie (ou de ce qu’on appelait naguère du côté de chez Althusser « l’instance idéologique » de la pratique sociale) pourrait bénéficier de cet emploi qui en fait une catégorie « médiatrice » articulant entre elles les dimensions « culturelles » de la vie sociale et ses dimensions « religieuses ». Formellement, je chercherai donc à décrire non seulement un rapport logique, mais une dynamique de transformations et d’activités, en partant de l’idée que des processus de généralisation, de routinisation27 et de métissage « culturels » sont capables de modifier et même de désagréger sur le long terme les modèles « religieux » de l’existence, de la subjectivation, de la vie communautaire, mais aussi que les « symboles religieux » associés à des rites, à des conversions, à des croyances (qui peuvent être de l’ordre de la révélation, du mythe ou du dogme) ont le pouvoir de cristalliser les différences culturelles, et de les intensifier. Ils peuvent donc restreindre la plasticité des cultures, mais aussi dans certains cas radicaliser leurs tensions internes et les transformer en conflits politiques. On peut aussi poser hypothétiquement que ce qu’un wittgensteinien appellerait les « formes de vie » : les habitudes culturelles et les imaginaires correspondants, ne « voyagent » qu’avec les individus et les groupes humains qui les portent, tandis que les rites et les symbolismes religieux qui sont plus « abstraits » (ce qui ne veut pas dire qu’ils correspondent à des expériences subjectives moins intenses) sont susceptibles de transferts beaucoup plus distants : on se « convertit » à une croyance et non à une culture, qu’on peut seulement adapter et à laquelle on peut s’adapter plus ou moins aisément, parce qu’elles n’investissent pas le corps et n’affectent pas l’inconscient de la même façon28. Mais une autre raison me fait penser qu’on pourrait avoir profit à réactiver ici la catégorie de l’idéologique, dans une forme aussi peu dogmatique que possible : c’est le fait que, si général soit-il, un concept de l’idéologie implique toujours une relation constitutive avec son propre dehors, et par conséquent il inscrit le manque, l’inadéquation dans sa propre constitution. Il est contradictoire de parler d’idéologie si on pense que l’idéologie « est tout ». On veut donc ici suggérer que la culture et la religion, ou si l’on préfère les aspects culturels et religieux de l’idéologie, ne contiennent pas en eux-mêmes la totalité des causes qui produisent leur propre combinaison : l’équation qu’il nous faut avoir à l’esprit ne saurait être de la forme : culture + religion = idéologie, mais plutôt : culture + religion ± X = idéologie.
Que serait plus précisément cet X marquant l’élément d’extériorité interne aux processus idéologiques ? Un marxiste vous dira : l’économie (la production), un sociologue durkheimien : la société (par exemple la « division du travail social »), un foucaldien : le pouvoir (ou les « rapports de pouvoir »), un wébérien : la domination (légitime ou illégitime), un lacanien : le « réel »…. Il faut se souvenir à la fois de cette extériorité irréductible et de son équivocité lorsqu’on cherche à analyser des situations politiques qui sont représentées soit comme soumises à des dynamiques culturelles, soit comme dominées par des forces religieuses (à moins qu’on ne se rabatte sur une synthèse bâtarde de religion et de culture comme le « choc des civilisations »). Non seulement la religion et la culture ne s’additionnent pas spontanément, mais leurs effets combinés sont toujours « surdéterminés » par des processus socio-économiques et des rapports de pouvoir qui ne sont en fait ni l’un ni l’autre. A cette place supplémentaire que ménage leur opposition, il faut loger la « cause absente », les effets venus d’une « autre scène » sans lesquels elles n’auraient elles-mêmes aucun effet historique.
Si donc nous nous contentions d’une simple articulation du culturel et du religieux, nous ne sortirions pas de l’alternative entre les deux réductions possibles du culturel au religieux, ou inversement. Toutes deux, sans doute, ont produit des entreprises théoriques de grande envergure, alimenté de « grands récits » du devenir de nos sociétés, dont il n’est pas inutile de chercher à tirer les leçons. Pour une version « forte » de la réduction du religieux au culturel, on peut toujours se tourner vers l’œuvre de Clifford Geertz, pour qui le principe directeur est l’inclusion de la « religion » dans l’ensemble des « systèmes culturels » qui confèrent symboliquement une « aura de réalité » aux conceptions du monde et aux mode de vie d’où les hommes tirent les motifs habituels de leurs actes (ce qu’il appelle le « general order of existence »)29. De ce point de vue, à l’évidence, c’est la culture qui forme une catégorie universelle, tandis que la religion en est un aspect particulier, non seulement parce que la religion en tant que « système symbolique » n’est qu’un élément de la culture parmi d’autres, mais de façon plus décisive au regard de la conjoncture actuelle, parce que c’est au niveau des différences entre cultures, qu’il est possible de procéder significativement à une étude comparative des différences entre les sociétés et les communautés humaines. Ce ne sont pas les religions ou les systèmes religieux qui entrent en contact, s’influencent, s’attirent ou se repoussent par l’intermédiaire de leurs porteurs individuels ou collectifs, mais les cultures vécues : la culture, en ce sens, est concrète, « totale », la religion est abstraite, « sectorielle ». Un exemple symétrique, tout aussi instructif, de réduction du culturel au religieux nous est fourni par le programme wébérien de sociologie comparée des religions. Weber, on le sait, ne développe pas seulement l’idée que des « éthiques religieuses » différentes correspondent aux formations économiques de l’histoire et aux « rôles » sociaux qu’elles impliquent (comme la dépense, l’épargne et l’accumulation). Il suggère avec force que les individualités religieuses dépendent en dernière analyse d’axiomatiques de la « vie » (ou du « sens ») irréductibles entre elles, qui sont autant de tentatives pour se représenter et gérer les rapports du mondain et de l’extra-mondain, du pur et de l’impur, du mal (ou du « péché ») et du salut, de l’action et de la contemplation, du souci de soi et de la fraternité… C’est donc, ici, la « religion », ou mieux le souci religieux, qui se trouve universalisé, et les cultures apparaissent comme des modalités historiques de l’adaptation des axiomes religieux aux circonstances30.
Je suis tenté de proposer ici un raisonnement quasi-hégélien pour transformer l’opposition en une dialectique : chacun de ces points de vue est « vrai » à sa façon, ou plutôt ce qu’il contient de vrai est son rapport négatif à l’autre. La conséquence méthodologique qu’il faut en tirer semble donc la suivante : nous ne sommes pas très sûrs de ce que recouvrent exactement, chacune pour son compte, isolément, les catégories de « culture » et de « religion », et pourtant même si aucun des deux termes de l’opposition n’est en lui-même absolument clair, si l’un et l’autre recouvrent dans la pratique des activités et des processus qui sont matériellement « les mêmes », nous avons besoin de marquer formellement une différence, une polarité mouvante du « religieux » et du « culturel ». C’est l’instrument critique imparfait dont nous pouvons essayer de nous servir pour ouvrir, problématiser des notions rigides comme celle de « communauté », ou de l’appartenance des individus en tant que « sujets » à des communautés, et pour y faire pénétrer le point de vue de l’action réciproque, des changements de sens, du devenir aléatoire des institutions dans lesquelles se cristallisent les destinées sociales ou asociales des individus, compatibles ou incompatibles entre elles. En ce sens la distinction des aspects « religieux » et « culturels » du processus idéologique apparaît comme une arme contre l’usage indiscriminé de la catégorie de « communauté », qui ne cesse d’empoisonner les débats sur le communautarisme et l’universalisme. La « communauté » comme telle n’est, me semble-t-il, ni religieuse ni culturelle, elle n’est pas donnée, mais elle s’autonomise relativement et s’isole fictivement, de façon plus ou moins contraignante par rapport à d’autres, dans un procès qui est essentiellement politique (ou même, aujourd’hui, « cosmo-politique »). Pour cela elle combine toujours du religieux et du culturel plus ou moins X, en fonction de déterminations « matérielles » ou « réelles » d’une autre nature, qu’il faut rechercher du côté des rapports économiques et des rapports de pouvoir, mais aussi et peut-être surtout de leur manque.
Révolutions religieuses et différences anthropologiques
Je voudrais alors introduire une dernière hypothèse (sans doute ne pourrai-je guère faire plus que de l’énoncer) : les déterminations de la culture et de la religion sans doute ne renvoient pas à des matérialités distinctes, elles portent sur un même « objet ». Mais celui-ci est si général, si plastique, qu’il prête à des constructions ou à des représentations hétérogènes, voire incompatibles. Son concept relève plutôt d’une disjonction (d’un système de différences) que d’une conjonction (d’une synthèse sous un critère unique). Comme il s’agit ici clairement d’anthropologie générale (ou philosophique), nous pourrions nous contenter de dire qu’il s’agit de « l’humain » et de sa variabilité propre. Pour faire un pas au-delà de cette tautologie (un pas seulement…), je préfère dire qu’il s’agit de la différence anthropologique comme telle. En prenant le contrepied de la « différence ontologique », j’ai proposé cette catégorie il y a quelques années, de façon encore provisoire, pour désigner des différences (comme la différence sexuelle, bien entendu, en tant qu’elle structure l’attribution des rôles « masculins » et « féminins » dans la famille et plus généralement dans la société, mais aussi la différence du normal et du pathologique, ou du mental et du physique, etc.) ayant ceci d’embarrassant (mais par là de fondamental) qu’on ne peut ni les éluder (ou en nier la réalité) ni les fixer de façon stable, univoque ou incontestable. Leur « lieu » ou « tracé » exact, en tant que modes de classification des êtres humains et des conduites de chacun, demeure donc par définition problématique31. Il est évidemment tentant (ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse de travail) de poser – puisque de telles « différences » font l’objet, contradictoirement, de définition et de déplacement, de normalisation et de perturbation – que c’est la « culture » qui fait le travail de normalisation, de « routinisation », pour parler comme Weber, et la « religion » qui opère les bouleversements ou les sublimations, selon des modalités révolutionnaires ou mystiques. L’institution de l’humain n’est pensable qu’au prix de cette tension32.
On dira que cette division du travail a quelque chose de très mécanique : c’est vrai, aussi ne l’ai-je proposée que comme une allégorie, indiquant que les fonctions contraires appelées par l’incertitude de la différence anthropologique ne relèvent pas des mêmes « systèmes » au sein de l’idéologie. A rebours des indications fournies par les anthropologues et les historiens qui cherchent plutôt à les concilier ou à les réduire l’un à l’autre, je prends donc le risque de pousser l’idée d’une polarité du « religieux » et du « culturel » jusqu’à la figure dialectique d’un antagonisme : d’un côté je mets les évolutions culturelles, les « inventions de la tradition », de l’autre je mets les « réformes » et les « révolutions religieuses ». Il s’agit évidemment d’attirer l’attention sur le rôle décisif des symbolismes religieux, non seulement dans l’organisation et la sacralisation de structures de pouvoir et d’hégémonies culturelles, mais dans l’investissement des différences anthropologiques, qui les radicalise, poussant à l’extrême les distributions de rôles sociaux et de pratiques que la culture a pour fonction essentielle de normaliser et d’inscrire dans l’évidence du quotidien. Mais que veut dire « radicaliser » ? Cela peut vouloir dire, selon les circonstances, sacraliser, absolutiser, idéaliser, sublimer, ou au contraire « dé-construire » ou « in-déterminer », en introduisant, par le biais du mythe ou de la mystique, un élément de transcendance par rapport au quotidien. C’est pourquoi une telle façon de reconstruire les tensions au sein de l’idéologique débouche sur des questions-limites comme celle des « révolutions religieuses » ou des transformations révolutionnaires des traditions religieuses (souvent appelées « réformes »en Occident sur le modèle luthérien et calviniste) et des effets politiques qu’elles peuvent entraîner. Les exemples plus ou moins récents, encore d’actualité, ne manquent pas : on peut discuter des « religions séculières » (ou « religions politiques ») qu’auraient été le nazisme et surtout le communisme, mais la « Théologie de la Libération » en est évidemment un33 ; il se pourrait que le “féminisme islamique” en soit un autre, si l’on privilégie dans sa définition l’objectif symbolique d’une remise en question des structures de domination “culturelles” qui, dès les premiers temps de la révélation coranique (avant ou après la mort du Prophète), ont du se combiner étroitement avec les principes théologiques du monothéisme pour inscrire la régulation de la sexualité au point même de l’articulation entre l’ordre cosmique et l’ordre politique, entre la « révélation » et la « communauté »34. Il ne sera sans doute pas moins crucial d’observer le surgissement et le développement de nouvelles religions plus ou moins syncrétiques, qui conféreront une nouvelle signification à la notion même de « religieux ». Dans quel milieu matériel surgiront-elles, sinon précisément dans le champ de la « culture » favorisée par la mondialisation capitaliste et par les tensions extrêmes qu’elle engendre – donc aussi au besoin contre elle ? Je pense particulièrement à la conscience écologique « profonde » qui peut, voire doit, prendre la forme d’un renouveau des « religions de la nature » naguère désignées comme panthéisme ou comme polythéisme, associant éventuellement la personnification de la Terre (Gaia),le « souci de la vie » et le sentiment de la communauté affective liant entre eux les « animaux humains » et « non-humains », avec l’imaginaire de la « vie artificielle » ou de la prolifération des assemblages homme-machine, et prescrivant les nouveaux modes de vie, les disciplines individuelles et collectives correspondantes35.
A partir de l’hypothèse des nouvelles religions nous pouvons aussi évoquer celle d’un nouveau sécularisme. La première relève en partie de la conjecture (même si elle se fonde sur de nombreux « signes des temps »), mais la seconde semble posséder aussi les caractères d’un impératif politico-philosophique, dont les termes et les moyens requièrent d’urgence que nous nous y employions. Essayons d’en indiquer brièvement les raisons.
Sécularisme sécularisé : le médiateur évanouissant
Une première raison, la plus insistante, nous ramène à l’idée que le jeu de la culture et de la religion dans le complexe idéologique n’existe qu’en fonction d’un « extérieur » (ou comme diraient les lacaniens, d’un « réel ») : c’est la mondialisation elle-même, en tant qu’elle prend des formes dévastatrices, voire catastrophiques pour l’environnement naturel et par voie de conséquence pour l’humanité. De ce point de vue la question d’un sécularisme de l’époque de la mondialisation ne diffère pas vraiment de celle du devenir de l’universalisme et du sens même de la catégorie d’universalité dans la conjoncture actuelle. De quel langage disposons-nous pour nous convaincre les uns les autres qu’il existe des risques et des intérêts qui sont « communs à tous les hommes », ou plutôt quelles sont les alternatives idéologiques auxquelles cette énonciation donne lieu ? Même si l’on s’accorde avec certaines figures marquantes de la critique « postcoloniale » d’aujourd’hui (comme Paul Gilroy et Gayatri Spivak) pour appeler « planétarité » plutôt que « cosmopolitisme » l’ensemble de contraintes et d’impératifs qui, d’une ou façon ou d’une autre, doivent trouver à s’exprimer dans la conscience politique sous des formes accessibles à tous les habitants de la planète, on n’élimine pas pour autant toute équivocité36. L’idée d’une communauté d’intérêts des individus et des groupes humains (ou plus généralement vivants) qu’il faudrait imposer pour limiter les effets de la concurrence sauvage et de l’individualisme capitaliste, éviter l’autodestruction de l’humanité et avancer vers une « civilisation » de l’âge post-moderne dans laquelle coexistent les « communautés » de toute sorte qui ont besoin du même environnement pour vivre, n’a en soi rien d’absurde. Mais on voit bien aussi que, pour passer du statut d’un horizon moral ou d’un calcul utilitaire à celui d’une construction politique (qui implique aussi, selon toute probabilité, une reconstruction du politique), elle a besoin d’être elle-même « universalisée ». En d’autres termes, pour le dire dans un langage gramscien, elle doit se faire « sens commun ». Il n’est pas nécessaire de se réclamer du marxisme-léninisme pour deviner que cette universalisation ne se fera qu’au prix de conflits sociaux très violents, dans lesquels les intérêts immédiats des dominants et des dominés se heurteront sans que soit donné a priori aucun horizon de réconciliation, ou même de reconnaissance. La science n’y suffira pas. Je postule cependant que la possibilité, tout à la fois, de faire face à ces conflits et d’y prendre part sous une forme « civilisée » ne dépendra pas de la constitution d’une nouvelle religion, même s’il ne faut pas exclure de l’idée de « planétarité » des composantes religieuses, liées en particulier aux dimensions apocalyptiques du risque écologique, et des « peurs » qui lui sont associées. Elle dépend plutôt de la découverte d’une nouvelle articulation entre socialisme, internationalisme, multiculturalisme, et d’un sécularisme en quelque sorte de second degré – une « sécularisation du sécularisme » lui-même, c’est-à-dire une forme critique et autocritique de ce qui s’est historiquement pensé et institutionnalisé sous ce nom37.
Dans une telle articulation, des systèmes juridiques reconnus nationalement et internationalement, donc des Etats « sécularisés » et des agences « cosmopolitiques » ne peuvent pas ne pas jouer un rôle important : mais ils ne peuvent être les acteurs décisifs. Car les Etats et les systèmes juridiques sont, précisément, prisonniers du particularisme culturel, ils tendent à reproduire des hégémonies culturelles ou, tout au plus, à les délimiter, mais surtout (si « laïques » se proclament-ils) ils sont inséparables de constructions théologico-politiques, ou ils se présentent comme des « négations déterminées » ou des relèves de l’institution théologique de la souveraineté et de la loi. C’est pourquoi il ne faut pas trop s’étonner que l’idée de sécularisme – soit comme stricte séparation du religieux et du politique selon la même ligne de division que celle du privé et du public, soit comme protection égale des appartenances religieuses de la part d’un Etat et d’un droit qui resteraient rigoureusement « neutres » par rapport à elles – ne tarde pas à renouer avec le discours religieux, ou plutôt avec les formes de la sacralisation. Un Etat qui a le monopole de l’interprétation et de l’imposition de la loi est toujours en voie de dé-sécularisation en même temps qu’il généralise le champ de la sécularisation. C’est la leçon permanente du Léviathan hobbesien et de sa « théologie politique » propre : la substitution du « Dieu mortel » au « Dieu immortel » (à supposer d’ailleurs que, dans un contexte culturel chrétien, le « mortel » et « l’immortel » soient des attributs séparables du divin).
Si donc le problème de la régulation des conflits identitaires, des « haines communautaires » ou tout simplement des obstacles à la communication qui menacent de ruiner d’emblée les possibilités de développement d’un nouveau « planétarisme », contemporain de la mondialisation, peut bien exiger la collaboration et la concertation d’institutions telles que les Etats, les organisations internationales, les progrès du droit international humanitaire et environnemental, mais ne peut en dernière analyse procéder du droit lui-même, il nous reste à comprendre ce qui peut mobiliser et articuler des processus de communication culturelle et de sécularisation ou de neutralisation des antagonismes religieux. En d’autres lieux j’ai suggéré que la condition pour défendre et développer le multiculturalisme (partout menacé aujourd’hui par des combinaisons meurtrières de racisme postcolonial, de renouveau du nationalisme, et de réactions de défense suscitées par la mondialisation elle-même en tant qu’elle « profane » les identités culturelles) est une dissociation aussi radicale que possible entre les figures traditionnellement voisines (mais non identiques) de l’étranger et de l’ennemi38. C’est donc aussi une politique de « traduction entre les cultures » valorisant et favorisant les processus de métissage, d’appartenance multiple, qui forment la condition matérielle des processus de traduction entre univers culturels éloignés les uns des autres, même s’ils se payent pour les individus de la mélancolie attaché à l’expérience de l’exil, ou plus simplement des difficultés d’existence inhérentes à la vie en diaspora39. Je ne change pas d’avis sur ce point. Mais je suis bien obligé d’admettre, sur la base des formulations précédentes, que rien de tout cela n’est suffisant. La neutralisation des conflits religieux, leur conversion ou leur sublimation en idéaux susceptibles de relativiser les appartenances communautaires, ne peut fonctionner sur le mode du « multiculturalisme » puisqu’elle ne se fonde pas sur des processus de changement, de transition et de traduction, si exigeants soient-ils, mais qu’elle a affaire à ce que Weber appelait la « guerre des Dieux », c’est-à-dire à l’incompatibilité des « axiomatiques » et des « choix » qu’elles imposent quand ce qui est en jeu est l’insupportable indétermination des différences anthropologiques. Ce qui règne entre les axiomatiques religieuses, c’est ce que j’ai appelé plus haut le conflit des universalités, au moyen desquelles la différence est réduite ou représentée. Quand on peut « traduire » un univers religieux dans un autre, c’est justement qu’il n’est pas purement religieux. Le « religieux » comme tel marque toujours le point de l’intraduisible40.
C’est pourquoi j’ai tendance à penser que si le conflit en tant que religieux ne peut se résoudre par des moyens purement juridiques et étatiques (mais seulement se refouler, ou se déplacer institutionnellement dans la forme d’un conflit entre une « religion » qu’on assigne au privé ou à la particularité, et un « sécularisme » qui tend parfois à reconstituer une « religion civique »), s’il ne peut pas non plus se réduire à un système de différences culturelles, il faut le traiter comme un différend41. C’est-à-dire qu’il faut commencer par l’énoncer comme tel, non comme une juxtaposition de constructions arbitraires, mais comme un choix contraint entre des représentations et des prescriptions inconciliables de ce qui sépare l’humain de l’inhumain, les différentes modalités de l’humain, ou celles de son « être au monde ». S’il existe un élément ou un type de discours qui puisse ici jouer le rôle d’une médiation (ou d’un « médiateur »), il faut donc qu’il ne se présente pas tout à fait comme un autre « choix » de même nature, c’est-à-dire qu’il n’entre pas dans le système des religions, même en tant que « nouvelle religion », sauf peut-être comme une sorte d’hérésie généralisée. D’où l’idée, déjà apparue épisodiquement dans l’histoire des idées (par exemple chez Spinoza) selon laquelle ce qui rend obliquement possible la rencontre des différents discours religieux, ou leur permet de développer ensemble une « libre conversation » dans un espace public, c’est l’introduction ou l’intervention dans ce même espace d’un élément supplémentaire qui, comme tel, est a-religieux (mais non pas nécessairement anti-religieux) : sans cet élément paradoxal, qu’on pourrait dire atopique, il n’existerait pas de possibilité de franchir la distance entre les axiomatiques religieuses de la différence anthropologique, ou de faire converger leurs interprétations vers certaines règles éthiques ou sociales, parce qu’il n’y aurait pas d’espace discursif où ces différences sont présentées comme telles, de façon comparative, et donc « présentées les unes aux autres » d’une façon non-hégémonique, en dehors des cadres d’une domination aussi bien que d’une conciliation. C’est cet élément additionnel chargé à la fois de réunir les religions et de reconnaître l’irréductibilité de leur conflit, que je suis tenté d’appeler une fois de plus, comme Fredric Jameson, le « médiateur évanouissant » de la communication entre discours religieux incompatibles : il faut donc qu’il possède des caractéristiques hautement paradoxales, dont nous ne sommes pas certains qu’elles ne demeurent pas elles-mêmes irréductiblement contradictoires42.
Il faut qu’il ait toujours déjà existé, même non identifié ou repéré sous des noms d’emprunt, de sorte que sa méconnaissance est d’une certaine façon la règle. Bien que partageant avec tous ces discours certains objectifs pratiques, il n’est ni le discours de la morale universelle, ni celui de la connaissance scientifique, ni celui des droits de l’homme, ni celui de la tolérance, du cosmopolitisme ou du planétarisme. Il n’est pas non plus identifiable à l’athéisme, à l’agnosticisme, ou au scepticisme, bien que sans doute il comporte comme eux une dimension de négation (mais on voit bien que chacun de ces termes pense la négation exclusivement par rapport à une certaine forme ou attitude religieuse : par exemple « athéisme » n’a de sens que si toute religion s’organise autour de la représentation d’un ou plusieurs dieux – mais il y a des religions sans dieux ; et « scepticisme » n’a de sens que si l’essentiel de la religion est la croyance, ou le dogme – mais le religieux peut être principalement localisé dans le rituel). Pour des raisons historiques, en un certain lieu, on peut l’appeler « sécularisme », à la condition d’accompagner la reprise de ce terme d’une critique radicale des institutions et des concepts admis du sécularisme et de la sécularisation, toujours culturellement déterminés et mutuellement exclusifs.
Le « médiateur évanouissant » des différends politico-religieux n’agit que s’il résonne à l’intérieur des discours religieux, s’il révèle des fissures dans leur croyance, des impossibilités dans leurs prescriptions, ou des inconsistances dans leur axiomatique. Pourtant il faut qu’il les « exproprie » de leur singularité, dérange leur certitude d’être uniques détenteurs de la vérité et de la justice, sans pour autant les détourner de rechercher la vérité et la justice selon leurs voies propres. C’est ici que, peut-être, nous pourrions à nouveau employer la catégorie de l’hérésie, ou tenter de nous représenter le médiateur évanouissant comme cette improbable « hérésie commune » de tous les discours religieux, dont la relation resterait à déterminer avec les « mouvements hérétiques » qui ont affecté historiquement chaque religion. Spinoza, pour sa part, préférait le terme de sagesse (évidemment inspiré par une tradition antique de « sagesse du monde »), mais la conception qu’il se faisait de la sagesse était elle-même profondément hérétique, combinant la leçon de Lucrèce avec celle de l’Ecclésiaste…43.
Et cet élément est certainement un discours public, en tout cas la fonction qu’il remplit n’est pas « privée », ou elle élève toujours le privé au politique. Pourtant, nous l’avons vu, dans sa fonction même de « publication » du différend religieux, le médiateur évanouissant que nous identifions au sécularisme (auto)critique est nécessairement à l’opposé des institutions qui accomplissent une tâche de régulation des conduites dans une forme juridique contraignante. Plus généralement, il ne peut avoir un caractère normatif mais seulement « exhortatif », il n’exprime pas un impératif au sens kantien – d’autant moins que le normatif ou l’impératif dans notre culture portent les traces indélébiles de certaines constructions religieuses de l’humain, inscrites à la fois dans l’intériorité de l’âme et de la conscience, et dans l’extériorité de règles de prescription et de prohibition. Pourtant, il n’est pas non plus purement cognitif ou « théorique », quelle que soit l’importance de la connaissance et de l’intelligence des phénomènes naturels et sociaux pour toute pensée séculière. Il serait plutôt performatif, d’abord en ce sens qu’il « effectue » sa propre énonciation libre de la vérité (ce que les Grecs appelaient parrèsia)en face des discours du pouvoir qui se fondent sur la mythologie ou la théologie. Reconnaissons-le donc honnêtement, il est bien possible que ce médiateur évanouissant ne soit rien de plus qu’une fiction philosophique.
==================
NOTES
- Cet essai est l’adaptation française (augmentée de notes et références) de la Anis Makdisi Memorial Lecture, prononcée le 12 novembre 2009 à l’American University of Beirut. Je remercie pour leur invitation et leur accueil le Professeur Maher Jarrar , actuel directeur du Anis Makdisi Program in Literature, le Doyen Patrick McGreevy, le Provost Ahmad Dallal, et Madame Jean Said Makdisi.[↩]
- Après réflexion, je décide de rendre en français l’anglais « secularism » par « sécularisme » : le terme de « laïcité » doit être réservé à une variante historique, en particulier française. Cette articulation commandée par la problématique d’une confrontation entre « l’Occident » et son autre ne recoupe donc pas exactement la distinction sécularisation-laïcité devenue d’usage courant chez les sociologues, qui procède plutôt d’une comparaison intra-européenne entre les aires de tradition protestante (où les processus de « modernisation » du politique iraient de la société civile vers l’Etat) et celles de tradition catholique (où ils iraient de l’Etat vers la société) : cf. Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, Entre passion et raison, Seuil 2004 ; ainsi que l’article « Sécularisation/profanation » par Marc de Launay, in B. Cassin, dir., Vocabulaire européen des philosophies, Seuil-Le Robert, 2004, p. 1118 sq.[↩]
- S’il est permis – cum grano salis – de faire état d’un fil conducteur étymologique, on notera que dans la tradition gréco-latine appropriée par l’Eglise, le « siècle » (saeculum/aiôn) c’est le « monde » ou même le « temps du monde », cependant que le kosmos (traduit en latin par mundus, mais aussi par universum) est identifié à la « création » dont Dieu aurait confié la garde à l’homme. Saint Paul oppose la « sagesse du monde » profane (sophia tou kosmou) à la « sagesse/connaissance de Dieu » (sophia/gnôsis theou) (I Cor. 1, 6-24). L’allemand conserve mieux que le français la symétrie de la Weltweisheit (philosophie populaire) et du Weltbürgertum (citoyenneté du monde), explicitement thématisée par Kant dans la Critique de la Raison pure. Le mot d’ordre marxien d’une « sécularisation-réalisation de la philosophie » (Verweltlichung ou Verwirklichung) apparaît ainsi comme une façon de ramener la philosophie à ses origines profanes, inséparables de sa fonction cosmopolitique, en même temps qu’une autocritique de sa capture par le discours théologique. Dans un très intéressant article : « Secularization : Notes Toward a Genealogy » (in Religion : Beyond a Concept, Edited by Hent De Vries, Fordham University Press, New York 2008, p. 432- 437), Jan N. Bremmer esquisse une histoire des transferts de « siècle », « séculier » et « sécularisation » entre le latin, le français, l’allemand et l’anglais.[↩]
- Joan Wallach Scott : Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man, Harvard University Press 1996. (Traduction française: La Citoyenne paradoxale : Les Féministes françaises et les droits de l’Homme, Albin Michel 1998).[↩]
- Cf. E. Balibar: “Antinomies de la citoyenneté”, in La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, Paris, PUF, 2010.[↩]
- Dans le cadre de ce que Jean Baubérot appelle le « pacte laïque » – véritable compromis historique coextensif à l’histoire du républicanisme moderne – on sait que ce contrôle public du système éducatif fait place à un large secteur confessionnel subventionné dit « privé » (essentiellement catholique : d’où l’expression de « catholaïcité » employée par Edgar Morin). Il n’en va pas exactement de même dans un autre domaine où se posent des problèmes de sécularisme, celui de la médecine. Là, l’exception se définit beaucoup plus directement en termes de conditions de classe, sans que les inégalités atteignent toutefois les mêmes proportions qu’aux USA. Cependant les conflits d’autorité dont, une fois de plus, la disponibilité du corps des femmes constitue le point de fixation, commencent à s’y faire jour[↩]
- Je suis intervenu sur cette question en plusieurs occasions, en particulier : « Le symbole ou la vérité » (sur la 1ère affaire des foulards, article de Libération, 3 novembre 1989) ; « Dissonances dans la laïcité », in Mouvements (Editions La Découverte), n° 33-34 (mai 2004) (repris dans La proposition de l’égaliberté, cit.) ; Interview à la revue Tehelka: « Secularism has become another religion », New Delhi, 25 mars 2009. Sur l’ensemble de la controverse relative à la loi du 15 mars 2004, cf. La politisation du voile en France, en Europe et dans le monde, sous la direction de Françoise Lorcerie, L’Harmattan 2005. Une comparaison approfondie entre les configurations française et allemande du rapport entre le politique et le religieux : Matthias Koenig und Jean-Paul Willaime (Hg.), Religionskontroversen in Frankreich und Deutschland, Hamburg, Hamburger Edition, 2008.[↩]
- L’absence de conflits violents ou de résistances ouvertes à la contrainte politique, contrairement à ce que certains avaient pronostiqué, s’explique en particulier par la conjoncture internationale : les jeunes filles porteuses de « foulards », ou leur entourage, n’ont pas voulu se laisser instrumentaliser par les courants fondamentalistes qui, de l’extérieur, ont à l’époque bruyamment soutenu leur « cause » et appelé à des mesures de « rétorsion ». On se souvient de la prise de position de l’UOIF invoquant « l’état de nécessité ».[↩]
- “White men saving brown women from brown men”. La formule a été inventée par Gayatri Chakravorty Spivak pour exprimer l’esprit dans lequel l’administration coloniale et les “indianistes” occidentaux avaient reconstruit le rite (prétendument traditionnel) de l’auto-immolation des veuves hindoues sur le tombeau de leur mari (sati) pour en faire un symbole de la barbarie des mœurs indigènes que la colonisation se fixait pour mission de faire disparaître : voir son livre A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present, Harvard University Press, 1999, p. 232 sq. (Traduction partielle dans Les Subalternes peuvent-elles parler ?, éditions Amsterdam, 2009.[↩]
- Ce qui veut dire aussi, très souvent, par des “femmes blanches” : car les critiques contre la tolérance des voiles islamiques dans les établissements scolaires et l’exigence de leur interdiction sont souvent venues d’enseignantes républicaines, « féministes » ou non (je me souviens d’une déclaration de Catherine Kintzler à l’occasion d’un débat contemporain de la « première affaire des foulards » en 1989 : « si je vois une jeune fille portant le foulard dans ma classe, je sais qu’elle ferme ses oreilles à la philosophie »).[↩]
- Joan Wallach Scott: The Politics of the Veil, Princeton University Press, 2007. Il semble qu’en dépit des sollicitations de l’éditeur américain et de la réputation de l’auteure, aucune maison d’édition n’ait voulu « prendre le risque » d’en publier une traduction française ! Eviter tout débat est évidemment la meilleure façon d’avoir à porter sur soi-même un regard critique…[↩]
- Dans un passage crucial de son livre, intitulé « The Clash of Gender Systems », J. Scott oppose « l’Islam » et « le républicanisme français » comme une « psychologie de la reconnaissance » et une « psychologie du déni » de la différence des sexes. En se fondant en particulier sur une comparaison avec les controverses (incomparablement moins durables et moins violentes) soulevées par le port du « string » en classe par des adolescentes précocement séductrices, elle en conclut que « there is a persistent contradiction in French political theory between political equality and sexual difference . Politicians and republican theorists have dealt with this contradiction by covering it over, by insisting that equality is possible while elevating the differences between the sexes to a distinctive cultural character trait (…) As if to prove that women cannot be abstracted from their sex (men, of course, can be), there is great emphasis on the visibility and openness of seductive play between women and men, and especially on the public display (and sexual desirability for men) of women’s bodies. The demonstrable proof of women’s difference has to be out there for all to see, at once a confirmation of the need for different treatment of them and a denial of the problem that sex poses for republican political theory. We might say then that, paradoxically, the objectification of women’s sexuality serves to veil a constitutive contradiction of French republicanism (…) women are objectified in both systems, although in different ways. My point is that sex and sexuality are differently represented, differently managed in these two systems. Paradoxically, for Islam it is the veil that makes explicit – available for all to see – the rules of public gender interaction, which are in no way contradictory and which declare sexual exchanges out of bounds in public space. It is this explicit acknowledgment of the problem of sexuality that, for French observers, makes the veil ostentatious or conspicuous in the sexual sense of those words. Not only is too much being said about sex, but all of its difficulties are being revealed. Women may be formally equal, but the difference of their sex somehow belies that equality. The pious pronouncements of French politicians about the equality of men and women are at odds with their deep uneasiness about actually sharing power with the opposite sex. These are difficulties that theorists and apologists for French republicanism want to deny” (pp. 166-173).
On peut accorder sans difficulté à Scott que le régime public-privé de régulation de la différence des sexes qui oscille entre exhibition et neutralisation traduit “un profond malaise”. Mais on demeure stupéfait de voir caractériser le régime (attribué à l’Islam) de refoulement de la sexualité dans l’espace privé où l’homme est le « gardien » de la vertu de sa femme, et d’exclusion des femmes non « couvertes » de la vie publique, comme une « reconnaissance de la différence » : « Islamic jurists deal with sexual difference in a way that avoids the contradiction of French republicanism by acknowledging directly that sex and sexuality pose problems (for society, for politics) that must be addressed and managed (…) Modest dress, represented by the headscarf or veil for women and loose clothing for men, is a way of recognizing the potentially volatile and disruptive effects of sexual relations between women and men, driven by impulses (…) Modest dress declares that sexual relations are off-limits in public spaces. Some Muslim feminists say this actually liberates them, but whether it does or not, or whether, indeed, every woman who wears a headscarf understands its symbolism in this way, the veil signals the acceptance of sexuality and even its celebration, but only under proper circumstances – that is, in private, within the family. This is a psychology not of denial but of recognition” (ibid.).
A bien des égards la thèse de J. Scott est un renversement de celle qui était exposée dans le livre de Fatima Mernissi : Beyond The Veil. Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (1975 ; revised ed. Indiana University Press 1987 ; adaptation par l’auteure : Sexe, Idéologie, Islam, Le Fennec 1985), qui oppose les représentations de la sexualité féminine dans l’Islam et en Occident comme « active » et « passive », et rattache le port du voile à une structure de territorialisation du masculin et du féminin dont il faut contrôler les débordements en leur assignant des espaces séparés. Sur les circonstances dans lesquelles « le voile » est fétichisé à la fois par le colonialisme comme symbole de l’oppression des femmes indigènes et par les mouvements anti-colonialistes (religieux ou non) dans le monde arabe comme symbole de résistance à l’Occident, cf. Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, Yale University Press, 1992, en particulier pp. 144-168. A noter que dans l’arabe du Coran, hidjab désigne à la fois le voile et la réclusion (d’abord imposée aux femmes du Prophète).[↩]
- J’emprunte la notion d’universalismes en conflit à Judith Butler, qui bien entendu s’inspire ici de Hegel (Voir sa contribution au débat avec Laclau et Zizek publié sous le titre Hegemony, Contingency, Universality. Contemporary Dialogues on the Left, Verso, 2000). [↩]
- Etienne Tassin a parfaitement mis en évidence l’importance de cette distinction dans son livre : Un monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits, Paris, Seuil, 2003. Voir également Bruce Robbins et Pheng Cheah (eds.): Cosmopolitics – Thinking and Feeling Beyond the Nation, University of Minnesota Press, 1998.[↩]
- Charles Taylor : Multiculturalisme, différence et démocratie, Champs Flammarion 1999 ; Will Kymlicka : La Citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités, trad. fr. P. Savidan, La Découverte, 2001 ; Homi K. Bhabha : Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale (1994), tr. fr. F. Bouillot, Payot, Paris 2007 ; Stuart Hall, Identités et cultures (anthologie), Editions Amsterdam, Paris 2008. Pour un tableau comparatif : David Theo Goldberg: Multiculturalism. A Critical Reader, Blackwell 1994 ; Francesco Fistetti : Théories du multiculturalisme. Un parcours entre philosophie et sciences sociales, postface de Alain Caillé et Philippe Chanial, La Découverte, 2009. Un multiculturalisme de type « communautaire » ne pose aucun problème théorique insoluble à une institution séculière qui s’identifie elle-même à l’universalité, puisqu’il affirme les droits irréductibles de son « contraire », le particulier. Il n’en va pas de même, évidemment, pour un multiculturalisme fondé sur l’hypothèse du « métissage généralisé », parce qu’il se réfère à une autre idée de l’universel : E. Balibar, « Dire l’Universel », sur le site de Transeuropéennes : http://www.transeuropeennes.eu/fr/articles/101/Dire_l_universel.[↩]
- Danièle Hervieu-Léger date des années 70 la diffusion de l’expression “retour du religieux” (La Religion pour mémoire, Editions du Cerf, 1993). Régis Debray (Dieu, un itinéraire, Editions Odile Jacob, 2001) en fait le contrecoup communautaire ou la résistance de “l’esprit de corps » aux progrès de la mondialisation utilitariste et uniformisatrice. La terminologie du « retour du sacré » est utilisée en particulier par le philosophe indien Ashis Nandy (voir “The Return of the Sacred. The Language of Religion and the Fear of Democracy in a Post-Secular World”, Mahesh Chandra Regmi Lecture 2007) (http://www.soscbaha.org/downloads/Return-of-the-Sacred.pdf).[↩]
- Perspective qui, on le sait, se cache derrière la notion du « Clash of Civilizations » imposée par Huntington : voir la critique de Marc Crépon : La guerre des civilisations : La culture de la peur, Tome 2, Editions Galilée, 2010.[↩]
- « L’histoire du mot « religion » devrait en principe interdire à tout non-chrétien de nommer « religion », pour s’y reconnaître, ce que « nous » désignerions, identifierions et isolerions ainsi » (J. Derrida, Foi et savoir, suivi de Le siècle et le pardon, Editions du Seuil 2000, p. 56). C’est pourtant l’inverse qui a lieu, ce que Derrida nomme « mondialatinisation » de la religio. Sur la non-équivalence entre « religion » et dîn, cf. Dictionnaire du Coran, sous la direction de Mohammed Ali Amir-Moezzi, Robert Laffont, collection « Bouquins », Paris 2007, article « Religion » (par M.A.A.M.), p. 741 sq.[↩]
- Jacques Derrida : « Surtout pas de journalistes ! », L’Herne. Derrida, (Cahier dirigé par M-L Mallet et G. Michaud), Paris, éditions de l’Herne, 2004, p. 36.[↩]
- « Plus que religion, communion est polysémique. Il ne dissocie pas l’obédience – (« les communions anglicane, orthodoxe, hindoue, etc. ») de l’empathie (« je me sens en communion d’idées et de sentiments avec vous »). C’est à la fois une « dénomination » socialement reconnue, et une expérience viscéralement ressentie. De la relation traduite en émotion. Mais surtout, le mot conjoint l’horizontale – « être membre de » – à la verticale – « adhérer à ». Et telle est l’équation de tout regroupement ayant vocation à la durée », Les communions humaines. Pour en finir avec « la religion », Editions Fayard, 2005, p. 60. Entre Derrida et Debray il y a eu une série d’échanges évoqués par Hent de Vries dans la préface de son anthologie : Religion, Beyond a Concept, cit., pp. 92-94 (contenant également en traduction anglaise le Rapport sur l’Enseignement du fait religieux dans l’école laïque, rédigé en 2002 par Debray à la demande de Jack Lang, Ministre de l’Education Nationale). Ils portèrent notamment sur la distinction du « culte » et de la « culture », d’où découlait la distinction d’un « enseignement religieux » et d’un « enseignement de la religion ».[↩]
- Talal Asad : Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, The Johns Hopkins University Press 1993; Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, 2003. Le même auteur a proposé une critique radicale de la laïcité à la française : “Trying to Understand French Secularism”, in Hent de Vries, Lawrence Eugene Sullivan (eds.), Political theologies: public religions in a post-secular world, Fordham University Press, 2006, pp. 494-526, dont il faut souhaiter la traduction.[↩]
- Cf. Formations of the Secular, cit., p. 191 sq.[↩]
- Outre L’orientalisme (1978), voir E. W. Said : Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World (1e éd. 1981), Vintage Books 1997.[↩]
- On pense au désormais fameux « Discours de Ratisbonne » de Benoït XVI (Joseph Ratzinger) le 12 septembre 2006 (http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2280670&rubId=1306). Voir Philippe Buttgen, Alain de Libera, Marwan Rashed et al. : Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante, Fayard, Paris 2009. Le plus brillant manifeste de cette position ecclésiale en français est le livre de Rémi Brague : Europe, la voie romaine, Criterion, Paris, 1992.[↩]
- C’est peut-être plus net chez des disciples d’Asad comme Saba Mahmood, qui met en œuvre un constructivisme radical pour dénoncer la vision occidentale des relations entre sexualité et religion dans le monde musulman et son usage dans le cadre des guerres américaines actuelles : « Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation”, in Public Culture 18:2, 2006. Mais même chez Talal Asad, auteur averti s’il en est des chausse-trapes que recèle le terme de “culture”, il faut nommer la scène sur laquelle les transformations se déroulent historiquement, et cette catégorie fournie par la discipline anthropologique demeure apparemment la seule disponible.[↩]
- Sur la construction du concept d’idéologie et les alternatives qu’il comporte voir Nestor Capdevila : Le concept d’idéologie, Paris, PUF, 2004 (ainsi que son ouvrage antérieur : Las Casas : une politique de l’humanité. L’homme et l’empire de la foi, Paris, Ed. du Cerf, 1998). J’inverse la tendance à décrire les processus d’ « idéologisation » comme des effets de dégradation du religieux (en particulier dans le cadre d’une instrumentalisation politique) (Dariush Shayegan : Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ?, Les Presses d’aujourd’hui, Paris 1982) et je tente d’ouvrir un programme dialectique analogue à celui que des auteurs d’inspiration marxiste ont conduit, à la suite de Mannheim, avec le couple idéologie/utopie : cf. Michael Löwy : Rédemption et Utopie. Le Judaïsme libertaire en Europe centrale. Une étude d’affinité élective, Paris, Presses universitaires de France, 1988.[↩]
- Deux traductions coexistent en français pour la catégorie de Veralltäglichung : « quotidianisation » est plus conforme à la lettre et insiste sur la dialectique de l’exceptionnel et de l’habituel, mais « routinisation » (du charisme) met mieux en évidence le changement dans la modalité normative, lié à la comparaison des trois types de « légitimation de la domination » : cf. mon exposé au Groupe de travail de Pierre Macherey : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/balibarcharismecadreprincipal.html et les commentaires de Frédéric Keck : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/kecknotebalibar.html). [↩]
- « Corps des dieux », Le temps de la réflexion, VII, 1986, sous la direction de Charles Malamoud et Jean-Pierre Vernant, Gallimard 1986. La différence est « floue », bien sûr, comme pourrait le montrer une discussion sur le rapport entre sacrifice, interdits alimentaires et pratiques du jeûne dans différentes sociétés qui ne les articulent pas de la même façon. Cf. Mohammed Hocine Benkheira : Islâm et interdits alimentaires. Juguler l’animalité, PUF 2000. Benkheira centre son analyse de « l’Islâm comme système religieux » sur une politique islamique des corps, dont l’aspect essentiel, juridiquement codifié par le fikh (« Les musulmans habitent le monde en juristes »), n’est pas la croyance mais le rituel individuel et collectif, la mise en pratique de la distinction entre le licite et l’illicite. En relèvent les interdits alimentaires, et plus généralement les « interdits de contact » (p. 198), qui enjoignent au sujet de refouler en lui-même l’animalité par un dressage du corps qui s’apparente à une « servitude volontaire » (p. 201).[↩]
- Clifford Geertz: “Religion as a Cultural System”, in The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 87-125. Voir le commentaire d’Asad: Genealogies of Religion, cit., pp. 27-54: “The construction of religion as an anthropological category”.[↩]
- Max Weber : “Zwischenbetrachtung: Stufen und Richtungen der religiösen Weltablehung” [1915] (traduction française : “Considération intermédiaire: théorie des degrés et des orientations du refus religieux du monde”, in Max Weber, Sociologie des religions, Textes réunis et traduits par Jean-Pierre Grossein, Introduction de Jean-Claude Passeron, Paris, Gallimard 1996, 410-460). Le comparatisme de Weber, structuré par des oppositions très abstraites comme celle de « l’ascèse » et de la « mystique », ou du « salut » (Heil)et de la « délivrance » (Erlösung), mais susceptibles d’être diversifiées à l’infini, ne coïncide presque jamais avec des dénominations de « confessions » établies par l’histoire/science des religions, et moins encore avec des repérages d’ensembles ethno-culturels ou des « civilisations ». Il vise au contraire à en interpréter les scissions (« hérésies ») et les tendances d’évolution.[↩]
- Voir mon étude : « L’introuvable humanité du sujet moderne. L’universalité civique-bourgeoise et la question des différences anthropologiques », à paraître dans L’Homme. Revue française d’anthropologie, Editions de l’EHESS, année 2011. Je n’aurais évidemment pas pu entreprendre ce renversement de perspectives sans la critique à laquelle Derrida a soumis la thématique de la « différence ontologique » chez Heidegger : « Geschlecht : différence sexuelle, différence ontologique », in Psyché. Inventions de l’autre, pp. 395-414, Galilée, Paris 1987).[↩]
- Voir une argumentation analogue dans Bertrand Ogilvie : Anthropologie du propre à rien (article paru dans Le passant ordinaire, n°38, janvier-mars 2002) (reproduit sur le site du CIEPFC : http://ciepfc.fr/spip.php?article144). [↩]
- Cf. Michael Löwy : La Guerre Des Dieux – Religion Et Politique En Amérique Latine, Editions du Félin, Paris 1998.[↩]
- Cf. Margot Badran : « Islamic feminism: what’s in a name? », Al-Ahram, January 17–23, 2002; « Exploring Islamic Feminism » (Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, November 30, 2000). Il se peut que les féministes islamiques, rééditant à leur façon le geste d’autres « réformateurs », pensent isoler un élément de révélation « purement religieux » de ce qui ressortirait de la culture ou des mœurs traditionnelles dominées par le patriarcat, mais il est plus probable qu’elles doivent toucher à l’interprétation de la révélation elle-même, inséparable de son « histoire » fondatrice. Voir le commentaire de Reza Aslan à propos du livre d’Amina Wadud (Qur’an and Woman : Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, Oxford University Press, 1999), dans No god but God. The Origins, Evolution, and Future of Islam, Random House, New York, 2005, p. 73 sq. Sur la généralisation de la distinction masculin-féminin dans les sourates « médinoises » du Coran, Dictionnaire du Coran, cit., article « Femme » (par Denis Gril), p. 338 sq.[↩]
- Donna Haraway: Simians, Cyborgs and Women : The Reinvention of Nature. New York : Routledge, 1991; Religion et écologie, sous la direction de Danièle Hervieu-Léger, Editions du Cerf 1993 ; Isabelle Stengers : Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Les Empêcheurs de penser en rond, 2009.[↩]
- Gayatri Chakravorty Spivak: Death of a Discipline, The Wellek Library Lectures in Critical Theory, Columbia University Press, New York 2003. Paul Gilroy, Postcolonial Melancholia (New York: Columbia University Press, 2005).[↩]
- Je reprends la formulation de Bruce Robbins dans “Said and Secularism” (Edward Said and Jacques Derrida: Reconstellating Humanism and the Global Hybrid, edited by Mina Karavanta and Nina Morgan, Cambridge Scholars Publishing, 2008, 140-157).[↩]
- « Strangers as Enemies: Further Reflections on the Aporias of Trans-national Citizenship », Globalization Working Papers 06/04, Institute on Globalization and the Human Condition, McMaster University (http://www.globalautonomy.ca/global1/article.jsp?index=RA_Balibar_Strangers.xml).[↩]
- Revue Transeuropéennes, n° 22, 2002, dossier « Traduire, entre les cultures », sous la direction de Ghislaine Glasson-Deschaumes et Rada Ivekovic.[↩]
- Idée voisine chez Jan Assmann: “Translating Gods. Religion as a factor of Cultural (Un)Translatability”, in Hent de Vries, Religion, Beyond a Concept, cit., pp. 139-149, qui oppose de ce point de vue les « monothéismes » aux « polythéismes » et les met en rapport avec deux types d’empires. On peut considérer cette distinction elle-même comme un idéal-type.[↩]
- Je prends “différend” dans le sens de Jean-François Lyotard (Le Différend, Paris, Editions de Minuit, 1983) : juxtaposition de phrases aux régimes hétérogènes, mettant en échec la continuité et la réciprocité du dialogue.[↩]
- Fredric Jameson: “The Vanishing Mediator, or Max Weber as Storyteller [1973]”, in The Ideologies of Theory, Essays 1971-1986, Volume 2, Syntax of History, Routledge 1988, 3-34.[↩]
- Warren Montag : “Lucretius Hebraizant: La lectura de Spinoza del Eclesiastés”, in Galcerán et Espinoza (Eds.), Spinoza contemporaneo, Madrid: Tierradenadie ediciones, 2009.[↩]

Etienne Balibar
Etienne Balibar est professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, professeur affilié au département d'anthropologie à l'université de Californie à Irvine, aux États-Unis, visiting professor à l'Institut de littérature et société comparée de l'université Columbia et professeur « Anniversary Chair » au Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) à l'université Kingston de Londres. Ses recherches portent entre autres sur la philosophie politique continentale, l'épistémologie, la philosophie moderne et les études européennes.
