Soi-même par les livres

A propos de : Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2011.
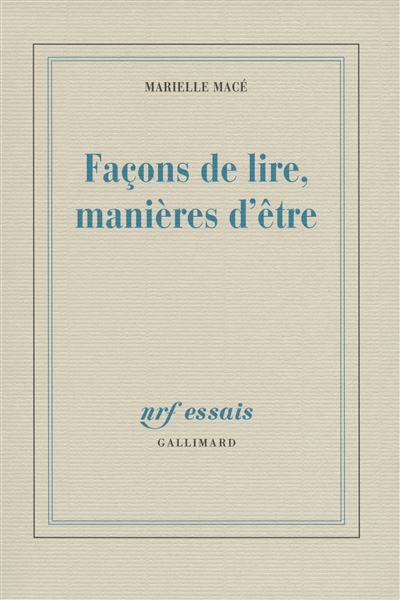
« Il n’y a pas d’un côté la littérature et de l’autre la vie, dans un face-à-face brutal et sans échanges qui rendrait incompréhensible la croyance aux livres […]. Il y a plutôt, à l’intérieur de la vie elle-même, des formes, des élans, des images et des manières d’être qui circulent entre les sujets et les œuvres, qui les exposent, les animent, les affectent. La lecture n’est pas une activité séparée, qui serait uniquement en concurrence avec la vie ; c’est l’une de ces conduites par lesquelles, quotidiennement, nous donnons une forme, une saveur et même un style à notre existence » (p. 9-10) : ces quelques lignes quasi inaugurales exposent avec force les idées directrices de Façons de lire, manières d’être, le très beau livre de Marielle Macé consacré à la lecture littéraire. La première de ces idées est que, pour tout lecteur, la lecture est une activité de sa vie ordinaire, qu’elle a lieu dans le cours de cette vie, et que ses effets en sont des événements. La seconde de ces idées est que la lecture a pour effet, tout particulièrement, de nous faire découvrir, de nous faire éprouver, de mettre à notre disposition des manières de nous rapporter au monde, de nous tenir dans notre existence, par lesquelles nous nous définissons en tant qu’individus.
Cette approche de la lecture se distingue des démarches de nature sémiotique, lesquelles, selon Marielle Macé, envisage la lecture avant tout comme une activité de déchiffrement du texte. À la suite des réflexions du critique américain Stanley Fish sur la possibilité d’une « stylistique affective1 », Marielle Macé propose de « redéfinir le « sens » d’un texte non comme ce qui est visé, mais comme l’ensemble des événements mentaux causés par un énoncé, puis par un autre, et dont le déroulement dans un flux temporel concret et individuel (fait de vitesses, de ralentissements, de plateaux, d’intensités différentielles) constitue la signification elle-même » (p. 59) – ajoutons : la signification pour tel lecteur, non pour tel autre. L’approche sémiotique de la lecture manque sa dimension individuelle ; elle ne peut rendre compte du fait que le lecteur, en tant qu’individu, est engagé par sa lecture, fait capital dans la perspective de Marielle Macé. Par contre, celle-ci manifeste à plusieurs reprises son intérêt et sa sympathie pour des auteurs dont les travaux renouvellent la réflexion sur les aspects affectifs, cognitifs, moraux et politiques de l’expérience littéraire : Jean-Marie Schaeffer, Jacques Bouveresse, Thomas Pavel, Stanley Cavell, Martha Nussbaum, Jacques Rancière – tout en indiquant ce qu’elle tient pour les limites de leurs démarches. Elle écrit ainsi : « Dans la réflexion sur la littérature, la multiplicité, et à vrai dire la concurrence de ces modes d’articulation entre les œuvres et les formes de vie est trop souvent négligée ; ce maniérisme subtil des pratiques est écrasé (même par ceux qui croient puissamment aux livres) lorsqu’il est recouvert par un éloge global des fictions, ou une croyance au caractère mécaniquement émancipateur de toute expérience esthétique, indépendamment des individus qui la traversent » (p. 23). Encore une fois, c’est l’occultation du caractère individuel de la lecture, et par conséquent de l’extrême diversité des manières par lesquelles les livres affectent les lecteurs, que souligne Marielle Macé.
Les inspirateurs et les guides de la réflexion de Marielle Macé sont, avant tout, les « grands » lecteurs dont elle analyse et médite les témoignages qu’ils ont laissés de leurs expériences de lecture, de leur(s) façon(s) de lire : Proust, Sartre, Barthes, Gracq, Paulhan, et quelques autres. Elle aborde ces témoignages comme autant d’exemples de ce qu’est, pour elle, la lecture littéraire : « Stylisant une expérience du style, manifestant la façon dont des œuvres ont infusé dans une vie concrète, les textes très divers que je rassemblerai non seulement décrivent des moments esthétiques, mais surtout relancent une pratique d’individuation dans des rencontres effectives avec les formes » (p. 25). Selon Marielle Macé, le témoignage de l’expérience de lecture n’est pas seulement la description de cette expérience, il est affecté, informé par l’œuvre lue, il est le produit des échanges entre l’œuvre lue et son lecteur.
L’analyse des témoignages des « grands » lecteurs constitue la matière des trois grandes parties dont se compose l’essai de Marielle Macé : « Infléchir ses perceptions », « Trouver son rythme », « Se donner des modèles ».
Les expériences de lecture de Marcel, le narrateur d’À la recherche du temps perdu, sont au centre d’« Infléchir ses perceptions ». Deux thèmes y prédominent : les rapports du lecteur à l’environnement de sa lecture ; l’effet des œuvres sur les modalités de son attention au monde. Le développement du premier de ces deux thèmes est l’occasion, pour Marielle Macé, de montrer comment l’acte même de lire s’insère dans la vie. « Se retrancher » (p. 29) dans la lecture n’est pas, purement et simplement, se retirer du monde ; à partir du livre, au centre de son attention, le lecteur réoriente sa perception, réorganise sa situation dans le monde environnant, à l’image de l’entrée dans la lecture telle que la décrit Proust dans la Recherche. L’acte même de lire engage ainsi des « manières d’être ». Allant plus loin, Marielle Macé note que l’expérience de la lecture peut être vécue comme l’expérience d’une manière singulière d’être dans le monde, opposant l’enfant Sartre qui « vivait ses lectures dans la terreur d’un enferment » à Kafka qui « rapportait dans son Journal le souvenir d’une joie recluse, modulée dans des situations de lecture apaisantes jusqu’au néant » (p. 35-36). Après le retranchement dans la lecture, c’est le geste de « lever les yeux de son livre » (p. 39), ou de « lire en levant la tête » (p. 40), selon les mots de Roland Barthes, qui retient l’attention de Marielle Macé. On lève les yeux de son livre pour s’abandonner aux images, aux idées, aux souvenirs que le livre a suscités en soi ; on lève les yeux de son livre parce que, comme pour le narrateur proustien, un événement s’impose à l’attention et vient suspendre le cours de la lecture. Dans le premier cas, « on ne regarde pas juste en l’air quand on lève la tête : on regarde sa lecture, on s’invente avec elle, on voit le dehors selon sa nouveauté, on est déjà en train de faire quelque chose de ce qu’on lit et de donner (ou d’échouer à donner) un certain tour à sa propre existence » (p. 40) ; dans le second, c’est, selon Marielle Macé, de la relation du sujet à son environnement qu’il est question. De ces allers-retours du lecteur entre son livre et lui-même, entre son livre et le monde, elle retient une dernière figure, exemplaire : la lecture en train, dont on peut conclure que « si le repli lecteur est bien un refuge (parfois une geôle), ce n’est décidément pas un oubli du dehors : la lecture n’engage pas l’annulation mais la redisposition des données de la perception : elle façonne une autre modalité de l’attention, un certain régime de lucidité, un certain rythme de vigilance » (p. 64). Mais la modalisation de l’attention, l’infléchissement de la perception ne sont pas que le produit de l’acte de lire, de la situation de lecture ; les œuvres elles-mêmes y contribuent puissamment : c’est le second thème d’« Infléchir ses perceptions ». En s’appuyant sur les pages d’À la recherche du temps perdu où le narrateur décrit comment sa perception du monde est orientée par ses lectures, ainsi que celles qu’il consacre à l’expérience de « suivre un nouvel auteur dans sa phrase » (p. 84), Marielle Macé montre comment l’expérience de lecture elle-même forme et renouvelle les capacités perceptives, et comment les œuvres mettent à disposition des lecteurs des façons de percevoir le monde dont ceux-ci pourront faire usage pour, à leur tour, façonner leur propre regard sur les choses. Cet emploi des lectures exemplifie le processus de l’individuation, où des médiations sont nécessaires pour devenir soi.
Si Proust, ou plus exactement Marcel, était la figure dominante d’« Infléchir ses perceptions », c’est à partir des expériences de lecture de Sartre que se développe « Trouver son rythme ». Il y est question du temps, ou plus exactement des possibilités qu’offrent aux lecteurs les œuvres et les formes littéraires de faire l’expérience de différentes formes de « temporalisation » – c’est le terme qu’emploie Marielle Macé – de l’existence. Ce qui, des expériences de lecture de Sartre, retient avant tout son attention, c’est la prédilection de Sartre pour le récit : le récit, qu’il s’agisse de la biographie ou du roman, pourvoit Sartre en « émotions temporelles » (p. 118), à travers lesquelles il reconnaît les formes de temporalisation qu’il désire pour sa propre vie. Ces formes oscillent, tout au long de la vie de Sartre, entre « désir de destinée et désir de liberté, désir de forme et hantise de la fin » (p. 135). Si le « désir de destinée » habite le Sartre des Carnets de la drôle de guerre, celui de l’engagement a des attentes bien différentes à l’égard du récit : « ce n’est plus l’espoir d’une synthèse rétrospective (à la Ricœur), mais l’emportement narratif qui devient l’émotion modélisatrice, le patron dynamique d’une entre-stylisation du sujet et des romans » (p. 130). La référence à Ricœur n’est pas qu’anecdotique. Si Marielle Macé rapproche le Sartre des Carnets de la drôle de guerre du Ricœur de Temps et récit, l’un et l’autre pensant le récit sous la catégorie de la « synthèse rétrospective », les transformations des attentes sartriennes à l’égard du récit lui permettent d’indiquer certaines limites de l’approche de Ricœur : « Mais le goût ricœurien de la synthèse et du destin contraint fortement les enjeux moraux de la refiguration. Il y a pourtant d’autres attentes et d’autres usages du roman, qui m’encouragent à envisager d’autres modèles de refiguration temporelle et donc de subjectivation littéraire. L’attente destinale n’a par exemple pas résisté à la découverte par Sartre de sa propre « historicité », et l’a conduit à demander autre chose aux romans, par conséquent à vivre autrement les rapports entre la lecture et la temporalisation de soi » (p. 129). Allant plus loin, Marielle Macé remet en cause le lien privilégié établi, sous l’influence de Ricœur, entre le récit et la constitution de l’individualité : « Il faut élargir à un chiasme général des sujets et des œuvres cette articulation entre formes littéraires et formes de vie que Ricœur a réservée au genre narratif » (p. 155). L’exemple de la poésie lui permet d’introduire la notion de rythme comme autre mode de la temporalisation de l’individu : « dans un aller-retour permanent de discordances et de rééquilibrages rythmiques, la poésie éprouve notre tempo intérieur, elle nous fait hésiter dans notre propre langue puis nous réassurer et, au cours de cette expérience, elle nous fait nous éprouver – et nous décider – comme êtres temporels » (p. 159). L’usage de cette notion témoigne de la conviction de Marielle Macé que la conception ricœurienne de l’identité personnelle comme « synthèse rétrospective », dont le récit serait le modèle et l’instrument, ne rend pas justice à la pluralité des modes de temporalisation de l’individu – comme le montrent les différents usages sartriens du récit –, non plus qu’aux ressources offertes, pour cela, par l’ensemble des formes littéraires.
Dans les premières pages de « Se donner des modèles », la dernière partie de son essai, Marielle Macé écrit « La capacité d’action d’un sujet réside aussi dans la manière dont il se transforme en s’identifiant à une image, mieux, en « assumant » une image extérieure et en lui demandant témoignage de lui-même » (p. 185). Cette image qui deviendra le patron d’une manière d’être et d’agir, on peut la découvrir dans les œuvres littéraires, comme Barthes, la référence principale de « Se donner des modèles » – ou comme Emma Bovary, dont Marielle Macé pour ainsi dire rétablit la réputation. Qu’est-ce d’autre, en effet, que le bovarysme, auquel le personnage de Flaubert a donné son nom, sinon vouloir vivre selon des modèles littéraires ? À la suite de Barthes déclarant « Nous sommes tous des Bovary », Marielle Macé écrit : « c’est justement parce que le désir s’apprend, parce que les formes auxquelles nous sommes confrontés sont les premières ressources et les premiers modèles de notre auto-façonnement, que nous faisons tous comme Emma, voulant être conduits par des phrases » (p. 190-191). Sa revalorisation du bovarysme l’amène à récuser la distinction entre lecture d’identification et lecture distanciée, intellectualisée : « Faire taire le bovarysme, ce ne serait pas rendre la lecture à la pureté supposée d’une expérience sérieuse, c’est-à-dire indemne d’individualité (comme s’il existait de telles expériences, comme si l’individualité n’était justement pas le milieu, voire l’opération de toute expérience), ce serait éteindre le foyer actif de la subjectivation lectrice » (p. 189-190). « Se donner des exemples » explore en détail les opérations de cette « subjectivation lectrice ». Un thème particulièrement marquant des subtiles analyses de Marielle Macé est celui de ce qu’elle nomme « L’avance des phrases » (p. 211), dont la citation est un témoignage : « L’écrivain me dit donc en me précédant, il marche devant moi, et j’éprouve dans ma lecture le « plaisir d’avoir été deviné ». Barthes appelait cela la « vocation citationnelle » des formes. Les phrases sont en effet moins des objets que des directions et des appels, les promesses d’une pratique à venir ; elles sont à citer » (p. 216). Le même Barthes voyait un phénomène analogue dans l’exercice scolaire de la dictée, considérant que les textes qu’on nous avait dictés modelaient durablement nos propres manières d’écrire, le modèle imposé devenant, à l’image du bovarysme, la matrice de l’expression personnelle.
Façons de lire, manière d’être est donc une exploration, audacieuse et riche, de la face individuelle de la lecture littéraire. C’est un bel éloge de la littérature comme médiation, des ressources qu’offrent les œuvres et les formes pour façonner son individualité. C’est une méditation sur le processus même de l’individuation, sur la combinaison de passivité et d’activité, d’emprunt et d’appropriation qu’il suppose. C’est, enfin, une sorte d’acte de foi en littérature, en laquelle même un Pierre Bourdieu, par la grâce d’un poème d’Apollinaire ou de Ponge, pouvait trouver le moyen de « se réapproprier, comme une disposition émotionnelle positive, l’amor fati que sa sociologie le conduisait à haïr » (p. 172). De toutes les expériences de lecture recueillies et analysées par Marielle Macé, c’est sans doute la plus inattendue – et la plus éloquente.
==================
NOTES
- Pour en savoir plus, voir : Stanley Fish, « L’épreuve de la littérature. Une stylistique affective », trad. fr. Philippe Jousset, Poétique, n° 155, septembre 2008, p. 345-378.[↩]

Jean-Baptiste Mathieu
Jean-Baptiste Mathieu est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm). Professeur agrégé de lettres modernes, il enseigne actuellement au Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Il est rédacteur en chef de la rubrique « Critiques » au sein de la rédaction de la revue Raison publique.
