Les légitimités de l’Union européenne

A propos de :
- Jean-Louis Quermonne, L’Europe en quête de légitimité, Paris : Presses de la fondation Nationale des Sciences politique, coll. « La Bibliothèque du citoyen », 2001, 127 p.
- Jean-Paul Fitoussi, La règle et le choix. De la souveraineté économique en Europe, Paris : Seuil, coll. « La République des idées », 2002.
Dans cet article de 2003, Patrick Savidan revient sur deux ouvrages de Jean-Louis Quermonne et de Jean-Paul Fitoussi qui posent la question de l’Europe politique.
La littérature consacrée à l’Union Européenne, comme réalité et comme projet politique, a beau parvenir le plus souvent à éclairer utilement certains pans de l’édifice, il est rare qu’elle réussisse à véritablement construire ce dernier pour ce qu’il est au plus haut point, à savoir : un enjeu politique fondamental pour 375 millions de personnes aujourd’hui, et, demain peut-être, à la faveur de l’élargissement de l’Union, pour 550 millions d’Européens.
La vivacité du propos est le plus souvent l’apanage de ceux qui s’opposent à l’idée d’une intégration politique de l’Europe. On peut le comprendre. Dans le sentiment de dépossession politique dont se font très souvent l’écho certains déçus de l’Europe ou autres Eurosceptiques plus ou moins déclarés, s’exprime au moins implicitement l’opposition entre ce qui est perçu comme le cadre par excellence de la citoyenneté, soit l’État-nation, et un ensemble d’Institutions européennes en lequel on ne voit, au mieux, qu’une réalité techno-bureaucratique, indûment autonome à l’égard des pouvoirs politiques. Toutes les réponses techniques du monde ne pourront jamais apaiser un tel sentiment. Ce qu’il faudrait, c’est que l’Europe devienne elle-même, véritablement, l’objet d’un débat politique à la faveur duquel nous cessions de la vivre comme quelque chose d’étranger. En tant qu’individus résidant dans telle ville, participant à l’économie et à la vie politique de telle région, au sein de telle nation, il faut que nous percevions qu’il n’y a pas de raisons décisives de ne pas ajouter, aux multiples facettes de nos existences citoyennes, celle de l’Union, qui vient en fait la parachever et accroître sa consistance dans le monde globalisé qui est aujourd’hui le nôtre.
Font donc encore cruellement défaut à ce titre un nombre suffisant d’ouvrages qui parviennent à parler politiquement, et sans concession,de l’Union européenne, à montrer à quel point, bien loin d’être l’artisan d’une mise en pièce de la souveraineté, le projet européen se révèle être l’occasion d’une forte réaffirmation de celle-ci. Il s’agira d’une souveraineté transformée, soit, mais d’une souveraineté qui se révèlera sans commune mesure avec ce que peut effectivement le citoyen, pensé à l’échelle de la seule nation, de la région, de la communauté d’agglomérations ou de la ville dont il relève.
L’argument, pour avoir été vigoureusement défendu, est désormais bien défini : quand bien même, nous n’adhérerions pas à l’idée de « constellation postnationale », telle que l’a défendue Jürgen Habermas1, nous pouvons au moins convenir de la pertinence de son constat quant à l’état de la souveraineté nationale aujourd’hui2. Il écrit : « La mondialisation des échanges et de la communication, de la production économique et de son financement, du transfert de la technologie et des armes, et surtout celle des risques écologiques et militaires, nous place devant des problèmes qui ne peuvent plus trouver de solution, ni dans le cadre de l’État-nation ni par la voie, jusqu’ici courante, des accords entre États souverains » (1998, p. 96-97), pour ajouter immédiatement que « la souveraineté des États-nations continuera à se vider de sa substance et appellera la construction et le développement de capacités d’action politique à un niveau supranational, dont les amorces sont déjà observables » (1998, p. 97). Si le diagnostic est confirmé, pourquoi faudrait-il que nous ne nous préoccupions que de renforcer l’exercice de la citoyenneté dans le cadre de l’État-nation. Ce que les Eurosceptiques feignent trop souvent d’ignorer, c’est que la poursuite du processus d’intégration européenne et sa politisation constituent peut-être l’unique moyen de conserver une pertinence au cadre national. Sauf à tout attendre de cet « État commercial fermé » que Fichte pouvait encore appeler de ses vœux en 1800, il conviendrait en fait d’intégrer à l’idée de souveraineté celle de paliers. Cela suppose fondamentalement de réhabiliter l’idée de choix, inhérente à la conception que nous avons de la vie démocratique, en aménageant les conditions de son exercice à des niveaux qui peuvent ne plus être seulement celui de l’État-nation. Une telle différenciation interne de la souveraineté est un processus inquiétant, nul ne songera à le contester. Comme le veut la sagesse populaire : on sait ce que l’on quitte, on ne sait pas ce que l’on trouve. Et il faut bien admettre qu’historiquement, et en dépit de ses indéniables faiblesses et errements, les mérites de la nation comme horizon de la citoyenneté et du développement sont immenses3. Mais le temps est peut-être venu de se demander si le risque, réel, ne doit pas être pris et pleinement assumé plutôt que subi, précisément pour que nous soyons collectivement en mesure de garantir que l’intégration politique européenne corresponde effectivement à une avancée dans la voie de la démocratisation et du développement et non l’inverse.
Les ouvrages de Jean-Louis Quermonne et de Jean-Paul Fitoussi, à partir d’une connaissance très fine et précise des rouages de l’Union, ont le mérite de reposer en termes éminemment politiques – au meilleur sens du mot – la question européenne. Ils éclairent, informent, tracent des perspectives, situent des débats, font, autrement dit, exister politiquement le projet européen.
Alors que Jean-Paul Fitoussi, adossée à sa formation d’économiste, pose le problème « de la souveraineté économique en Europe », Jean-Louis Quermonne interroge celui de la légitimité de l’Europe des institutions politiques. Avec ces ouvrages, il nous est donné le moyen de penser le problème des légitimités multiples et parfois concurrentes de l’Europe.
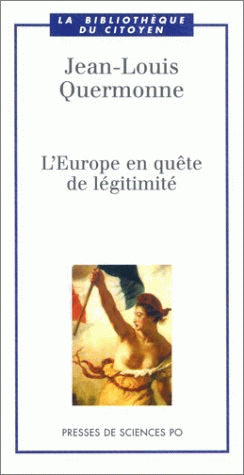
On s’inquiète souvent du « déficit de légitimité » de l’Union. C’est aussi de cette inquiétude que procède l’ouvrage de cet Européen convaincu qu’est Jean-Louis Quermonne. Il rappelle très à propos que, selon la définition qu’en donna le sociologue allemand Max Weber, la légitimité est la « qualité qui permet [à un système politique] d’assurer l’adhésion de la majorité des citoyens sous la forme d’une tolérance passive ou d’un soutien actif » (p. 13). Cette définition n’est nullement contraignante quant aux formes que peut revêtir la légitimité, elle indique simplement que celle-ci correspond à un mouvement d’adhésion active ou passive à un dispositif lui-même quelconque. En ce sens, l’Union européenne est-elle légitime ? Si oui, qu’est-ce qui l’est ? La réponse à cette seconde question devra en même temps nous indiquer le type de légitimité dont l’Union peut se prévaloir.
L’un des grands mérites de l’ouvrage de Jean-Louis Quermonne est de resituer historiquement la question des légitimités de l’Europe, afin de poser la question de savoir comment « dans le contexte de la modernisation, [celle-ci] doit assurer de façon démocratique le gouvernement de la majorité, le respect de l’État de droit, la recherche de l’efficacité et le maintien entre les États de l’impartialité » (p. 8 ; p. 88). Il note que la question ne s’est trouvée réellement posée qu’à l’occasion du débat sur la ratification du traité de Maastricht. C’est en effet à partir de ce moment – parce qu’était en jeu l’extension du pouvoir de l’Union sur des champs relevant traditionnellement des pouvoirs régaliens des États – que nous nous trouvions vraiment pour la première fois confronté à la question de la dimension politique de l’Union.
Dans le contexte des démocraties pluralistes, nous savons que la légitimité politique se règle sur un ensemble de repères tels que le principe majoritaire, l’état de droit – avec ce qu’il implique d’impartialité institutionnelle -, l’efficacité (qui dans le cadre de l’État-nation s’est réalisée par le biais d’une logique d’alternance politique). Ce type de légitimité est-il transposable en dehors du cadre de l’État-nation ? Est-il, autrement dit, applicable à l’Europe ? La réponse de J.-.L Quermonne ne souffre aucune ambiguïté : les repères en question ne sont pas tels quels transposables (p. 18). Ce qui signifie, en même temps, – et c’est un point qui a son importance, bien que l’auteur n’y insiste pas vraiment – que la notion de « déficit démocratique » de l’Union ne saurait s’apprécier dans les termes que l’on peut à juste titre mobiliser pour juger de la vitalité démocratique d’une nation4. Si, reprenant la formule de Jacques Delors, l’Union européenne est bien un « objet politique non identifié », et si, par extension, la légitimité politique de l’Union est une « légitimité politique non identifié », c’est que le projet européen et la forme de légitimité qui lui correspond se situent à mi-chemin entre l’État-nation et l’organisation internationale de type classique et leurs formes respectives de légitimité. Aujourd’hui, l’idée d’un déficit démocratique est liée à l’épuisement relatif des formes antérieures de légitimité : les premiers organes de l’Europe (la Haute autorité, la Commission, la Cour de justice) ne pouvant s’appuyer sur le type de légitimité que confère l’élection, n’eurent d’autre recours que de faire fond sur celui qu’assure la reconnaissance de l’impartialité et de l’expertise. J.-L. Quermonne note à juste titre que cette impartialité et cette expertise alimenteront dans un second temps, en un retournement qu’affectionnent les sociétés humaines, le dossier de l’instruction contre cette Europe apolitique que serait l’Europe des experts et des technocrates. Cette forme d’exercice du pouvoir a ensuite subi une double pression : externe tout d’abord avec la montée en montée en puissance d’une logique intergouvernementale s’appuyant sur une légitimité de type diplomatique, interne ensuite, avec la politisation relative et progressive de la commission par la nomination de personnalités issues du monde politique. Cette forme nouvelle de légitimité allait cependant rencontrer rapidement ses propres limites. La complexification du système et l’extension du champ des compétences communautaires induisaient, à partir des années 1970, une intensification de l’activité que ne pouvait et ne peut plus assumer l’Union et encouragea la mise en place d’un « fédéralisme intergouvernemental » qui correspondait à un renforcement de la présence des gouvernements nationaux. Du coup, les repères de la légitimité se trouvaient « confondus » et « ce mélange a produit un amalgame dont la caractéristique essentielle est le manque de transparence » (p. 25).
Cette opacification des repères de la légitimation politique ne fait que souligner la nécessité face à laquelle nous nous trouvons d’établir l’Union sur des bases qui soient désormais résolument démocratiques (p. 26). A la légitimité de l’expertise, et à la légitimité diplomatique, doit donc venir s’ajouter une légitimité démocratique. Par-delà la dimension diagnostic de l’analyse proposée par Jean-Louis Quermonne, se déploie donc une dimension prescriptive mesurée et féconde qui s’articule essentiellement autour de l’idée d’une convergence des « deux sources de légitimité politique : celle des États membres et celle des citoyens considérés individuellement » (p. 84). C’est à l’élaboration d’une telle proposition que sont consacrés les derniers chapitres de l’ouvrage, avec la défense notamment de l’idée de gouvernement mixte et de fédération d’États-nations.
Très intéressant dans son ensemble et toujours très stimulant, le livre de J.-L. Quermonne n’a rien perdu de son actualité. En raison même de cet intérêt, on aurait pu souhaiter que la réflexion soit poussée plus loin sur certains points. Il aurait été ainsi tout à fait intéressant de le voir problématiser davantage deux des présupposés forts de son propos : il soutient tout d’abord, en référence au livre de Bertrand Badie, que le monde est aujourd’hui « un monde sans souveraineté5 », mais ne précise pas, par exemple, quelles sont les implications d’une telle évolution, notamment par rapport aux quelques analyses qu’il consacre, au chapitre 10, à l’Europe comme « puissance pacifique » (p. 109-116) ; il fait ensuite fond sur une politique de l’identité, notamment dans sa mise en place du concept de « fédération d’États-nations », qui n’intègre aucun des éléments de la discussion contemporaine sur ce thème. On constate ainsi que c’est en raison d’une représentation éminemment nationale de la solidarité que Jean-Louis Quermonne milite, dans une perspective qu’il partage avec Jacques Delors, en faveur d’un maintien de la question sociale au niveau de l’État-nation (p. 94 sq.). « La nature même de ces politiques, écrit-il, en particulier la protection sociale, implique entre ceux qui sont appelés à les financer un lien de solidarité d’une intensité telle que seul un sentiment profond de citoyenneté est capable de le justifier. Déjà ce lien se trouve aujourd’hui contesté en Belgique, entre Flamands et Wallons, et en Italie du nord par opposition au Mezzoggiorno. Il serait, par conséquent, illusoire de vouloir instituer à court terme une sécurité sociale à l’échelle européenne » (p. 96). Cette thèse à elle seule pourrait faire l’objet de longues discussions. D’une part, parce qu’elle suppose une conception de la citoyenneté strictement référencée à une identité nationale (par opposition à des conceptions plus ouvertes de la citoyenneté6) ; d’autre part, parce qu’à travers la médiation de la citoyenneté, se trouve également affirmée, et en un sens confirmée, un rapport entre identité nationale et solidarité. Dans le contexte spécifique de la théorie contemporaine de la justice transnationale, Thomas Pogge avance des arguments très intéressants visant à contester la légitimité de ce rapport aux tendances exclusives. Même sans s’ouvrir aux axes de la discussion initiée notamment à partir de diverses variantes contemporaines du cosmopolitisme, il pourrait être judicieux de se demander si, lorsque l’on se pose la question de la légitimité de l’Union Européenne, il n’est pas crucial d’associer logique politique et dynamique sociale. Dans quelle mesure en effet le déficit démocratique de l’Europe s’explique-t-il exclusivement par des questions d’ordre institutionnel ? Aujourd’hui, « contrairement aux États providence hautement développés de l’Europe occidentale, écrit Andrew Moravcsik, l’État régulateur européen naissant n’est que marginalement impliqué dans les politiques sociales7 ». Ne pourrions-nous pas considérer qu’un renforcement de la présence de l’Union européenne dans des domaines relevant directement de la justice sociale pourrait contribuer tout à fait significativement à la résolution du problème du déficit démocratique de l’Union ? Par cette remarque, nous ne voulons pas contester l’urgence des problèmes institutionnels dont traite J.-L. Quermonne, mais simplement souligner que la démocratisation qui est recherchée ne pourra peut-être se faire, dans le contexte d’une organisation supranationale réunissant des États ayant fait le choix de la démocratie pluraliste, qu’autour de questions intéressant la justice sociale. En forçant le trait, nous pourrions nous demander pourquoi il faudrait que nous nous intéressions à l’Europe, si c’est la nation qui demeure seule garante de notre bien-être.
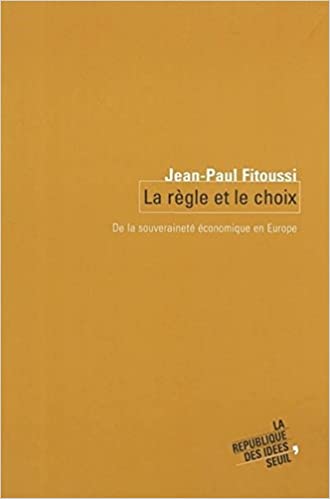
L’un des grands intérêts du livre de Jean-Paul Fitoussi réside dans le fait qu’il se situe précisément au niveau où s’articule exigence démocratique et réalité économique. En d’autres termes, tandis que J.-L. Quermonne nous éclaire sur la manière dont le « choix », comme mode d’insertion de l’individu dans les institutions de la citoyenneté, doit être repensé pour que l’Union européenne se hisse, institutionnellement, au niveau des défis qui l’attendent, J.-P. Fitoussi nous invite à réaffirmer les valeurs du choix dans le champ de l’économie européenne.
J.-P. Fitoussi part du principe que l’Union Européenne s’est instituée sur la base d’une logique qui n’a eu pour effet que de saper les fondements de la souveraineté. L’argument de Jürgen Habermas précédemment évoqué consistait à montrer que les souverainetés nationales s’étant affaiblies, il importait de leur substituer une souveraineté supranationale. J.-P. Fitoussi abonderait sous doute en ce sens, tout en récusant très fortement que l’édification de l’U.E. ait pu, de près ou de loin, ressembler à un tel processus. Le malentendu fondamental sur lequel s’est, selon lui, bâtie l’Union a consisté à inviter les États-nations à renoncer à des pans toujours plus significatifs de leur souveraineté, sans jamais ouvrir des espaces communautaires où puissent être réaffirmés ces segments de souveraineté. Il n’y aura donc pas eu, selon lui, de vase communicant entre les nations et l’Union qui en procède. Il n’y a, autrement dit, pas eu transfert de souveraineté, mais dilapidation de celle-ci. Quels sont les arguments mobilisés pour étayer une telle critique ?
Pour saisir la position de Jean-Paul Fitoussi, il faut l’inscrire dans le double héritage qui est le sien : une orientation néo-keynésienne marquée et la théorie du choix rationnel inspirée de l’œuvre fondamentale de Kenneth Arrow. Même en demeurant à un niveau très sommaire d’analyse, nous pourrons alors concevoir aisément les raisons pour lesquelles la notion de choix, qu’il oppose à celle de règle, est cruciale et pourquoi l’État est tenu pour le lieu privilégié de l’expression du choix. L’Europe cumule à cet égard le double désavantage d’affaiblir l’État ou de l’entraver et de correspondre à « un gouvernement par des règles plutôt qu’à un gouvernement par des choix ». Ce double désavantage qui provoque une sévère « limitation de l’espace des choix », à l’échelon national, sans ouverture d’un espace correspondant au niveau européen, a pour effet, selon lui, d’induire un processus constant de dépolitisation (de dé-démocratisation) des nations auquel ne répond aucun mouvement de démocratisation au niveau européen.
Son objectif est donc de défendre le principe d’un « gouvernement par les choix » (p. 16), en s’attachant à dresser plus précisément le diagnostic de la situation présente par l’examen d’une institution spécifique, à savoir le système européen de banques centrales. Ce système bancaire est pris comme indicateur « des difficultés du gouvernement économique dans un contexte démocratique ». Cette institution est en même temps représentative parce qu’elle se situe encore nettement au niveau d’un mode de légitimation par l’impartialité (garantie par son indépendance) et l’expertise.
Pour Jean-Paul Fitoussi, il faut réintroduire une logique du choix, dans un contexte institutionnel entièrement soumis aux rigidités de la règle. Il entreprend, autrement dit, de montrer les raisons pour lesquelles il est urgent de démocratiser le système européen des banques centrales. Ce faisant, il retrouve des éléments de l’analyse qui nourrissait l’un de ses ouvrages précédents, Le débat interdit8.
Dans son chapitre 1, il dénonce ainsi précisément les faillites de la « BCE », qui s’expriment en termes d’absence tant de responsabilité (accountability), qui seule pourrait asseoir sa crédibilité, que de transparence (clarté de l’information, efficacité de l’information délivrée en interne, conformité de la structure de l’information externe et de l’information interne, [p. 32]). L’enjeu de cette dénonciation est de montrer que si le système européen des banques centrales n’est pas dépourvu de mérite à certains égards, ses faiblesses sont structurelles et pourraient être corrigées à la faveur d’une action réformatrice précise qui viserait, par exemple, à établir – sans remettre en cause l’indépendance de la Banque centrale – une forme de responsabilité vis-à-vis du Parlement ou à attribuer aux instances politiques (Parlement, conseil des chefs d’États) des pouvoirs permettant de rééquilibrer leurs rapports qu’ils entretiennent avec la BCE. Que soient résolus les problèmes de responsabilité et de transparence, et ce sera le problème de la crédibilité dans son ensemble qui pourra être reconsidéré (par-delà sa définition en termes restrictifs de « réputation », p. 29-31, p. 78-79).
Ce déficit démocratique rend en effet difficile le débat sur des problèmes pourtant aussi centraux que le bien-fondé du pacte de stabilité et de croissance, non seulement en tant qu’objectif, mais aussi sur sa réalité en tant que seul objectif poursuivi par la BCE (p. 38). Les arguments qu’avance J.-P. Fitoussi à cet égard sont nombreux ; ils tendent tous à dévoiler les « fondements théoriques incertains » du Pacte de stabilité et ses conséquences pratiques. Ainsi, par exemple, l’hétérogénéité en termes de compétitivité, de taux d’ouverture, de structures industrielles et commerciales et de taux de chômage (p. 19) est importante entre les 12 pays de la zone euro – et elle le sera évidemment bien davantage avec l’élargissement de l’Europe – aussi devrait-elle, selon Jean-Paul Fitoussi, inviter à plus de souplesse, en permettant notamment aux différents états membres d’adopter des politiques économiques différenciées. Or, les « règles actuelles de gouvernance du policy mix européen, c’est-à-dire de la combinaison des politiques monétaires, budgétaires et structurelles » ne le permettent nullement. Ce constat ne conduit pas l’auteur à soutenir la nécessité d’un repli sur la sphère nationale, mais il explique en revanche le regret que l’on puisse vouloir soustraire le contenu même de ce policy mix à la discussion.
Les deux chapitres suivants abordent respectivement l’histoire récente de la politique monétaire conduite par la Banque Centrale Européenne et les problèmes particuliers que peut poser à cette institution le processus d’élargissement de l’Europe. Ils apportent utilement de nouveaux éléments de l’analyse, mais ne modifient pas substantiellement le cœur de l’argument qui est construit au niveau du chapitre premier.
En dépit de l’indéniable technicité des questions rencontrées, l’ouvrage reste clair de bout en bout pour le non spécialiste (auquel nous suggérons de commencer par lire l’annexe consacrée aux institutions économiques de l’Europe). Il nous invite à considérer la nécessité d’une « libération de la politique budgétaire » (p. 52) dont on perçoit bien, dans la perspective vigoureusement défendue par Jean-Paul Fitoussi, les tenants et les aboutissants. On peut bien sûr se demander s’il suffira que la politique budgétaire soit « libérée » pour que la démocratisation se fasse effectivement, non plus seulement au niveau des institutions, à la faveur de toute une série de médiations, mais au niveau de ceux dont on attend qu’ils s’investissent comme citoyens dans leurs pratiques mêmes. De même on peut s’inquiéter de ce que pourrait avoir de contreproductif finalement une opposition trop tranchée du choix et de la règle. Jean-Paul Fitoussi lui-même ne succombe pas, en dépit de certaines formulations qui pourraient donner à le penser, à cette tentation, puisqu’il ne s’oppose pas à l’idée qu’il puisse y avoir des règles, mais simplement à ce que le processus présidant à leur élaboration se fasse entièrement en dehors du champ politique. Il faut, autrement dit, non pas tant opposer la règle et le choix que redécouvrir la place du choix démocratique au cœur même de la règle.
Avec les ouvrages de Jean-Louis Quermonne et de Jean-Paul Fitoussi, dont nous n’avons ici couvert qu’une part réduite de la matière, nous bénéficions donc d’un regard croisé sur différents versants des institutions de l’Europe. Ils contribuent tous les deux à dégager des pistes intéressantes en vue d’une démocratisation des institutions politiques et économiques de l’Union. Mais notons au passage qu’ils éclairent en même temps une tendance forte de la théorie politique contemporaine consistant à penser la démocratie (et la démocratisation) à partir d’arrangements et d’aménagements constitutionnels et institutionnels.
En conclusion, nous dirons simplement que si les livres les plus longs sont, comme l’écrivait Kant, les livres qui nous font longtemps réfléchir, ces deux livres, bien que fort courts, sont décidément bien longs.
==================
NOTES
- Jürgen Habermas (2000), Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. fr. par R. Rochlitz, Paris, Fayard.[↩]
- Jürgen Habermas (1998), L’intégration européenne. Essais de théorie politique, trad. fr. par R. Rochlitz, Paris, Fayard, p. 67-150.[↩]
- Cf. sur ce point Dominique Schnapper (1994), La Communauté des citoyens, Paris, Gallimard, coll. « NRF » ; David Miller (1997), On Nationality, Oxford, Oxford University Press.[↩]
- C’est là un point qui pourrait peut-être permettre de s’interroger de manière critique sur la pertinence de l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe le 12 octobre 1993.[↩]
- Bertrand Badie (1999), Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard.[↩]
- Les travaux sur ce thème sont extrêmement nombreux. Signalons à cet égard le livre de Will Kymlicka (2001), La citoyenneté multiculturelle (Paris, La découverte) qui a l’avantage à la fois de faire le point sur la discussion et de défendre une thèse originale. Cf. également Will Kymlicka et Sylvie Mesure (2000) (éd.), Les identités culturelles, coll. « Comprendre », n° 2, Paris, Presses Universitaires de France.[↩]
- Andrew Moravcsick (1998), éd., Crentralization or Framentation ? Europe Facing the Challenges of Deepening, Diversity, and Democracy, New York, Council on Foreign Relations, p. 24.[↩]
- Jean-Paul Fitoussi (2000), Le débat interdit. Monnaie, Europe, pauvreté, Paris, Seuil (1ère édition, Arléa, 1995).[↩]

Patrick Savidan
Patrick Savidan est agrégé et docteur en philosophie, professeur en science politique au sein du département de droit public et de science politique de l'Université Paris Panthéon-Assas et directeur éditorial des Editions Raison publique. Ses travaux portent principalement sur la démocratie et la justice sociale et s'attachent à éclairer les questions morales et civiques que soulève notre époque en les reliant aux enjeux classiques et contemporains de la philosophie politique.
Parmi ses derniers ouvrages: Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale (dir., Presses universitaires de France, 2018) ; Dire les inégalités. Représentations, figures, savoirs (dir. Avec R. Guidée, Presses universitaires de Rennes, 2017) ; Voulons-nous vraiment l’égalité ? (Editions Albin Michel, 2015); Repenser l'égalité des chances (Livre de poche [Grasset], 2010); Multiculturalisme (PUF, 2009).
