Fictions politiques, démarches impolitiques
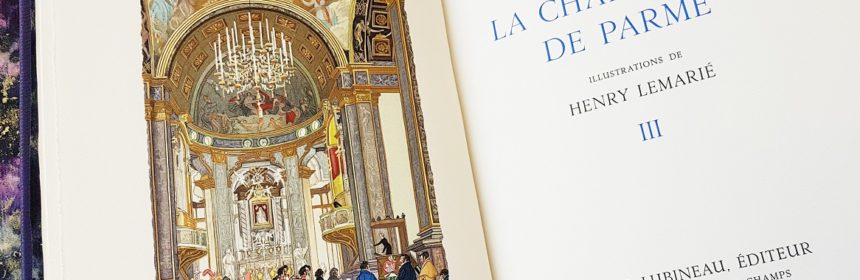
Cet article a initialement été publié au sein du dossier “La Fiction politique (XIXe-XXIe siècles)” qui reprend les actes de la journée d’étude et de la table ronde d’écrivains organisées par le Groupe phi et New York University.
Cet article se donne pour objet de penser la « fiction politique » en reprenant et interprétant les hypothèses principales qu’Emmanuel Bouju et moi-même avons avancées dans l’introduction, et en les assortissant de propositions complémentaires qui trouvent leur illustration dans les romans de Stendhal et de Zola.
Hypothèses et propositions
1. La fiction politique échappe à la théorisation directe par la philosophie politique classique (ou par la théorie « du politique ») mais peut être lue elle-même comme une forme de théorie de « la politique ».
La politique « avec un petit p », souvent appelée « the Political » en anglais est bien sûr le pendant de la politique « avec un grand P » : « The Political », avec son insistance sur l’article défini, est devenu ces vingt dernières années un mot d’ordre pour le refus de la gauche d’accepter les termes de la politique telle qu’elle a cours dans la médiocratie. Bien que ce terme ne recouvre aucune unité de programme théorique, il a néanmoins servi de nom de code pour le rejet des flatteries du triomphalisme capitaliste à l’ère des hypermarchés mondialisés de l’après-chute du Mur. Comme l’a bien montré Alain Badiou dans Abrégé de métapolitique on a fait appel à ce terme pour délégitimer la « diversité d’opinion » afin d’aménager « la possibilité d’une rupture avec ce qui existe[1]. » Et il a été utilisé comme expression passe-partout pour désigner des pensées politiques aussi bien classiques (la pensée platonicienne, machiavélienne, kantienne) qu’encore inouïes (un communisme-à-venir, une démocratie affranchie de l’éthique appliquée, un sujet politique « inarticulable[2] »). Je reste attachée à ce sens de « the political », quitte à me trouver confrontée à un nouveau cercle dont la portée s’étend à la politique dans ses acceptions les plus floues et quotidiennes. Une polémique centrale ici concerne la distinction traditionnelle entre « le politique » et « la politique » (cette deuxième étant en gros synonyme de la « politique avec un petit p »). Mon hypothèse est que « la politique » a été abandonnée aux politologues qui s’intéressent à l’opinion et mesurent la micro-influence des éléments de langage sur les suffrages. Ceux qui entendent « penser la politique » semblent en effet avoir délaissé ce domaine médiocre et trivial en faveur du politique, qui rejette la science politique conventionnelle au motif qu’elle privilégie la pragmatique au détriment de l’imagination politique. La politique, dans cette vision des choses, interdirait toute politique critique. La seule alternative est un « retrait du politique » (pour citer Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe[3]), autrement dit la promotion d’une autre conception du politique, enracinée dans une sémantique de l’égalité, de la communauté singulière, de la justice sociale et intempestive, de la dé-privatisation et de ce que nous appelons creative commons. Cette position est séduisante à bien des égards, et la thèse selon laquelle le discours politique a été appauvri par la phobie du néolibéralisme à l’égard de la pensée marxiste me paraît tout à fait convaincante, mais je ne suis pas sûre pour autant qu’il soit sans danger d’abandonner à d’autres la « politique avec un petit p ». La hantise du compromis politique a eu pour conséquence d’exclure les possibilités d’intervenir sur ce que Ross McKibbin appelle la « whatworks politics » (la politique de « ce-qui-marche »), soit le nom d’une politique « réaliste » et prétendument détachée de toute affiliation partisane et idéologique, en dépit des évidences[4]. Abandonner la politique aux mains des techniciens et des experts patentés risque de mettre les théoriciens de la politique « avec un grand P » hors d’état de nuire. En construisant « le politique » comme une extension onto-théologique de la souveraineté et du pouvoir étatique, de nombreux théoriciens ont sous-estimé à quel point le champ de force aux contours mal définis de la « politique avec un petit p » – qui peut aller des petits arrangements entre amis et des potins mondains au magnétisme animal et aux variations de pression atmosphérique – conforte le système capitalo-parlementaire qui court de la France du Second Empire jusqu’à aujourd’hui. Comme Roberto Mangabeira Unger l’a montré dans l’objectif de maintenir la théorie sociale branchée sur la micropolitique, « l’illusion de l’indivisibilité des contextes formateurs, qui a abouti à la croyance selon laquelle « tous les changements hormis la révolution totale ne sauraient se ramener qu’à une basse cuisine conservatrice […] condamne ses adeptes à une oscillation mortifère entre confiance injustifiée et prostration tout aussi injustifiée[5] ».
Pour tenter d’éviter ce double écueil, j’aimerais mettre à l’épreuve des manières de penser politiquement qui échappent à la dichotomie entre le politique et la politique. En m’appuyant sur des auteurs aussi divergents que Alain Badiou, Jacques Rancière, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, ou Roberto Mangabeira Unger, j’entreprendrai de lire la fiction politique comme « théorie », c’est-à-dire comme ce qui rend pensable le fonctionnement et la critique d’une société de calcul. La société de calcul – pour reprendre une expression chère à Alain Badiou – peut être vue comme le témoin de l’ampleur avec laquelle tous les aspects de l’échange et de la vivacité humaine ont été amortis, et métamorphosés dans un « médium » dominé par la publicité et la course au profit.
2. La fiction politique peut être considérée comme la version faible, dégradée ou paradoxalement déflationniste du roman historique – une forme jugée pauvre en souffle épique et en focalisation, ce catalyseur singulier d’événements transformateurs de monde. Là où protagoniste et tournant historique tendent à s’aligner dans le Bildungsroman, dans la fiction politique le héros est éclipsé par une multitude de personnages secondaires. Les motifs de la guerre et de la construction nationale sont occultés par un mode de déploiement digressif de l’intrigue politique.
La fiction politique transcrit l’histoire mais ne se veut ni épopée, ni roman de décor. Même si l’on suit Alessandro Manzoni, dans son Del romanzo storico[6] (1850) – quand il insiste sur le fait que le roman historique instaure un régime d’indistinction entre factuel et fictif, et prive le lecteur d’une structure unifiante –, la fiction politique va encore plus loin dans la détotalisation narrative. Elle cherche à représenter l’événement dans sa dimension intempestive et entropique. En narrant la ratiocination d’une société de risque, d’agiotage, d’intrigue, d’intérêt, de raison instrumentale et machiavélique, elle ne se conforme pas aux grandes lignes narratives de l’épopée historique. Elle échange la représentation de la conscience historique contre les formes narratives les plus élusives et fuyantes, précisément parce que ce sont celles de la politique même – comme nous l’avons avancé en introduction.
3. En lieu et place du didactisme idéologique du roman à thèse ou de la « totalisation rétrospective » du roman historique (telle que prescrite par Georg Lukács), la fiction politique offre une psychologie du calcul et de connivence. Ce qui est mis en avant, c’est un réalisme psychologique dans lequel la réflexion politique est mue par l’intérêt, et la souveraineté conçue, pour citer l’expression de Stephen Krasner, comme une « hypocrisie organisée[7] », c’est-à-dire une configuration dans laquelle la violation plus ou moins ouverte des normes et des règles est tolérée comme le prix à payer pour le maintien de la paix sociale et la consolidation du pouvoir. L’« hypocrisie organisée » est l’un des nombreux noms par lesquels on pourrait désigner la forme narrative « machiavélienne » mise au point et affinée par Stendhal dans Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme et Lucien Leuwen, puis reprise par bon nombre de ses successeurs du xixe siècle, au premier rang desquels, Flaubert, Zola, Taine et Maupassant.
4. La fiction politique ne revêt pas de forme générique particulière mais emprunte à des modèles pragmatiques et narratifs multiples, en en variant les champs d’application, et en épousant ainsi divers styles de vie (dans le sens donné à cette expression par Marielle Macé[8]). La fiction politique peut ainsi être lue comme un inventaire de modes d’existence politique qui nous permet d’esquisser une théorie de démarches « impolitiques ». Par « impolitique » je souligne, d’une manière littérale, l’impoli et la rudesse sollicités comme ressources pour une politique impavide et obstructionniste. Je m’appuie aussi sur l’usage de l’impolítico de Roberto Esposito, non pas dans le sens d’une communitas à venir – ce qui est le plus important pour Esposito – mais plutôt en tant que regard ou optique : regard qui repère l’intervention anonyme, la posture impassible et « absentive », ou l’effet de « l’impensé », concept-clef de Kostas Axelos, pour qui il sert de moyen d’offensive contre « l’époque du management généralisé[9] ».
Comme il n’y a pas de consensus, ni dans l’histoire littéraire, ni dans la critique littéraire sur la définition de la fiction politique, j’ai choisi ici d’en bricoler une à partir des textes et des typologies narratives existantes (roman historique, roman diplomatique[10], roman sentimental, roman à thèse, etc.). Mes recherches m’ont amenée en Grande Bretagne vers Anthony Trollope, avec The Way We Live Now (1875), et vers Benjamin Disraeli, avec Sybil or The Two Nations (1845) et surtout Coningsby (1844) et sa dissection de la politique Whig, sa philosophie utilitariste, et les changements qui ont suivis le Reform Bill de 1832. En France, le canon de la fiction politique inclut selon moi des traités philosophiques déguisés en fiction (Les Lettres persanes, Candide, Adolphe), des parodies d’imbroglios aristocratiques (Les Liaisons dangereuses, La Chartreuse de Parme), des romans de l’événement historique (Les Chouans, La Reine Margot, Quatre-vingt-treize), des romans de la presse (L’Education sentimentale, Bel-Ami), des chroniques de la scène sociale (Vie et opinions de M. Fréderic-Thomas Graindorge de Taine, À la recherche du temps perdu) et les récits de politique ministérielle (Son Excellence Eugène Rougon de Zola, Son excellence le ministre de Jules Claretie). La fiction financière figure ici aussi – avec ses drames inspirés par la spéculation, la fraude, les intrigues boursières, les krachs : César Birotteau, Lucien Leuwen, L’Argent et La Curée en sont évidemment de très bons exemples.
Ce sont des romans qui anticipent une mouvance théorique repérable dans trois ouvrages récemment publiés en France. Dans Enquête sur les modes, Bruno Latour choisit le stock ticker comme objet qui incarne les « chemins par lesquels transite l’économie – avec un petit e. » Il résume ainsi toute une série:
[…] les livres de comptes, les bilans, les feuilles de paye, les outils statistiques, les salles de marché, les écrans Reuter, les organigrammes, les plannings, les logiciels de conduite de projet, les automates de ventes d’action, bref, ce qu’on peut regrouper dans l’expression de clefs de répartition, ou en inventant le terme, de valorimètre – puisqu’il mesure, des évaluations et des valeurs[11].
Frédéric Gros, dans son livre Le principe sécurité parle, d’une façon complémentaire, d’une « managérisation des existences » (à propos des réflexions de Foucault sur le néolibéralisme américain) :
Chacun est appelé à se rapporter à soi comme à une entreprise, à construire sa vie comme une série d’investissements dont on attend le profit. Le capitalisme financier entraîne plutôt une actionnarisation de l’existence. Toute entité, chaque individu devient un “actif financier”, un support de spéculation. … le problème n’est pas de savoir quel est son prix, mais d’anticiper sa courbe de valorisation[12].
Enfin, on citera le commentaire que Luc Boltanski propose dans Enigmes et complots : Une enquête à propos d’enquêtes :
L’une des expériences fondamentales qui ont accompagné la montée en puissance du capitalisme, et au travers desquelles se sont forgées les subjectivités au cours du XIXème siècle, a été celle de la volatilité des fortunes liée aux aléas de la finance, notamment des marchés boursiers[13].
Qu’il s’agisse du stock-ticker ou valorimètre, de managérialisation et actionnarisation, ou d’aléas de finance, on tombe ici sur les modes d’existence de la finance (ou de la « financialisation »). Le corollaire en littérature contemporaine se trouverait dans des fables d’argent comptant, tel que The Embezzler (l’escroc, le fraudeur) de Louis Auchincloss (1966), ou plus récemment dans The Pale King de David Foster Wallace (2011) ou dans Capital (sur le marché immobilier) par l’auteur britannique John Lancaster (2012).
Manquant toujours d’une définition précise des enjeux de la fiction politique, on aura recours aux questions soulevées par ses diverses formes. Qu’est-ce qu’un roman constitutionnel ? Qu’est-ce qui nous permet de lire l’Adolphe de Constant comme une théorie de la liberté négative et du système d’opinion? Qu’est-ce que le roman de la Restauration (au sens badiousien d’une séquence révolutionnaire achevée, du nom de la domination toujours actuelle de la société de calcul) ?
En termes ranciériens, le genre de la fiction politique pose la question de la façon dont l’esthétique redistribue le politique, ou démocratise la démocratie via un remaniement égalitaire de la grammaire et de l’usage. Il y a aussi la voie tracée par Marc Angenot, Fredric Jameson, Marie-Eve Therenty et Dominique Khalifa, qui infèrent le matérialisme historique du discours social en s’appuyant sur la presse, la culture populaire et la haute et basse littératures pour analyser les modalités de la conscience historique associée par exemple à la monarchie bourgeoise, aux faubourgs, à la police ou à la révolte de la rue.
Ces questions nous orientent vers un glossaire de mot-concepts qui méritent d’être travaillés et traduits en termes littéraires :
- le langage des Institutions (parlementarisme, monarchie, ministères, partis, municipalités, corps législatifs et diplomatiques) ;
- les « ismes » des Idéologies : (absolutisme, capitalisme, républicanisme, constitutionalisme, libéralisme, socialisme utopique, méritocratisme, Exceptionnalisme, Humanitarisme) ;
- le lexique de la Théorie politique (polis, gouvernementalité, État-providence, appareil étatique, antagonisme social, biopolitique) ;
- le vocabulaire des philosophies politiques de Platon à Arendt et Habermas ;
- les descripteurs de Policy (nationalisation, privatisation, laissez-faire, trickle-down) ;
- et les mots précis pour désigner les éléments du processus politique (compagnes électorales, sondages, action directe, premier et deuxième tour, etc.).
Dans la forme fictionnelle qu’elle prend au dix-neuvième siècle, la politique se manifeste en particulier dans les dialogues insérés dans le texte – ces interminables discussions autour de quel parti ou ministre devrait accéder au pouvoir. Elle prend la forme d’un écheveau presque inintelligible de références à des acteurs politiques à demi oubliés. Prenons L’Education sentimentale : qui était Pritchard ? (réponse : un missionnaire protestant anglais à Tahiti soutenu par Guizot) ; qui était Changarnier ? (réponse : un monarchiste anti-bonapartiste tombé en disgrâce en 1851). Comment savoir si La Mode était un journal réel ou fictif, et ne pas passer à côté de son orientation légitimiste ? Qui étaient les Carbonari, dont le nom (qui signifie « charbonniers ») renvoyait aux sociétés révolutionnaires et anticléricales ? Quelles furent les retombées politiques de « l’affaire Praslin », dans laquelle le duc, soupçonné d’avoir assassiné sa femme, utilisa sa position sociale pour échapper au système judiciaire ? Sous les frontières floues de ces éléments d’information politique se cache la trame de fond politique encore plus impénétrable, qui resurgit à la surface à travers les commérages, comme dans ce passage de L’Education : « Puis la conversation descendit aux événements contemporains : les mariages espagnols, les dilapidations de Rochefort, le nouveau chapitre de Saint-Denis…[14] ».
Les scènes dans lesquelles les personnages parlent de politique ou évoquent des mondes temporaires faits de petites péripéties dérisoires, impropres à entrer dans l’histoire, montrent comment les impulsions se diffusent dans des champs de force d’inaction et de non-productivité. Elles fournissent une radiographie de la façon dont la gouvernementalité se traduit dans ce que R. Mangabeira Unger appelle les cadres de « la vie sociale habituelle », cadres qui garantissent « l’immunité aux perturbations » et qui « subsistent en un sens pratique, à travers la résistance qu’ils opposent à toute volonté transformatrice[15] ».
Le revers de la médaille, toutefois, c’est la façon dont le roman politique témoigne de la manière dont les rencontres fortuites entre les gens et les choses affectent les séries de causalité structurales. Quand, par exemple, dans Bel-Ami de Maupassant, Georges Duroy, fauché, reconnaît un ancien camarade d’armée place de l’Opéra, tout repose sur sa capacité à se remémorer le nom de son ancien camarade de régiment pour l’interpeller immédiatement : « Tiens, Forestier ! » Le mouvement fulgurant du souvenir à l’acte de parole change complètement la donne, puisque Duroy se sert de Forestier pour faire son entrée dans le milieu du journalisme de seconde zone, ce qui lui permet de récrire l’histoire de la brutale campagne algérienne menée par la France sous la forme d’un roman d’aventure nationaliste[16]. Une autre rencontre fortuite se transforme plus loin en fortune politique en l’espace de deux tasses de café. Duroy reçoit une tasse pleine des mains de Madame Forestier, qui lui conseille de faire la cour à la femme du propriétaire du journal, et l’instant d’après, il débarrasse Madame Walter de sa tasse vide, ce qui lui ouvre les portes de son salon. Machiavel a donné le nom de « fortuna » aux facteurs aléatoires susceptibles de favoriser ou de contrarier un destin politique, la fortuna s’opposant à la virtù (définie comme sagesse ou habileté politique), même si l’une et l’autre force contribuent à l’instrumentalisation des occasions de gagner du pouvoir.
Le machiavélisme de Stendhal et de Zola
On sait que Balzac considérait qu’avec La Chartreuse de Parme Stendhal « [avait] écrit Le Prince moderne, le roman que Machiavel écrirait, s’il vivait banni de l’Italie au xixe siècle[17]. » D’éminents spécialistes s’insurgeraient contre cette réduction de La Chartreuse de Parme à son contenu politique, mais la lecture de Balzac est convaincante et mériterait d’être réhabilitée, si l’on considère la façon dont le machiavélisme — entendu comme synonyme de réalisme politique et de la raison instrumentale – est mis en œuvre. Considérons, par exemple, ce passage de la Chartreuse où l’on suit, pas à pas, les cogitations du Comte Mosca. Il veut séduire une dame plus jeune, et la conquête est le résultat d’une intelligence critique appliquée à un accident de démarche. Mosca découvre, dans un moment d’hésitation sur une marche d’escalier, la matière propice pour sa campagne amoureuse. Faisant un usage utilitariste de sa propre « timidité », il profite en homme d’esprit de la situation. Dans ce passage fascinant, logique et logistique vont de pair pour révéler une économie du psycho-pouvoir:
Le comte se disait : Je ne saurais passer qu’une demi-heure tout au plus dans sa loge, moi, connaissance de si fraîche date ; si j’y reste davantage, je m’affiche, et grâce à mon âge et plus encore à ces maudits cheveux poudrés, j’aurai l’air attrayant d’un Cassandre. Mais une réflexion le décida tout à coup : si elle allait quitter cette loge pour faire une visite, je serais bien récompensé de l’avarice avec laquelle je m’économise ce plaisir. Il se levait dans la loge où il voyait la comtesse ; tout à coup il ne se sentit presque plus d’envie de s’y présenter. Ah ! voici qui est charmant, s’écria-t-il en riant de soi-même, et s’arrêtant sur un escalier ; c’est un mouvement de timidité véritable ! Voilà bien vingt-cinq ans que pareille aventure ne m’est arrivée.
Il entra dans la loge en faisant presque effort sur lui-même ; et, profitant en homme d’esprit de l’accident qui lui arrivait, il ne chercha point du tout à montrer de l’aisance ou à faire de l’esprit en se jetant dans quelque récit plaisant ; il eut le courage d’être timide, il employa son esprit à laisser entrevoir son trouble sans être ridicule. Si elle prend la chose de travers, se disait-il, je me perds à jamais[18].
Si La Chartreuse identifie le machiavélisme avec la raison instrumentale, Lucien Leuwen la définit comme un mode d’emploi de l’art de la duperie en politique. Pour Maurice Bardèche, La Chartreuse ouvre le dossier « comment on gouverne », tandis que Lucien Leuwen expose la mécanique de « comment on administre »[19]. C’est une distinction utile car elle attire l’attention sur le niveau de détail qu’exige la politique comme métier. Nous observons de près Lucien tandis qu’il observe lui-même un ministre qui fait ce que l’anglais nomme insider trading avec l’aide de son propre père, banquier à la Bourse. Leuwen père conseille à son fils de mettre son intelligence mathématique au service de la psychologie, de déjouer le système non pas en perdant son temps avec de petits spéculateurs, mais en jouant sur les faiblesses et la vanité de ses supérieurs. En tant que maître des requêtes, Lucien tend des pièges à ses rivaux, en interceptant et trafiquant des missives secrètes (c’est ainsi qu’il fait tomber le maladroit Monsieur des Ramiers, surnommé le « Fénelon moderne », qui finit humilié publiquement par l’ambassadeur russe dans les salons de la diplomatie de haut vol).
S’il y a bien un message distillé dans ce roman, c’est que les banques contrôlent la classe politique. Les ministres, dit la formule, font la fortune de qui leur plaît, mais ce sont les banques, détenues par des familles comme les Rothschild et les Leuwen, qui font les ministères. Comme c’est probablement encore le cas aujourd’hui, le gouvernement ne diffère pas beaucoup d’une holding géante. Le message anti-banques de Stendhal rappelle son début de carrière comme pamphlétaire. Dans son opuscule proto-keynésien de 1825, D’un nouveau complot contre les industriels, il fustigeait les industriels – un terme lâche pour désigner les banquiers, les investisseurs, ou les spécialistes du capital risque – d’utiliser leur pouvoir de prêter de l’argent pour dicter la politique. Il emboîtait le pas de l’économiste libéral Jean-Baptiste Say en critiquant l’appropriation de la rhétorique saint-simonienne par les élites financières, au point de faire passer l’opportunisme économique et l’exploitation ouvrière pour une aide sociale providentielle et de les présenter comme les bénéfices radieux de la productivité[20]. Même si Stendhal lui-même avait des convictions politiques versatiles et contradictoires – anti-ancien régime mais fasciné par le mode de vie aristocratique, anti-Empire mais auteur des Mémoires sur Napoléon, opposé au suffrage universel mais ayant de la sympathie pour la multitude –, certains critiques ont qualifié Lucien Leuwen de Jacobin de cabinet se battant pour un avenir politique qu’il avait perdu la capacité de discerner ; un personnage aveugle aux déterminations historiques de la corruption de la monarchie de Juillet et à son propre statut de symptôme. Michel Guérin, professeur de lycée à Marseille et critique littéraire enclin aux boutades, fait partie de ces critiques. De son point de vue, le roman offre une plongée dans les hypocrisies du capitalo-parlementarisme à l’orée de l’ère Mitterrand. Son livre La Politique de Stendhal, publié en 1982 avec une préface de Régis Debray, a paru dans une intéressante collection des PUF intitulée « La Politique éclatée ». Guérin y présente Stendhal comme le premier spécialiste de science politique d’Europe ; un fin analyste de la distinction entre « le politique » et « la politique ».
C’est Son Excellence Eugène Rougon, le roman de la vie parlementaire écrit par Zola en 1876, qui incarne le mieux le machiavélisme sous la forme d’un roman du Second Empire. C’est l’un des romans de la série des Rougon-Macquart qui a connu le moins de succès, mais aussi l’un de ceux que Zola a eu le plus de difficultés à écrire, à cause de son manque de goût, comme l’a montré Robert Lethbridge, pour les intrigues contournées de la fiction politique[21]. Pour planter le cadre de ce roman, Zola a puisé dans son expérience de journaliste politique (pour La Tribune, Rappel et La Cloche entre autres), et notamment de sa couverture de voyages de l’Assemblée nationale à Bordeaux et à Versailles en 1871 et en 1872. En cette période d’instabilité parlementaire du début de la Troisième République, née sur les décombres de « la défaite », la vie politique était marquée par « des discussions stériles, des initiatives bureaucratiques médiocres, et la distribution de faveurs et de passe-droits légaux[22] ». Zola s’est inspiré de cette atmosphère d’asthénie politique pour sa description de l’oligarchie napoléonienne, un régime connu pour son origine illégitime dans un « coup d’État », son gouvernement par plébiscite, son absence de justice démocratique, son talent à jouer des rivalités entre clans adverses, sa prédilection pour la corruption comme modus operandi privilégié, sa pompe et sa propagande sophistiquée.
En écrivant la chronique de la carrière d’Eugène Rougon, le ministre et lieutenant fictif de Napoléon iii (et un composé de politiciens ayant réellement existé comme Eugène Rouher, le général Espinasse, le duc de Persigny et Guizot – le Karl Rove ou l’« éminence grise » conservatrice de Napoléon), Zola a entrepris une biographie du pouvoir tel qu’il s’inscrit dans les institutions politiques. L’intrigue, pour autant que l’on puisse parler d’intrigue, tourne autour de l’émergence d’intérêts et d’agendas dominants, de revirements idéologiques opportunistes, et d’une suite ininterrompue de duperies et de volte-faces. Elle se concentre précisément sur ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir de toutes les capitales et de toutes les villes de province du monde, c’est-à-dire la politique as usual, les trafics de cette matière première constituée par les informations personnelles, les scandales, les escroqueries, les imbroglios et les rumeurs. Dans « le balbutiement rapide que pas un député n’écoutait » et le « brouhaha » qui emplit la Chambre des députés dans la scène d’ouverture, on entend le grondement souterrain de la politique « avec un petit p »[23]. Ce bourdonnement endort les sens, comme l’humidité du mois de mai qui émane directement de l’ennui des députés assoupis. Zola dépeint la politique comme un affect contagieux qui se répand à travers les espaces sociaux sous la forme de commérages[24]. Elle stimule des campagnes de dénigrement, comme quand les partisans de Rougon se mobilisent pour le faire revenir au pouvoir à grand renfort de fuites dans la presse et d’attaques partisanes :
On se partageait les missions difficiles. On se lançait tous les jours au milieu de Paris, avec la volonté entêtée de conquérir une influence. On ne dédaignait rien ; les plus petits succès comptaient. On profitait de tout, on tirait ce qu’on pouvait des moindres événements, on utilisait la journée entière, depuis le bonjour du matin jusqu’à la dernière poignée de main du soir. Les amis des amis devinrent complices, et encore les amis de ceux-là. Paris entier fut pris dans cette intrigue[25].
Et on la suit comme un miasme qui s’immisce dans les espaces privés qu’elle transforme en espaces d’entropie et en reliquaires de vilains petits secrets. À travers une évocation des rues parisiennes après un attentat à la bombe manqué contre l’empereur (l’attentat d’Orsini du 14 janvier 1858), Zola distille l’essence de la violence anti-impériale sous l’aspect d’une malveillance atmosphérique qui se transforme en météorologie autoritaire. Pris d’une envie de sortir, Rougon quitte son appartement et interprète la lourdeur du ciel comme une revanche pour ce jour chaud et radieux où l’empereur – grevant le budget de l’État d’une lourde charge – avait fait baptiser son fils sous les clameurs de la foule : « Un ciel sans lune, la ville terrifiée et muette, les quais vides, traversés d’un frisson qui effarait les becs de gaz, avec quelque chose de louche embusqué au fond de la nuit. Lui, respirant à longs soupirs, aimait ce Paris coupe-gorge, dans l’ombre effrayante duquel il ramassait la toute-puissance[26] ». La corruption, la peur et la criminalité vont concourir à conférer à Rougon un pouvoir élargi. Alors qu’il hume l’atmosphère fatale, il prend la décision d’adopter un mode de gouvernement plus intransigeant : « Jules, donnez-moi donc un synonyme à autorité, dit Rougon à son secrétaire alors qu’il prépare une série décrets répressifs. « “Mais pouvoir, gouvernement, empire”, répondit le jeune homme en souriant. »
Conclusion
L’affirmation énigmatique de Walter Benjamin dans Paris, Capitale du xixe siècle, selon laquelle « l’empire est le style du terrorisme révolutionnaire pour qui l’État est une fin en soi[27] », renvoie à l’Empire de Napoléon ier mais trouve sa véritable incarnation dans le Second Empire. Car, comme le laisse entendre Benjamin, le succès de Napoléon iii consiste précisément à avoir su inventer un style Second Empire – un gouvernement répressif instillé dans les matériaux de la modernité esthétique et technique – qui intègre la révolution et subsume la domination bourgeoise et le fonctionnalisme étatique. L’autorité du Second Empire pénètre aussi la société sous la forme de « la haine de la démocratie », caractérisée par Jacques Rancière comme une guerre généralisée menée par les élites contre « le torrent démocratique » : Rancière entreprend d’identifier la démocratie non pas à des modes spécifiques de contrôle étatique autoritaire, mais à « cette condition paradoxale de la politique » associée à « la contingence égalitaire qui soutient la contingence inégalitaire elle-même[28] ». Les passe-temps populaires, la recherche des loisirs et les objets de consommation, ces figures éphémères de la société de consommation qui tout à la fois offensent et alimentent l’État conservateur, sont autant d’éléments à repenser en visant une démarche impolitique, démarche dans laquelle on détourne ce que Roberto Mangabeira Unger, on l’a dit, appelle la « politique au jour-le-jour sans raison ». Une société bonne, soutient Unger, devrait abolir la distinction entre la politique au jour-le-jour et la politique révolutionnaire et tout considérer comme « bon à prendre », y compris les banals arrangements institutionnels. Le programme de Unger pour affranchir la politique de la « fausse nécessité », son argumentation en faveur d’un « désenclavement » [« disentrenchment »] des pratiques politiques qui entravent le changement et condamnent les institutions démocratiques au respect des règles et à l’éternelle répétition du même, m’a incitée à considérer les romans politiques du xixe siècle comme des livres-source d’une politique avec un petit « p », dans laquelle on trouve des secrets d’une nouvelle démarche impolitique.
Notes
-
A. Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, Seuil, 1998, p. 66. ↑
-
« La politique ne représente nullement le prolétariat, la classe ou la Nation. Ce qui fait sujet en politique, quoique avéré dans son existence par l’effet politique même, y demeure inarticulable » (A. Badiou, Peut-on penser la politique ?, Paris, Seuil, p. 87). ↑
-
Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Le retrait du politique, Paris, Galilée, 1983. ↑
-
« La culture du groupe cible, néanmoins, ne mène pas à une politique apolitique. Elle renforce au contraire le statu quo politique et favorise une conception “réaliste” dure de l’électorat, qui refuse à l’électeur toute fidélité politique, si ce n’est à “ce-qui-marche “. Mais “ce qui marche” est tout sauf un critère objectif : de nos jours, c’est ce que la presse de droite considère comme ce qui “marche”. La guerre contre la drogue ne marche pas, pas plus que la construction de nouvelles prisons ; pas davantage non plus, serait-on en droit de penser, que bien des lois anti-terroristes. Mais cela n’empêche pas les ministres de les faire voter et appliquer avec la plus grande énergie. En pratique, le New Labour est bien davantage dévoué à la what-works politics que ne l’étaient les conservateurs sous Thatcher, qui ne cachaient rien de leurs convictions idéologiques » (Ross McKibbin « What Works Doesn’t Work. » London Review of Books 30.17, 2008, 20, notre traduction). ↑
-
R. Mangabeira Unger, Social Theory?, London, Verso, 2004, p. 158. ↑
-
A. Manzoni, Del romanzo storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione ed. G. Macchia et al., Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni 14, Milano, 2000. ↑
-
S. Krasner, Sovereignty : Organized Hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 66. ↑
-
R. Esposito, Categorie dell’impolitico, Bologna, Il Mulino, 1988, 1999 et Nove pensieri sulla politica, Bologna, Il Mulino, 1993. ↑
-
K. Axelos, En quête de l’impensé, Saint-Just-La-Pendue, Editions des Belles Lettres, 2012. ↑
-
Notion mise en relief dans un remarquable article de Michel Murat sur « Le style diplomatique », dans L. Badel, G. Ferragu, S. Jeannesson, R. Meltz (dir.), Ecrivains et diplomates: L’invention d’une tradition. XIXe-XXIe siècles, Paris, Armand Colin, 2012 p. 137-151. ↑
-
B. Latour Enquête sur les modes d’existence, Paris, La Découverte, 2012, p. 406-407. ↑
-
F. Gros, Le Principe Sécurité, Paris, Gallimard, 2012, p. 236. ↑
-
L. Boltanski, Enigmes et complots : Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012, p. 48 ↑
-
G. Flaubert, L’Education sentimentale, Paris, Garnier-Flammarion, 1985, p. 196. ↑
-
R. Mangabiera Unger False Necessity. Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, London,Verso, 2001, p. 34 (notre traduction). ↑
-
G. de Maupassant, Bel-Ami, Paris, Garnier-Flammarion, 1959, p. 7. ↑
-
H. de Balzac, « Études sur M. Beyle », La Revue parisienne, 25 Sept. 1840. ↑
-
Stendhal, La Chartreuse de Parme, ed. Michel Crouzet, Orléans, Paradigme, 2007, p. 112 (nous soulignons). ↑
-
M. Bardèche, Stendhal romancier, Paris, La Table ronde, 1947, réédition 1983. ↑
-
R. Lethbridge, « Zola et la fiction du pouvoir: Son Excellence Eugène Rougon », Cahiers naturalistes, n° 44, 1998, p. 294. ↑
-
G. Bafaro, « Quelques aspects du pouvoir dans Son Excellence Eugène Rougon »,Cahiers naturalistes, n° 44, 1998, p. 305. ↑
-
É. Zola, Son Excellence Eugène Rougon, dans Œuvres complètes, ed. Henri Mitterand, vol. 3, Paris, Fasquelle, Cercle du Livre Précieux, 1967, p. 289. ↑
-
Ibid., p.295 ↑
-
Ibid., p. 430. ↑
-
Ibid. p. 453. ↑
-
W. Benjamin dans Paris, Capitale du xixe siècle, trad. J. Lacoste, Paris, Éditions du Cerf, 1989, p. 48. ↑
-
R. Mangbeira Unger False Necessity, op. cit. p. 99-103. ↑

Emily Apter
Emily Apter est professeure de littérature française et comparée à l'Université de New York. Elle a été Professeure invitée à l'Ecole Normale Supérieure et a enseigné aux universités de Californie, de Los Angeles; à l'UC Davis, Cornell University ainsi qu'au Williams College. Elle a également été présidente de l'American Comparative Literature Association en 2017-2018.
