Déconstruire des châteaux en Bretagne

A propos de : Des Châteaux qui brûlent d’Arno Bertina, Paris, Verticales, 2017
L’usine « Général continentale » en Bretagne abat des poulets pour les exporter en Arabie Saoudite : un travail de massacre à la chaîne pour lequel les ouvriers ont besoin de laisser leurs cerveaux au vestiaire ; un commerce au bilan carbone désastreux ; une concurrence anti-équitable, grâce à des aides européennes qui interdisent tout espoir de rentabilité aux éleveurs du Tiers-Monde. L’usine va fermer. Pascal Montville, secrétaire d’Etat à l’industrie, sincèrement engagé dans la lutte pour la décroissance, vient l’annoncer aux ouvriers. Sans la presse, sans la police, seul avec un chauffeur et son assistante. Il n’avait pas prévu que le désarroi des ouvriers les pousserait à le retenir en otage. Et eux n’avaient pas pu prévoir qu’ils trouveraient en ce secrétaire d’Etat un allié à leur cause. Un allié ambivalent cependant, qui les encourage à penser le conflit en des termes qui sont les siens, ce qui lui donne la réputation de « gourou ».
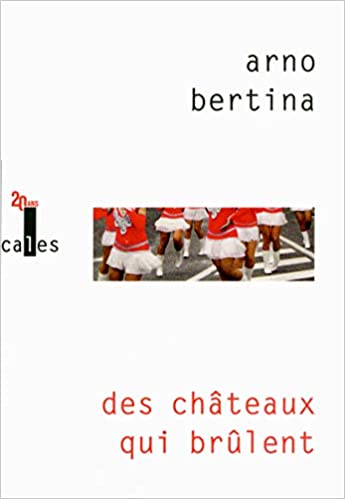
Le dernier roman d’Arno Bertina raconte une utopie de quelques jours, une révolution locale, et aussi, malgré la ferveur qui par moments paraît habiter les protagonistes, toutes les ambivalences de l’action collective.
Il s’agit d’une action qui rebat les cartes, qui crée des prises de conscience, qui déplace les lignes sociales. Chacun des courts chapitres est attribué à l’un des personnages : la prise de pouvoir est d’abord une prise de parole. Le nom et la fonction sont précisés en exergue, mais ces fonctions varient, suivant les doutes, les fluctuations intérieures, mais aussi les jeux de recomposition du politique – au niveau national et au niveau de la communauté que constitue l’usine. Les statuts changent, comme le nom même d’un personnage peut changer, quand les ouvriers tentent de débaptiser Montville de ses consonances aristocrates pour lui donner un nom patchwork des leurs.
On est souvent soufflé par la justesse du ton. Mais parfois le doute s’insinue : est-ce que tous les personnages n’ont pas, précisément, un style, un phrasé, assez similaire ? Le protagoniste dont l’auteur se sentirait le plus proche ne serait-il pas ce Montville qui est à la fois un allié et une pièce rapportée, aux préoccupations et à la réalité sociale bien différentes de celles des ouvriers ? Un agacement peut même survenir à la lecture de certaines interventions, comme celles de Céline, personnage à travers lequel l’auteur veut peut-être trop en dire. Affublée d’un corps qui empêcherait les hommes de réfléchir, ancienne syndicaliste reconvertie, Céline Aberkane est caractérisée par des conflits de loyauté un peu trop appuyés et répétitifs.
Cependant n’est-ce pas une gageure que cette ambition polyphonique ? Même si certains passages nous emportent avec moins de vigueur, le coup de force reste entier : donner à lire, dans une écriture limpide, exigeante, parfois poétique, les méandres des désirs fusionnels et des non-dits qui tissent les liens entre l’individuel et le collectif.
Tout est à inventer : chacun peut apporter sa pierre à la réflexion, être partie prenante de ce temps de suspension. Où l’on mesure les écueils – Aldo Moro assassiné par les Brigades Rouges, mais peut-être victime d’un abandon volontaire de son camp ; les dizaines de morts dans la répression de la rébellion de la prison d’Atica. Où l’on égrène les réussites glorieuses – la fondation de La Borde par un directeur d’hospice qui refusait de voir l’administratif prendre le pas sur l’humain, ou, en filigrane, la reconversion en SCOP de l’usine de Lip à Besançon dans les années 1970. Où l’on joue d’analogies : moulins de Don Quichotte qui passionnent le secrétaire d’Etat, free jazz et cuisses légères des majorettes qui se répondent dans une improbable fête de soutien aux insurgés. Certains ouvriers se sentent pousser des ailes, dans ce hors-temps de la lutte, dans cette affirmation d’existence collective qui est aussi un don singulier de soi, comme le note « une salariée », seul personnage sans nom comme si elle était la seule à se faire le porte-voix de tous, qui dit être venue là pour voir de ses collègues autre chose que le bas des habits placés dans son champ de vision sur la chaîne de l’usine. Pour donner un visage à ceux qu’elle côtoie au quotidien, mais aussi, comme un signe d’élévation ou d’émancipation, pour faire don de son visage à elle : « donner ton visage exactement comme ça, sans attendre pour voir si y a quelqu’un qu’en veut. Donner son visage comme les jours où on se protège du vent. ». L’action collective permet à chacun de relever la tête, dans ce qui prend parfois des allures de phalanstère, jusqu’à l’envolée burlesque d’une montgolfière dans laquelle sont envoyées des poules pour approvisionner les cuisines – image jouissive et surréaliste.
Toute la subtilité du roman de Bertina est de créer un souffle, un espoir fou et réaliste, tout en ne cédant en rien au manichéisme ni à l’idéalisation. Les épiphanies du collectif existent, mais la succession des interventions révèle leur fragilité profonde, rend audibles les dissonances inévitables qui sont tues. Le roman met en scène un fragile équilibre, indécidable, la révolte changeant de visage d’heure en heure, de voix en voix. Si l’ennemi ne peut plus être personnifié, puisque Montville se veut un allié, comment et sur qui, sur quoi cristalliser la colère ? Que reste-t-il de la légitimité de la lutte, quand l’usine entraîne un désastre écologique et des inégalités économiques ? Comment entraîner l’adhésion des citoyens si les médias sont en partie soumis aux choix de communication du gouvernement ? Comment résister à la violence quand CRS et GIGN sont postés tout autour du lieu de l’occupation ? Comment avoir confiance aussi, comment se fier à l’intuition, à la joie, comment se fier à autrui quand on risque si gros ?
Les remerciements d’Arno Bertina sont brefs, les derniers vont au collectif du 32 mars, c’est-à-dire à Nuit Debout et aux habitants de la Roya. Comme une affirmation, malgré les désenchantements et les risques encourus, de la beauté et de la nécessité d’une désobéissance constructive.
Clélie Millnerest MCF en Littérature Comparée à l'ICP. Ses travaux portent sur une lecture politique et éthique de la littérature contemporaine dans le domaine français, italien et germanophone. Après avoir travaillé sur le "questionnement de la présence" à travers la notion de trace (essai inspiré du doctorat à paraître), elle s'intéresse à des enjeux politiques et éthiques de récits de soi de l'extrême contemporain et anime un séminaire de recherche sur cette question à l'ICP.

