Comment la mondialisation a inversé les rapports de subordination entre la politique et l’économie
 anucha sirivisansuwan
anucha sirivisansuwan
A propos de Guillaume Vuillemey, Le Temps de la démondialisation : protéger les biens communs contre le libre-échange ( Seuil, « La république des idées » 102 pages, 2022)
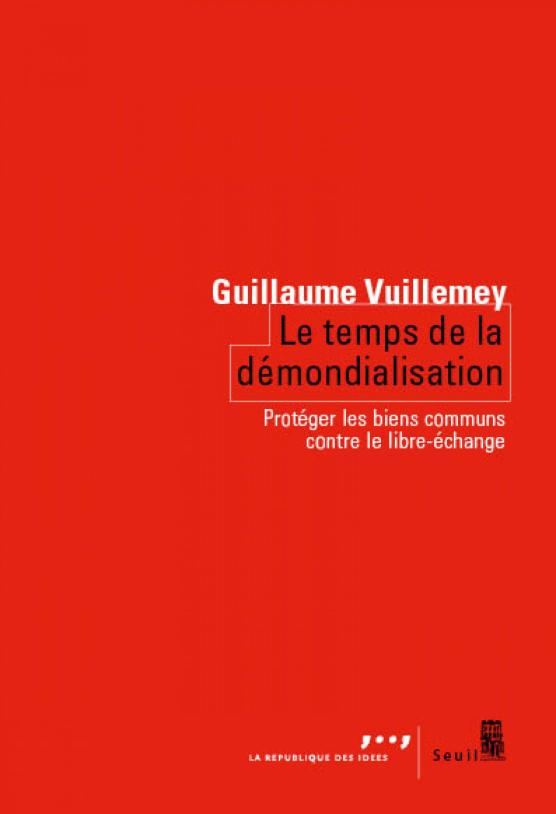
L’abbé Terrasson disait à propos de l’Ethique qu’il y a des livres qui ne seraient pas si longs s’ils n’étaient pas si courts. Il voulait dire par là que le traité de Spinoza, bien que d’une longueur somme toute modeste, était un livre qui demandait un temps considérable pour être lu, compris et assimilé. Il y a d’autres livres qui, bien que courts, en disent cependant fort long, sans pour autant exiger un effort considérable de leurs lecteurs. Celui que Guillaume Vuillemey consacre à la mondialisation et à ses méfaits est de ceux-là. En moins de cent pages il établit une vérité d’importance cruciale pour la compréhension des sociétés contemporaines : la mondialisation n’est pas seulement un changement de l’échelle sur laquelle se produisent les échanges commerciaux – intercontinentale et non plus locale ou nationale – mais une révolution dans la nature du rapport entre les activités privées et l’autorité publique, une révolution qui a littéralement inversé le rapport de subordination entre ces deux sphères. Là où, avant la mondialisation, les échanges commerciaux étaient assujettis au droit du territoire sur lequel ils s’effectuaient, et pouvaient ainsi être contraints de tenir compte des effets externes qu’ils engendraient et d’en assumer le coût, ils sont désormais déterritorialisés et ne dépendent plus que d’une forme de droit privé non étatique qui est capable de faire pression sur les droits des États pour les contraindre à leur tour à ne servir que les intérêts des acteurs privés présents dans les échanges et à cesser de satisfaire les besoins publics des populations que régissent ces États. La mondialisation ne fait donc pas qu’accroître les distances sur lesquelles les marchandises sont transportées, elle crée un espace déterritorialisé, un espace sans autorité politique, régi par les seuls accords entre les intérêts particuliers et qui est en mesure d’exercer une pression croissante sur les États eux-mêmes : ou bien ils alignent leur droit sur celui de l’espace déterritorialisé de manière à satisfaire les intérêts privés aux dépens des intérêts publics, ou bien ils s’exposent à une désertion des acteurs économiques qui iront se nicher sous l’aile bienveillante d’États plus accueillants et plus sensibles à leurs demandes. Des États qui n’en sont plus puisqu’ils ont abdiqué, contre ce plat de lentilles que leur versent les multinationales pour y domicilier leur siège social ou leurs avoirs, le privilège régalien qui confère à tout État digne de ce nom non pas le droit mais l’obligation de réguler les activités privées pour les rendre compatibles avec l’intérêt général et le bien commun des citoyens.
L’autonomisation du droit privé
Ce mouvement d’autonomisation du droit privé régissant les transactions commerciales par rapport à la juridiction publique des États met à mal, selon Guillaume Vuillemey, le fondement de la vie commune en rendant impossible le financement des institutions indispensables à la cohésion de la société, mais aussi celui de la nécessaire transition écologique. Les classes mobiles – celles qui peuvent déterritorialiser leurs activités – se désengagent ainsi de toute contribution aux biens communs que sont la justice sociale et la protection de l’environnement, laissant à ceux qui sont contraints de demeurer immobiles le soin de financer des services publics qui leur coûtent de plus en plus cher tout en se dégradant de manière croissante. Le cancer populiste qui ronge les démocraties contemporaines – réaction nationaliste contre cette forme de mobilité dont les étrangers de toute nature sont les boucs émissaires innocents – n’a pas d’autre origine. Les marges de manœuvre dont disposent les décideurs politiques pour remédier aux conséquences négatives sur le plan social et sur le plan environnemental sont en effet très réduites, et ils donnent ainsi une impression d’impuissance qui les discrédite. Ce discrédit est encore accentué par le fait que, pris entre deux feux, ces mêmes décideurs oscillent sans cesse entre des mesures destinées à protéger les immobiles contre les effets de la mondialisation et d’autres destinées au contraire à attirer les activités les plus mobiles par des dégrèvements fiscaux et autres subventions publiques, donnant ainsi une impression d’incohérence qui ne correspond que trop à la réalité. Le contexte de concurrence mondiale sur les normes et la fiscalité les conduit de toute manière inexorablement à se montrer plus sensibles aux exigences du marché qu’à celles des citoyens. La conviction peut ainsi se répandre qu’ils trahissent leur peuple au profit d’intérêts étrangers, détachés du territoire domestique. Quel meilleur terrain pour les démagogues nationalistes ?
A l’origine de cette mondialisation, il y a bien entendu le dogme des bienfaits du libre- échange : si deux partenaires entrent volontairement dans un échange, on doit supposer que celui-ci est avantageux pour chacun d’entre eux car, si ce n’était pas le cas, ils refuseraient d’y entrer. Armés de ce postulat, qui laisse de côté le fait pourtant manifeste que des échanges avantageux pour ceux qui y prennent part peuvent être désavantageux pour ceux qui y sont extérieurs, les économistes classiques ont pu poser en principe que l’ouverture des frontières à la circulation des marchandises relevait de l’évidence et que toute tentative pour encadrer les échanges volontaires au nom d’impératifs publics avait inévitablement pour conséquence de réduire la production de richesse et d’utilité.
Ouvrir les frontières, explique Guillaume Vuillemey, c’est transporter les marchandises d’un continent à l’autre et c’est, par nécessité, naviguer non plus seulement le long des côtes – espace où s’applique le droit des États riverains – mais en haute mer, dans un espace qui n’appartient en propre à aucun État et où par conséquent le droit étatique a cessé de s’appliquer. Dès lors, cette innovation aboutit bel et bien à la naissance d’un nouveau type de droit, celui qui régit les rapports entre acteurs économiques dans un espace qui n’est sous la juridiction d’aucun État, d’aucune autorité politique, d’un espace que Guillaume Vuillemey appelle « déterritorialisé » pour le distinguer des espaces territoriaux et des eaux du même nom qui sont placés sous la juridiction d’une autorité politique. Dans les espaces territorialisés, l’État tient la balance entre la volonté de favoriser les échanges et la production de richesses d’une part, le souci des biens communs de l’autre, en particulier la justice sociale et la préservation de la cohésion du corps social mais aussi, aujourd’hui, la protection d’un environnement sain. Cet équilibre est l’essence et la justification de l’autorité politique, qui requiert de l’État qu’il contraigne le développement des activités et des échanges privés pour les empêcher d’engendrer des effets nuisibles aux tiers et à la vie commune : circulation de produits dangereux ou toxiques, monopolisation de ressources vitales, concentration excessive des richesses, défauts d’information, pollutions environnementales, bref toutes les externalités qui signent ce que les économistes appellent les échecs ou les scories des marchés.
La « maritimisation » des échanges
Mais cet équilibre est détruit par ce que Guillaume Vuillemey appelle la « maritimisation » des échanges, le fait qu’ils se déroulent désormais dans un espace qui échappe à toute autorité juridictionnelle d’un État. Dans cet espace, les acteurs sont en mesure de développer un droit autonome fondé sur la seule maximisation de leurs intérêts privés, capacité protégée aujourd’hui par la navigation sous pavillon de complaisance mais aussi par l’existence de ces pseudo États qui permettent à ces acteur de domicilier leurs activités comme si elles n’étaient ancrées nulle part, comme si elles n’étaient pas en réalité insérées dans des sociétés auxquelles elles devraient rendre des comptes et qui devraient être en mesure de les contraindre à assumer le coût des externalités qu’ils engendrent. Ces dispositifs, rendus possibles par le fait que les marchandises circulent sans obstacles au travers du globe, font qu’activités industrielles et commerciales sont effectivement déterritorialisées, prenant place dans une sorte de vide social dont la haute mer est le modèle, un espace fictif où les activités n’ont plus besoin d’être contrôlés et ajustées aux impératifs de la communauté parce qu’elles sont censées se dérouler dans un vide social illustré par l’absence de l’autorité étatique.
Cette déterritorialisation des échanges et d’une part de la production permet aux multinationales de tenir la dragée haute aux États qui tenteraient de les contrôler et de les contraindre à assumer à la fois le coût des dommages qu’elles infligent aux tiers et celui des biens publics indispensables aux sociétés humaines. L’option de la mobilité qui leur est offerte par l’ouverture des frontières leur permet en effet d’exercer un chantage tel qu’elles n’ont pas besoin de délocaliser réellement leurs activités et leurs bénéfices sous des cieux fiscalement et socialement plus accueillants. La simple menace de le faire suffit pour contraindre les États où elles opèrent à modifier leur droit dans le sens le plus favorable à leurs intérêts particuliers, à diminuer les contrôles, à multiplier les exemptions, et surtout à abaisser la fiscalité dont les revenus sont pourtant seuls à pouvoir financer les biens sociaux communs : les voies de communication, les écoles, les systèmes de santé, les systèmes sociaux qui corrigent les inégalités engendrées par le marché et permettent la cohésion des groupes sociaux. Mais aussi, et plus grave encore, elle leur suffit pour freiner ou pour entraver la nécessaire conversion à une économie décarbonée indispensable pour limiter les effets du changement climatique.
L’abondance des biens privés qui a été rendue possible par le libre échange se paie donc, selon Guillaume Vuillemey d’un « sacrifice des intérêts collectifs ». Cet effet négatif du libre-échange n’est pas un effet qu’il serait possible de corriger a posteriori par des mesures qui contraindraient les acteurs économiques qui se sont dégagés de toute contribution au financement des biens communs à y prendre néanmoins part. La mondialisation empêche en effet les États d’agir pour corriger ces effets néfastes, car ceux qui le tenteraient seraient aussitôt sanctionnés par la désertion des acteurs économiques qu’ils tenteraient d’assujettir à leurs normes, que cette désertion prenne la forme d’une délocalisation physique ou d’une délocalisation de la résidence administrative qui, par des jeux d’écriture interne, permet aux entreprises multinationales de n’enregistrer leurs bénéfices que dans les pays à fiscalité réduite ou inexistante.
Aujourd’hui, seuls les États souverains qui ont maîtres de leurs frontières seraient capables de contraindre les acteurs économiques devenus insaisissables grâce aux vertus de la mondialisation à assumer le coût des externalités qu’engendrent leurs activités et à participer au financement des biens communs. La mort de la souveraineté étatique est donc aussi la mort des biens dont les sociétés démocratiques ont absolument besoin pour survivre car, composées d’individus divers qui ne partagent ni les mêmes options morales ni la même religion, elles ne peuvent tenir leur cohésion, à la différence des sociétés homogènes du passé, que de la justice sociale qu’elles devraient être capables de promouvoir et de la coïncidence au moins relative qu’elles devraient être capables de garantir entre égalité juridique et égalité sociale. Mais une société démocratique qui n’est plus en mesure de financer les biens publics indispensables à cette forme d’égalité est exposée à des lendemains difficiles et en particulier à une lame de fond nationaliste inévitable. Comment en effet ceux qui sont condamnés à l’immobilité et qui sont par conséquent condamnés à acquitter seuls le prix de biens communs et de services publics dont l’efficacité se réduit chaque jour supporteraient-ils longtemps cette situation ? Comme le savait Karl Polanyi, les sociétés marchandes qui caractérisent la modernité ne sont pérennes que si elles encastrent le marché dans des institutions sociales et politiques qui démarchandisent les biens indispensables à l’autonomie individuelle ( la santé, l’éducation, le logement, la retraite ) et contraignent l’ensemble des acteurs économiques à les financer en proportion des avantages que le marché leur apporte. Le découplage qui s’opère sous l’effet de la mondialisation – tous les avantages pour les uns, tous les désavantages pour les autres – met en péril ce mécanisme et expose les démocraties à un avenir chaotique.
Quelles options ?
Face à cette situation, les options ne sont pas légion. Compter sur la responsabilité sociale des entreprises elles-mêmes pour assumer les coûts externes qu’elles engendrent et pour prendre part au financement des biens publics est un leurre car on voit mal pourquoi les entreprises qui ont la possibilité de rejeter les coûts sur d’autres accepteraient de les assumer volontairement. On comprend ainsi que la puissance coercitive de l’État est un élément indispensable à l’instauration de l’équilibre entre activités privées et biens publics sur lequel doivent reposer les sociétés démocratiques. Une économie « dépolitisée », échappant à la tutelle de l’État, est une économie sans frein qui ravage la nature et mine la cohésion sociale.
L’idée d’une gouvernance mondiale n’est pas plus réaliste car l’existence d’un État mondial capable d’exercer la contrainte nécessaire sur les acteurs privés demeure une chimère dont la réalisation est d’autant plus éloignée que l’activité publique en faveur de biens communs suppose des choix sur les modes de vie qu’il s’agit de promouvoir et que, à la surface de la planète, il n’existe aucun accord sur les objectifs de ce genre. Si la politique est indispensable, elle ne peut en revanche qu’être nationale et l’on voit bien aujourd’hui, à l’intérieur de l’Union européenne, à quel point le désaccord sur les finalités de l’action collective peut entraver cette dernière.
Guillaume Vuillemey prône donc ce qu’il appelle un « protectionnisme social et environnemental », une reterritorialisation des échanges destinée à les faire rentrer sous la juridiction d’un ordre politique capable de les obliger à se tenir dans les limites compatibles avec le bien commun et à internaliser les coûts qu’ils occasionnent aux tiers. Les modalités concrètes en seraient d’une part une taxation des marchandises étrangères qui n’ont pas été produites dans des conditions compatibles avec les exigences de la cohésion sociale et de la protection de l’environnement, et d’autre part une taxation des mouvements de capitaux entre les filiales d’un même groupe, mécanisme grâce auquel les multinationales peuvent transférer leurs bénéfices dans des pays à fiscalité faible ou inexistante et déclarer des pertes dans ceux où la fiscalité est élevée.
Cette conclusion laisse cependant songeur car la solution préconisée est précisément exposée aux difficultés que Guillaume Vuillemey a lui-même dénoncées avec une grande clarté. L’État qui tenterait de la mettre en œuvre verrait fuir, sous une forme ou sous une autre, les acteurs économiques qu’il tenterait d’assujettir. On est donc en droit de se demander s’il existe réellement, comme le pense l’auteur, un protectionnisme raisonné qui rompt avec le rejet total de l’étranger et la forme de nationalisme exacerbé aujourd’hui associés à cette idée. L’ouvrage de Guillaume Vuillemey administre cependant une leçon capitale : l’autonomisation d’un droit privé qui tend à régler les interactions selon les seules lois de la justice corrective et avec pour seul objectif la maximisation de la richesse conduit les sociétés démocratiques dans une impasse. A l’heure où les projets de justice distributive sont largement décriés, il est indispensable de rappeler que le développement des activités privées n’est compatible avec la cohésion des sociétés démocratiques que s’il est encastré dans des institutions publiques qui veillent à la production et à la préservation des biens communs indispensables à l’autonomie de l’ensemble des individus, et avant tout de ceux qui n’ont pas la possibilité de déterritorialiser leurs activités.

Jean-Fabien Spitz
Jean-Fabien Spitz est professeur émérite de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
