D’une critique de l’idée de justice sociale : jusqu’où ira l’anti-égalitarisme contemporain ?

A propos de : Eric Nelson, The Theology of Liberalism. Political Philosophy and the Justice of God (Harvard University press, 2019, 220 pages)
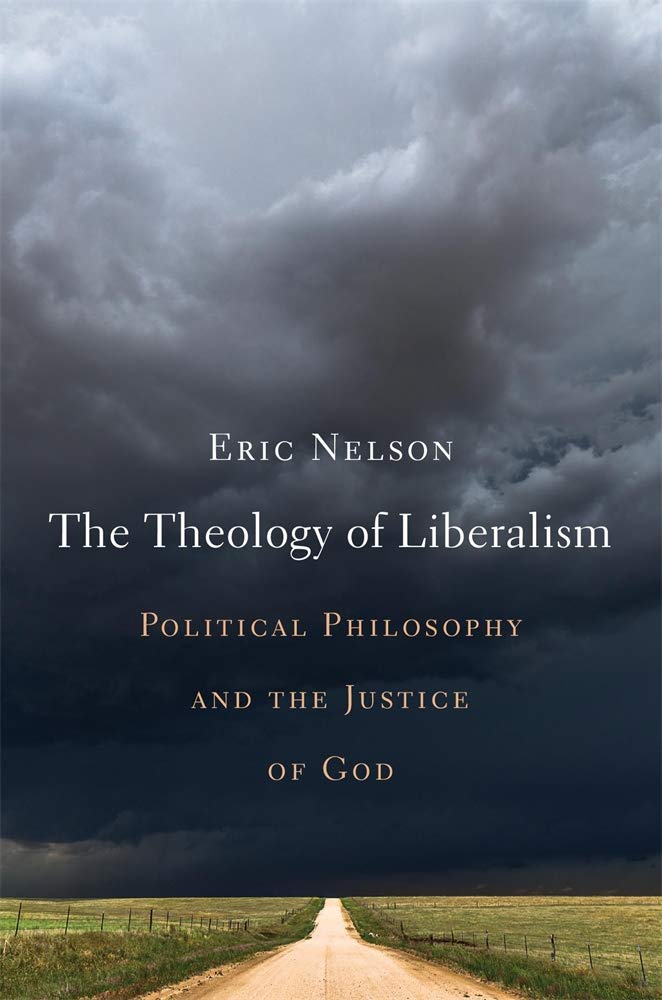
John Rawls, l’augustinien mal repenti
Hannah Arendt a dit un jour par plaisanterie que, quoique n’étant pas juive pratiquante, le judaïsme orthodoxe était la forme de judaïsme qu’elle ne pratiquait pas. Elle entendait par là que, si l’on rejette ou néglige une religion, la pensée que l’on élabore demeure marquée – comme en creux – par la forme spécifique de religion que l’on rejette. Le livre d’Eric Nelson applique ce qui n’est pas seulement une boutade à la théorie rawlsienne de la justice. Le jeune Rawls, on le sait grâce à la publication de son mémoire de fin d’études, a été un chrétien convaincu et il a même pensé un moment devenir prêtre1. Comme chrétien, il était résolument augustinien ou anti-pélagien, convaincu que l’homme ne saurait se sauver par son propre mérite et par ses propres œuvres. Et comme philosophe sa pensée demeure marquée par cet augustinisme qui est désormais la forme de christianisme qu’il rejette parce qu’elle fait de Dieu un tyran. C’est la raison pour laquelle il nie que le mérite personnel puisse constituer le fondement d’une théorie de la justice distributive, et qu’il refuse toute pertinence à l’idée que les individus puissent être ainsi les auteurs ou les responsables de leur valeur morale.
L’anti-pélagianisme augustinien du jeune Rawls était motivé, selon Nelson, par une question essentielle : si les hommes étaient libres de pécher ou de ne pas pécher, pourquoi le Christ serait-il venu s’incarner et mourir sur la croix pour racheter des péchés que les hommes étaient capables de ne pas commettre ou de racheter par leurs propres bonnes actions ? Les augustiniens pensent au contraire que l’homme est à ce point souillé par le péché qu’il est incapable de se sauver par lui-même et que cela seul peut justifier le sacrifice de la croix. Mais l’augustinisme, s’il permet de justifier le Christ et l’incarnation, pose d’autres problèmes : comment Dieu peut-il nous punir pour des péchés dont nous ne sommes pas responsables, qui ne sont pas issus de notre liberté ? Comment peut-il nous punir s’il n’est pas en notre pouvoir de ne pas pécher ? Les deux options étant aussi inacceptables l’une que l’autre, le christianisme tout entier est à rejeter. Telle est la position du Rawls de la maturité.
Mais l’option augustinienne initiale laisse bel et bien des traces profondes après sa disparition en tant que version du christianisme, et Eric Nelson pense que ces traces qui subsistent d’une couche archaïque rendent la théorie de Rawls peu attirante comme théorie du libéralisme, parce que le libéralisme, quant à lui, est essentiellement pélagien. Il repose sur l’idée que les hommes sont libres, qu’ils assument les conséquences de leurs actions et que, en ce sens, il est plausible de dire qu’ils les méritent. Du moins, le mérite doit avoir une part, et s’il est impossible de la déterminer et de la séparer de ce qui est attribuable au hasard ou à la volonté divine, mieux vaut laisser aux individus la totalité de la valeur de leurs actions que de conclure, dans l’autre sens, qu’ils n’y ont aucune part et ne peuvent en revendiquer aucune.
Il y a sans doute un libéralisme de la peur, c’est-à-dire un libéralisme qui affirme que les hommes sont des créatures déchues auxquelles on ne peut sans risque majeur confier un pouvoir sur autrui, et qui en conclut que le gouvernement doit être sévèrement limité2. Et ce libéralisme est sans doute compatible avec l’idée de péché originel en un sens non-pélagien. Mais ce libéralisme de la peur n’est certainement pas celui de Rawls, qui met l’accent non pas sur la nécessaire limitation du gouvernement, mais sur la dignité et l’autonomie des personnes, lesquelles sont censées appeler une forme de justice sociale et une répartition égalitaire des avantages de la coopération3. C’est ce libéralisme-là (que Nelson appelle libéralisme « dignitaire ») qui s’accorde mal avec une conception augustinienne du péché originel. En tout cas, ce n’est pas par hasard que tous les grands fondateurs de ce libéralisme dignitaire ont été des pélagiens convaincus4. On se prend à rêver, dit Nelson, de ce que le libéralisme de Rawls aurait pu devenir s’il avait rejeté un autre Dieu que celui des augustiniens. Dans ce cas, il aurait bien moins mis l’accent sur l’idée que le mérite des individus est inassignable et sur l’idée que la répartition des talents – ainsi que celle des ressources et des richesses qui en résulte – est injuste et doit être corrigée. Il aurait en revanche élaboré un libéralisme plus en phase avec celui des fondateurs, un libéralisme qui aurait affirmé que les individus sont responsables de ce qu’ils sont et qu’ils ont seulement le droit d’avoir des règles égales, mais que l’aspiration à construire une société qui – avec la réserve du principe de différence – cherche à égaliser les biens premiers dont ils doivent disposer pour poursuivre leurs propres finalités est en réalité une insulte à leur irréductible responsabilité.
Le défi de la théodicée
Le rejet de l’idée que nous pourrions mériter les conséquences de nos actions n’est cependant pas le seul fantôme théologique qui hante si indûment les théories contemporaines de la justice et en particulier celle de Rawls. Le second est la prétention exorbitante à résoudre la question de la théodicée en affirmant qu’un Dieu juste n’aurait pu vouloir ni la répartition inégale des talents ni ses résultats. Il s’agit bien de deux questions distinctes ; la première consiste à se demander si nos talents sont mérités, tandis que la seconde consiste à se demander si la répartition inégale de ces talents est juste, ou si un Dieu juste aurait pu la vouloir. La réponse à l’une de ces questions ne conditionne pas la réponse à l’autre. On peut en effet fort bien prétendre en même temps que la répartition des talents naturels est juste et que, néanmoins, la manière dont nous les mettons en œuvre n’est pas l’effet de notre liberté, mais qu’elle est prédestinée par Dieu et donc non-méritoire pour nous. Inversement on peut très bien affirmer que ces talents sont injustement répartis et que, néanmoins, ceux qui utilisent bien leurs atouts – qui leur sont échus de manière arbitraire – peuvent s’en attribuer le mérite parce que cela résulte d’un choix qu’ils ont fait librement.
Eric Nelson pense que les théories contemporaines de la justice sociale répondent toutes de la même manière à la seconde question en affirmant qu’une distribution inégale des qualités personnelles ne peut pas être juste, qu’il ne peut pas être juste que des individus aient ainsi accès à des vies inégalement satisfaisantes pour des raisons qui ne dépendent ni de leurs choix ni de leur contrôle. La conclusion que ces théories tirent de cette affirmation est également uniforme : la répartition inégale des talents contredit l’idée que les êtres humains possèdent la même valeur et qu’un respect égal leur est dû ; elle doit donc être corrigée sous la forme d’une compensation que les mieux pourvus sont tenus de transférer à ceux qui le sont moins.
Eric Nelson pense que cette conclusion est absurde pour deux raisons distinctes. La première est que, de toute manière, pour prétendre qu’une inégalité est injuste, il faudrait être en mesure d’établir qu’il aurait pu exister une distribution plus égalitaire de ces mêmes talents qui ne se traduirait pas par une baisse générale du bonheur. Il faudrait donc être en mesure de dire que Dieu ne peut pas être justifié d’avoir créé la répartition actuelle parce qu’il aurait pu en créer une meilleure dans laquelle tous seraient mieux pourvus. Or, selon Nelson, prétendre établir cela, c’est prétendre résoudre la question de la théodicée, c’est prétendre statuer sur l’action créatrice de Dieu et affirmer qu’il aurait pu – et donc dû – créer un monde plus juste que celui qu’il a créé. Mais comment prouver qu’il existe un monde possible (dépourvu de contradiction) dans lequel l’individu le moins bien pourvu serait cependant mieux loti que celui dont les talents sont les plus réduits dans le monde actuel, ou du moins que, dans ce monde possible, le moins favorisé ne serait pas désavantagé par rapport à ce monde-ci, alors que dans le même temps, d’autres personnes verraient leur situation améliorée ?
En d’autres termes, nous n’avons pas le droit de prétendre que ce monde est injuste sans être en mesure de démontrer la possibilité d’un monde plus juste. Mais une telle démonstration nous étant entièrement inaccessible, il est impossible de dire que tout ce qui est inégal est injuste. Il se peut en effet qu’il y ait un monde plus inégal encore mais plus juste, parce que les moins favorisés y seraient mieux lotis que dans celui qui existe aujourd’hui. Dans ce cas, remédier à l’injustice ne consisterait pas à rétablir l’égalité mais à permettre aux moins favorisés dans le monde d’aujourd’hui d’atteindre le niveau qu’ils auraient dans ce monde possible, fût-ce au prix d’un accroissement de l’inégalité.
Nous sommes donc en droit de penser, selon Eric Nelson, qu’il est possible que Dieu soit justifié d’avoir créé ce monde-ci, un monde où ceux qui sont les moins bien pourvus en qualités naturelles sont cependant mieux lotis que dans un monde où l’inégalité des talents serait corrigée au profit d’une égalité dont, au demeurant, on peine à comprendre ce qu’elle pourrait signifier. Une telle théodicée n’est pas contradictoire, bien que nous ne puissions pas l’établir. Il n’en demeure pas moins qu’ici, la possibilité est décisive car, si l’on ne peut exclure que ce monde-ci soit le meilleur possible, on ne peut plus prétendre qu’il est injuste parce qu’il contient des inégalités contingentes, et la proposition consistant à le réformer pour le rendre plus égalitaire apparaît comme dépourvue de toute justification.
La seconde raison est qu’il est évidemment faux que, si certains sont pourvus de meilleures qualités, ils le soient aux dépens de ceux qui en possèdent moins et que, à ce titre, ils doivent une compensation à ces derniers. En outre, on a peine à comprendre ce que pourrait signifier un monde dans lequel les talents seraient également répartis ? Faut-il comprendre que les individus seraient absolument interchangeables ? Il s’agit là d’une perspective peu enviable. Et si ce n’est pas le cas, comment comparer les uns aux autres des ensembles de qualités et de talents personnels pour décider s’ils sont égaux ou inégaux ? La quantification est impossible dans ce domaine parce que, littéralement, il est impossible d’assigner un prix aux divers talents dans la mesure où cela impliquerait que l’on puisse calculer ce que coûte aux uns le fait que les autres les possèdent, ce que les économistes appellent le coût d’opportunité. Un tel calcul n’a de sens que pour des choses dont il est clair que leur possession par les uns exclut leur possession par les autres, en sorte que nécessairement, le fait que certains en possèdent plus est nécessairement aux dépens de ceux qui en ont le moins. Mais une telle approche est absurde en ce qui concerne les talents : le fait que certains soient plus beaux ou plus intelligents n’a en rien pour conséquence que d’autres doivent l’être moins.
Le défi de la théodicée sous une autre facette
L’argument d’Eric Nelson pourrait aussi être présenté d’une autre manière. La question est de savoir si les atouts et les talents naturels sont répartis de manière juste, si ceux qui les détiennent de facto ont un titre à les détenir. Cette question, comme on l’a vu, est distincte de celle qui consiste à demander s’ils peuvent s’attribuer le mérite ( ou le démérite ) de la manière dont ils les mettent en œuvre. Une fois que la question de l’identité du détenteur du titre sur les talents qui sont en nous est posée, il est aisé de montrer, selon Nelson, qu’aucune autre personne que nous-même ne pourrait prétendre détenir un tel titre sans prétendre en même temps résoudre la question de la théodicée et être en mesure de prouver que nous ne détenons pas ces talents de manière juste. En outre, aucune autre personne ne peut prétendre détenir un tel titre parce que, si sa prétention était fondée, le droit qu’elle aurait sur nos talents ferait d’elle une autre personne que celle qu’elle est actuellement. Il y a donc une contradiction, pour une personne qui n’est pas nous, à revendiquer un droit sur des talents qui sont en nous et non pas en elle, car l’auteur de la revendication devrait être une autre personne que la personne qu’elle est aujourd’hui pour être en mesure de légitimer sa revendication. Il est donc avéré qu’aucune autre personne que le porteur des talents en question ne peut détenir un titre à posséder ces derniers. Dans ces conditions, même s’il est vrai que le porteur lui-même ne peut pas résoudre la question de la théodicée et prouver qu’il détient justement les talents qu’il possède, il demeure possible qu’il détienne un tel titre car Dieu pourrait – personne ne peut infirmer cette possibilité – être justifiée d’avoir réparti les talents de manière inégale comme il l’a fait, alors même qu’il est impossible qu’une quelconque autre personne en détienne un. Cette simple possibilité que nous possédions un titre sur les talents dont nous sommes porteurs doit suffire pour nous les laisser, dans la mesure où personne ne peut les revendiquer de manière légitime.
Quelle est donc la conclusion de cet argument fort involué ? Une platitude conservatrice d’ailleurs placée sous le patronage d’Edmund Burke (p.157) : puisque nous ne pouvons acquérir la certitude que nous sommes en mesure de bâtir un monde meilleur que celui-ci, la sagesse – fruit de notre impuissance à justifier Dieu comme à instruire son procès à charge – commande de laisser les choses en l’état. Même si nous pouvions donner un sens à l’idée d’une répartition égale des talents naturels – ce qui est fort douteux – cela ne suffirait pas pour affirmer que la présente répartition est injuste et qu’elle doit être compensée, car personne ne peut exclure la possibilité que le monde qui contient cette inégalité soit le meilleur possible.
Rawls et le défi de la théodicée
Nelson admet cependant que cet argument sur l’impossibilité d’une théodicée pourrait ne pas toucher la version rawlsienne de l’idée de justice distributive. La démonstration du fait qu’une répartition inégale des atouts naturels pourrait ne pas être arbitraire n’interdit toute politique redistributive que si celle-ci est fondée sur l’idée que cette répartition inégale est injuste, affirmation qui, effectivement, supposerait que l’on soit en mesure de résoudre la question de la théodicée. Elle touche donc les théories qui relèvent de ce que l’on appelle le luck egalitarianism, c’est à dire des théories qui pensent que la politique égalitariste a pour objet de corriger les inégalités dues au hasard et qui – dans cette approche – ne peuvent pas être justes.
Mais ce n’est pas du tout de cette manière que Rawls justifie son propre égalitarisme : il ne prétend pas du tout que l’inégalité doit être introduite dans la société pour compenser l’injustice des répartitions naturelles. Rawls est en effet un « institutionnaliste » qui pense que la justice distributive n’a pas pour objectif de corriger le hasard mais qu’il s’agit d’un idéal autonome consistant à construire une société comme coopération équitable entre des personnes libres et égales. L’objet n’est pas de répartir justement quelque chose – qu’il s’agisse de talents, de ressources ou de biens premiers – ou de compenser les effets du hasard, mais de bâtir des relations sociales exemptes de dominations personnelles. Le problème des inégalités de talents n’est pas qu’elles sont contingentes, mais qu’elles sont incompatibles avec une société conçue comme une coopération équitable entre personnes égales, sans domination ni dépendance. Mais parce qu’elles sont contingentes et qu’il est impossible de prouver que ceux qui sont porteurs de talents supérieurs, capables d’engendrer des avantages plus importants, les possèdent à bon droit et de manière juste, il est impossible d’invoquer un fait dépourvu de valeur normative – la répartition inégale des talents – pour faire obstacle au projet de justice distributive dont la justification ne réside pas dans l’affirmation que la répartition inégale des atouts naturels est injuste, mais dans l’idée qu’une telle justice distributive est indispensable au projet de construction d’une société comme coopération équitable entre personnes libres et égales.
Dans ce second contexte, la thèse sur le caractère arbitraire de la répartition des atouts naturels est seulement utilisée pour repousser une objection contre la forme de répartition des ressources requise par une telle coopération équitable, objection consistant à prétendre que ceux qui ont de meilleurs talents ont droit à des avantages supplémentaires pour cette raison. C’est cette objection que Rawls récuse en affirmant que les plus doués sont porteurs d’avantages contingents qui ne sauraient leur conférer le moindre droit. La raison essentielle de son refus d’accepter cette objection n’est cependant pas que la répartition des talents est arbitraire, mais qu’aucune proposition portant sur la notion de mérite moral ne peut figurer dans la culture publique d’une société légitime, qui est tenue de ne justifier ses institutions que par des propositions auxquelles tous ses membres peuvent souscrire, ce qui ne saurait être le cas d’une proposition qui – à l’évidence – repose quant à elle sur une prétention à résoudre la question métaphysique de la théodicée en disant que la répartition inégale des talents est juste .
Selon Eric Nelson, l’interprétation « institutionnaliste » de la théorie de Rawls pourrait être correcte. Il pourrait donc être exact que l’ambition de la théorie de la justice comme équité ne soit pas la neutralisation du hasard mais la construction d’une coopération équitable entre personnes libres et égales. Mais cela ne change rien au fond de la question car, quelle que soit la manière selon laquelle la proposition – des atouts contingents ne justifient pas un droit à plus d’avantages – est utilisée, il est impossible de l’utiliser sans prétendre avoir résolu la question de la théodicée. Or Rawls n’est pas plus capable que quiconque de trancher ce nœud gordien, et donc il n’est pas en mesure de repousser l’objection de ceux qui prétendent que la possession de talents naturels exceptionnels leur donne droit à un surcroît d’avantages dans la répartition des produits de la coopération sociale. Personne – pas plus Rawls que quiconque – ne peut exclure que la répartition naturelle des talents soit juste et non pas arbitraire, qu’elle soit justifiée parce que, sans elle, la situation des moins favorisés serait encore pire qu’elle ne l’est dans le monde que nous connaissons.
On mesure ici la portée de ce que Nelson appelle le « theodicy challenge » (p. 112) : montrer que nul ne peut résoudre la question de la justice divine – de ce qu’un Dieu juste aurait pu vouloir – déstabilise toute conviction selon laquelle la répartition naturelle des avantages naturels est en fait arbitraire. Or, dans la mesure où, selon Eric Nelson, cette conviction est au fondement de toute politique de redistribution, la déstabilisation qui l’atteint prive toute politique de ce genre de sa justification dernière. Ce défi contraint les égalitaristes à admettre qu’ils ne peuvent pas trancher cette question : la répartition des atouts naturels pourrait certes être arbitraire, mais elle pourrait aussi ne pas l’être. Elle pourrait donc être justifiée et telle qu’il n’existe aucun monde possible dans lequel la répartition serait plus juste, en sorte qu’un Dieu juste aurait dû le choisir.
Les faiblesses d’une critique
Mais l’argument d’Eric Nelson repose sur une équivoque manifeste. A ses yeux, il suffit que l’hypothèse de la justification de la répartition inégale des talents soit plausible pour que l’entreprise de correction de cette inégalité soit dépourvue de fondement. Mais il serait tout aussi logique de prétendre qu’il suffit que l’hypothèse de la non-justification de la répartition inégale des talents soit plausible pour établir que la proposition consistant à en conserver les effets en matière de distribution des ressources soit elle aussi dépourvue de fondement. Le raisonnement tout entier est bâti sur une prémisse manifestement fausse, à savoir que nous avons besoins de raisons déterminantes pour réformer la société dans le sens d’une plus grande égalité alors que nous n’en avons pas besoin pour conserver l’inégalité du statu quo.
Mais ce n’est pas la seule – ni la principale – faiblesse de l’argument de Nelson. En réalité, dans l’approche rawlsienne, il ne s’agit pas de prétendre que la répartition des talents ne peut pas être juste ou qu’elle ne peut pas justifier la répartition inégale des ressources. La question de la vérité ou de la fausseté d’une telle proposition métaphysique – qui implique une solution de la question de la théodicée – ne se pose pas. Il ne s’agit en effet pas de savoir si l’inégale répartition des talents naturels est juste et si elle est en mesure de justifier une répartition inégale des fruits de la coopération sociale, mais de savoir si des citoyens qui aspirent à vivre dans un contexte légitime pourraient inscrire une proposition de ce genre dans la culture publique de leur société et l’utiliser pour justifier leurs institutions politiques et sociales. Est-ce un principe de coopération susceptible d’être accepté par tous ?
La réponse à cette question, selon Rawls, est non. La première raison est qu’il s’agit d’une proposition qui, soit qu’on l’affirme soit qu’on la nie, est indécidable et contestée parce que, précisément, qu’on la pose pour l’affirmer (la répartition naturelle des talents est injuste) ou pour la nier (la répartition naturelle des talents est juste ), elle demeure une proposition métaphysique qui ne peut figurer dans la culture publique d’une société composée d’individus dont les engagements compréhensifs sont différents ; à ce titre, elle ne peut aucunement entrer dans la justification des institutions de cette société. La seconde raison est que la question pertinente est toute différente. C’est celle que se poseraient les partenaires derrière le voile d’ignorance rawlsien : voudraient-ils répartir les fruits de la coopération sociale en fonction d’un principe – à chacun selon les talents dont il est naturellement porteur – dont les conséquences pour certains d’entre eux pourraient être qu’ils se trouveraient privés de tout accès au partage de ces fruits de la coopération parce qu’ils ne seraient, une fois le voile levé, porteurs d’aucun talent dont les autres voudraient se rendre acquéreurs ? Le principe serait l’objet d’un rejet raisonnable par des partenaires qui voudraient organiser leur société comme une coopération entre personnes libres et égales et qui, par conséquent, voudraient faire obstacle à l’existence d’une situation de ce genre, laquelle est incompatible avec le statut de coopérateur libre et égal et avec l’absence de domination.
Une troisième faiblesse porte sur l’idée que la compensation de l’inégalité des talents relève de la chimère pure et simple et que, en toute hypothèse, il serait impossible de prétendre que les talents supérieurs des uns ont un coût d’opportunité pour ceux qui sont moins bien pourvus. Le principe de différence a précisément pour objet de neutraliser ces deux idées. Prenant acte du fait que les talents ne sauraient être redistribués au sens propre, il permet et il encourage même ceux qui sont porteurs de talents supérieurs à les mettre en œuvre, tout en exigeant qu’ils partagent les avantages que cette mise en œuvre leur permettra d’engendrer sur le marché avec ceux qui sont moins bien pourvus en qualités naturelles dont les autres souhaitent se rendre acquéreurs. Il ne s’agit donc pas de transférer des talents, mais de partager – selon les modalités du principe de différence – les avantages qu’ils engendrent dans le contexte de la coopération sociale. Et, à l’évidence, dans ce contexte, la possession de talents supérieurs par les uns a un coût pour les autres, puisqu’elle permettrait aux premiers, sans le mécanisme compensateur du principe de différence, d’attirer à eux une part des fruits de la coopération sociale qui ne serait pas compatible avec l’existence d’une société comme coopération équitable entre personnes libres et égales.
Enfin, Nelson prête à Rawls l’idée que s’il était possible d’établir que les atouts naturels sont l’objet d’une répartition inégale mais justifiée, il serait alors nécessaire d’admettre que cette répartition inégale devrait légitimement gouverner celle des fruits de la coopération sociale. Par là-même, Rawls semblerait admettre que la proposition de redistribuer ces fruits en fonction d’un critère égalitariste (le principe de différence ) suppose la vérité de la proposition affirmant que la répartition inégale des atouts naturels n’est pas justifiée, aveu qui l’expose inévitablement au « theodicy challenge ». Mais ce raisonnement est étranger à Rawls, qui pense au contraire qu’il convient de considérer la société comme une entreprise de coopération induisant sa propre méthode de répartition des fruits de la coopération sociale. Son approche néglige donc entièrement la question de savoir si ces ressources sont ou ne sont pas distribuées en rapport avec les atouts naturels dont chacun est porteur. Il est parfaitement possible que certains produisent plus de richesses que d’autres (les institutionnalistes ne songent au demeurant pas à récuser cette idée puisqu’ils pensent qu’il est légitime d’inciter, par des promesses de revenus plus élevés, les individus les plus productifs à mettre en œuvre leurs capacités). Mais derrière un voile d’ignorance, les partenaires ne voudraient pas – pour les raisons énoncées plus haut – envisager cela comme un critère possible de répartition des fruits de la coopération sociale.
L’institutionnalisme pur
Eric Nelson admet que si l’on pense de cette manière – ce qu’il appelle l’institutionnalisme pur – la question de la théodicée cesse d’être pertinente. Certes, on ne parvient pas à déterminer si Dieu est juste, c’est à dire si la répartition naturelle des talents est juste ou arbitraire, mais cela n’a aucune importance puisqu’on soutient la thèse que, même si elle était juste, cela ne devrait avoir aucun effet sur la répartition des ressources ? Ce que cherchent à faire les partisans d’une telle approche – et Rawls, malgré l’interprétation de Nelson, pourrait bien se compter dans leurs rangs – c’est à construire une coopération entre personnes libres et égales, et non pas à répartir les avantages de la coopération sociale en fonction de la répartition des talents et des contributions. Dans cette hypothèse, même si nous savions de manière certaine que la répartition des atouts naturels n’est ni contingente ni arbitraire, cela ne saurait invalider une telle approche. L’institutionnaliste pur ne pense donc pas que l’égalitarisme est justifié parce que la répartition des atouts est arbitraire. Il pense au contraire que cette question est non-pertinente et que, même si cette répartition n’était pas arbitraire – hypothèse qui n’est cependant pas plus vérifiable que son contraire – il faudrait que l’Etat répartisse les fruits de la coopération en fonction du critère purement politique consistant à créer une société comme coopération entre personnes libres et égales. Que nous ne puissions pas savoir avec certitude si la répartition des atouts naturels est juste ou non n’affecte donc pas l’institutionnaliste pur parce que, pour lui, cette question est sans aucun rapport avec celle de la répartition des résultats de la coopération sociale.
Eric Nelson affirme que cette forme d’égalitarisme « purement institutionnaliste » ne résiste pas à l’analyse. Selon lui, il n’est pas possible de prétendre que, parce que chacun de nous a contribué quelque chose (tout en admettant que les contributions ne sont pas identiques) chacun doit recevoir la même part du produit de l’entreprise coopérative (ou du moins la part qui lui est attribuée par le principe de différence , qui admet que les inégalités sont justes si elles pour effet de maximiser la position des moins favorisés)(p.128). Cela conduit en effet, selon Eric Nelson, à faire de l’Etat la seule source des droits de propriété et à affirmer qu’il n’existe aucun fait pré-institutionnel qui soit capable de donner aux citoyens un droit de revendiquer quoi que ce soit dans le partage des fruits de la coopération sociale. L’Etat peut donc répartir les avantages à son gré, en fonction du seul impératif de création de cette forme de coopération entre personnes libres et égale. Dans une conception de genre, la manière dont les atouts naturels sont distribués entre les individus est simplement non-pertinente, et l’idée de revendications individuelles légitimes sur telle ou telle part des produits de la coopération sociale est disqualifiée au profit de ce que Nelson considère comme un pur institutionnalisme.
Il admet toutefois qu’un tel institutionnalisme – dont il pense que ce n’est pas celui de Rawls – postule que la collectivité des citoyens, derrière le voile, aurait un droit de se prononcer sur les modalités du partage des fruits de la coopération sociale. Mais au lieu d’isoler cette question et de l’interroger sur ses propres mérites ( les partenaires derrière le voile auraient-ils le droit de postuler que l’ensemble des résultats de la coopération sociale leur appartient et qu’ils ont le droit d’en disposer conformément à leur sens partagé de la justice ? ), il la confond avec l’idée que l’Etat possèderait un droit de répartition des résultats de la coopération parce que, sans sa présence, aucune richesse ne pourrait être produite par quiconque. Il s’appuie ensuite sur cette idée pour affirmer qu’un tel fondement serait insuffisant pour permettre à l’Etat de disposer de l’ensemble des résultats de la coopération car, si son rôle est indispensable, celui des individus ne l’est pas moins et cela donne à ces derniers un droit pré-institutionnel à une part de ces résultats en fonction de leur contribution5. Une telle position conduit cependant à faire rentrer par la fenêtre une solution de la question de la théodicée que l’on avait cru expulser par la porte.
Le défi de la théodicée atteint-il la théorie de Rawls ?
Eric Nelson conclut que si la position institutionnaliste est impure – ce qu’elle est dans le cas de Rawls selon lui – elle est exposée au défi de la théodicée. En admettant que, si la répartition des atouts naturels était non arbitraire, elle devrait conditionner la répartition des avantages sociaux, Rawls aurait subordonné la validité de sa thèse égalitariste et redistributionniste à la vérité de la proposition selon laquelle la répartition des atouts naturels est arbitraire. Or le défi de la théodicée montre qu’aucune proposition de ce genre ne peut être validée. Quant à l’institutionnalisme pur – celui qui nie toute pertinence à la question de savoir si la répartition des atouts naturels est juste ou non, et qui affirme que le critère de répartition des fruits de la coopération sociale en est entièrement indépendant – il serait contraint d’admettre en dernière instance un droit pré-institutionnel des individus à revendiquer une part des résultats de cette coopération. Si l’Etat prétend en effet pouvoir décider de la répartition en raison du rôle irremplaçable qu’il joue dans la production des richesses sociales, il ne peut pas refuser ce même droit aux individus dont nul ne peut nier qu’ils jouent eux aussi un rôle irremplaçable dans cette production.
Mais Eric Nelson se trompe sur les deux points. Il se trompe tout d’abord en affirmant que Rawls concède que, si la répartition des atouts naturels était juste, elle devrait conditionner la répartition des avantages issus de la coopération sociale. La cohérence de sa position égalitariste n’est pas tributaire de la fausseté de la thèse selon laquelle les atouts naturels sont justement répartis. Rawls est donc ce que Nelson appelle un institutionnaliste pur, et cela rend la seconde erreur qu’il commet – sur la nature de cet institutionnalisme pur – d’autant plus importante. Une telle forme d’institutionnalisme ne consiste pas à trancher la question de la justice de la répartition des atouts naturels, ni de manière explicite ni – comme le fait Eric Nelson – de manière implicite en affirmant que les individus ne peuvent pas ne pas avoir un droit pré-institutionnel sur les avantages que leur activité a générés. Elle consiste à demander selon quelle règle des individus qui aspirent à vivre collectivement sans domination voudraient organiser leurs institutions politiques et sociales, et à montrer qu’ils ne pourraient pas adopter l’idée de coopération entre personnes libres et égales sans récuser un principe – à chacun selon ses talents – qui en impliquerait l’impossibilité.
La question de la propriété privée.
Les héritiers de Proudhon sont aujourd’hui plus nombreux qu’on ne croit6. Ils affirment que la terre ayant été donnée en commun à tous les hommes, l’appropriation privée consiste à frustrer l’immense majorité des hommes de ce qui leur appartient de droit et qu’elle est à ce titre illégitime. Au demeurant, les théories de la privatisation légitime – par l’occupation, ou par le travail – supposant toutes une situation de surabondance de la terre qui ne peut pas demeurer indéfiniment, il s’ensuit que toutes les propriétés actuellement établies sont des usurpations et reposent sur la violation du droit. Comme Robert Nozick lui-même l’a admis, cela implique que les théories égalitaristes et redistributionnistes de la justice comme celle de Rawls pourraient être valides, c’est à dire qu’elles pourraient être le remède adéquat permettant de rectifier les usurpations passées.7 Comme nous ne disposons d’aucune théorie complète de ce que devrait être une telle rectification, on ne peut en effet exclure cette hypothèse.
Le dernier chapitre de l’ouvrage d’Eric Nelson tente précisément de tordre le cou à une telle possibilité en montrant que, même dans l’hypothèse où le monde serait donné en commun à tous les hommes et où l’appropriation privée aurait nécessairement le caractère d’une usurpation – puisque la condition de surabondance ne pourrait pas être remplie de manière stable – il ne s’ensuivrait cependant pas que l’ensemble des propriétés privées d’aujourd’hui soient entachées d’illégitimité ni, par conséquent, que la théorie rawlsienne de la justice distributive puisse être une théorie correcte de la manière dont cette illégitimité pourrait être rectifiée.
Il est en effet possible, selon Nelson, que certains éléments intervenus entre le moment de l’usurpation initiale et aujourd’hui aient été en mesure de produire le droit qui faisait défaut à l’origine. La conséquence serait que le monde dans lequel nous vivons n’est pas nécessairement injuste et que, en toute hypothèse, il est impossible de démontrer la réalité d’une telle injustice, parce qu’il faudrait pour cela disposer d’une théorie complète de la manière dont les torts passés pourraient être rectifiés. Or les théories contemporaines de la justice distributive prétendent à tort que cette injustice est établie, et c’est sur ce fondement qu’elles prétendent asseoir la validité de leurs propositions redistributrices comme modalités de rectification des injustices passées. Pour elles, l’injustice passée est logiquement établie et, comme aucun fait intermédiaire ne saurait légitimer cette injustice et la transformer en droit, la rectification redistributrice est légitime.
La position d’Eric Nelson consiste au contraire à dire que, même si l’on concède l’injustice initiale, il est faux qu’aucun fait intermédiaire ne soit en mesure de la transformer en droit et que, par conséquent, la validité des ambitions redistributrices ne peut être établie car il se pourrait qu’elles visent à détruire un état de choses fondé en légitimité et donc juste. Comment son argument est-il construit ?
La prémisse essentielle consiste à montrer que, au cours de l’histoire, des acheteurs de bonne foi ont acquis des biens fonciers et des ressources naturelles avec des fonds qui leur appartenaient sans aucune contestation possible et qui étaient le produit de leur travail. Les priver aujourd’hui de ce titre au nom de l’idée que les biens qu’ils ont acquis sont non appropriables parce que leur privatisation cause nécessairement du tort à ceux qui sont hors d’état de réaliser des appropriations semblables reviendrait donc à les frustrer indument de leur travail, à leur infliger une sanction sans faute. Au demeurant, aucun autre personne, aujourd’hui, ne peut faire valoir un titre plus valable que celui de l’acquéreur de bonne foi, parce que les exclus de la propriété ne peuvent revendiquer un droit et prétendre qu’ils ont été frustrés qu’en établissant de manière certaine non seulement que ce monde est injuste mais qu’ils sont quant à eux les victimes de cette injustice. Or, le défi de la théodicée nous l’a appris, cela n’est pas possible, car il est au moins plausible que ce monde soit juste et que les exclus de la propriété n’aient subi aucun tort. L’un des arguments de Nelson consiste en outre à dire qu’ils n’étaient pas nés au moment où les usurpations dont ils accusent les appropriateurs passés ont eu lieu. Comment leurs droits auraient-ils pu être violés dans ces conditions. Un autre argument consiste à dire que les exclus de la propriété ne peuvent pas se plaindre parce que, dans un monde où les usurpations qu’ils incriminent n’auraient pas eu lieu et où, par conséquent, la nature n’aurait pas fait l’objet d’une appropriation privée, la faiblesse des ressources disponibles aurait interdit leur naissance. Comment leurs droits peuvent-ils être violés par une institution – la propriété privée – sans laquelle ils n’existeraient tout simplement pas ? Personne ne peut donc opposer au titre du détenteur actuel un titre mieux fondé, pas même les membres des générations qui sont arrivées dans le monde après que l’ensemble des ressources naturelles ont été privatisées.
L’argument est cependant affecté d’une faiblesse insigne, et Eric Nelson en a conscience.
Suffit-il que les acheteurs aient agi de bonne foi pour être excusés d’avoir approprié indûment une ressource qui devait appartenir à tous et pour avoir en conséquence violé les droits des tiers ? L’acheteur d’un bien volé annule-t-il le droit du premier propriétaire parce que, en toute bonne foi, il pensait que l’objet acquis appartenait bien au vendeur et que celui-ci avait le droit d’en disposer ? Nelson pense que, dans ce cas, les droits du premier propriétaire à récupérer son bien n’annuleraient pas totalement ceux de l’acheteur de bonne foi qui, d’une manière ou d’autre autre, pourrait faire valoir un titre sur au moins une partie de la valeur de l’objet considéré. Mais son argument présente une difficulté. L’acheteur d’un bien volé a suivi les règles en vigueur d’un double point de vue : d’une part, il a respecté les règles de l’échange et, d’autre part, il a acquis un à propos duquel il ne pouvait exister aucun doute quant à la possibilité qu’il soit acheté, vendu et privativement approprié, parce qu’il s’agissait d’une marchandise susceptible d’être multipliée par le travail en fonction de l’offre et de la demande. Les acheteurs de bonne foi qui ont acquis des ressources naturelles ne sont pas dans la même situation. Certes, ils ont respecté les règles formelles de l’échange, mais ils ont acquis des biens qui, parce qu’ils ne sont pas multipliables par le travail et parce qu’il est nécessaire d’y avoir accès pour conserver notre existence de manière indépendante, ne sont pas des marchandises et ne devraient donc jamais être appropriés privativement de manière inconditionnelle. Les acquisitions qu’ils ont réalisées étaient légales mais, de l’aveu même d’Eric Nelson, il y a un doute profond sur leur légitimité, sur la question de savoir si – en principe – les ressources naturelles sont susceptibles d’être appropriées privativement. Le fait d’avoir suivi une règle illégitime – d’avoir acquis en vertu d’une règle légale des biens qui sont en réalité non appropriables – peut-elle donner un titre à l’acheteur de bonne foi ? Le fait d’avoir de bonne foi acquis des esclaves – dans une société qui autoriserait cette institution particulière – confère-t-il un titre solide à l’acheteur ?
La réponse d’Eric Nelson est désarmante. Le titre acquis est légitime, selon lui, à la condition que l’acheteur ait eu l’authentique conviction que les biens dont il se rendait acquéreur étaient non seulement légalement mais aussi légitimement privatisables et commercialisables. Tout acheteur de bonne foi qui a acquis des ressources naturelles avec la profonde conviction qu’une telle acquisition n’était pas injuste et ne violait pas les droits des tiers a donc acquis un titre valable. On ne peut en effet refuser à personne le droit de penser que la terre est en fait appropriable et que sa privatisation ne donne lieu à aucune injustice parce que, dans le monde où existe la propriété privée, la condition des non-propriétaires est plus enviable qu’elle ne le serait dans un monde sans propriété privée. Pour refuser à quiconque le droit de penser ainsi, il faudrait prouver que le monde où existe la propriété privée des ressources naturelles est injuste, que les droits des non-propriétaires y sont violés, et que ces ressources communes doivent sinon demeurer communes du moins n’être appropriées qu’en échange d’une redevance permettant de financer des transferts sociaux au bénéfice des non propriétaires. Or – le défi de la théodicée frappe à nouveau –aucune preuve de ce genre ne peut être apportée.
L’ignorance de la loi existante ne peut donc excuser mais la conviction que la loi existante est morale en est capable parce que – c’est bien l’argument d’Eric Nelson – personne ne peut sans injustice être accusé de se tromper sur une loi morale dont tout le monde convient qu’elle ne peut être intégralement connue et qu’elle est sujette à contestation. Acheter des esclaves aujourd’hui – dans une contrée possible où cet achat serait permis par la loi existante – serait inexcusable parce que la partie de la loi morale qui interdit l’appropriation d’êtres humains est claire et devrait être connue de tous. De même la conviction de l’officier SS qui pense que tuer des juifs est un service rendu à l’humanité ne l’excuse pas parce que cette partie de la loi morale qui commande de ne pas tuer son prochain est claire et connue depuis des millénaires. Mais, selon Eric Nelson, il est impossible aujourd’hui de « savoir » de cette manière que les ressources naturelles, ne pouvant être produites et multipliées, doivent demeurer communes et ne doivent pas être privativement soustraites à leur usage commun. Donc celui qui se les approprie en pensant de bonne foi qu’il le fait en vertu d’un droit ne commet pas de faute et son titre n’est pas détruit par l’illégitimité seulement possible de l’acquisition qu’il réalise.
Les libéraux égalitaristes qui, comme Rawls, sont persuadés que la séparation des personnes doit être prise au sérieux doivent donc comprendre que toute tentative de rectification ou de redistribution porterait atteinte aux droits des acheteurs de bonne foi. Ils ne pourraient se défendre de cette accusation que s’ils étaient en mesure d’établir de manière certaine – au même degré que dans le cas de l’esclavage ou le meurtre – que l’appropriation privée de la terre est injuste. Mais le défi de la théodicée les en empêche. Et s’ils prennent leur propre concept de justice au sérieux, ils devraient conclure que ce qu’exige cette notion dans un monde qui résulte d’actions accomplies de bonne foi pourrait être très différent de ce qu’elle exigerait dans un monde qui commence et dans lequel il n’y a pas de résultats cumulés d’actions de bonne foi. Si nous étions dans un monde vierge de toute appropriation et si, dans le même temps, notre connaissance de la morale était parvenue au point où elle est aujourd’hui – avec la conscience de la finitude de la terre – il serait légitime d’exiger des appropriateurs potentiels qu’ils réfléchissent à la question de la légitimité de l’appropriation et l’on pourrait soupçonner leur bonne foi s’ils s’affranchissaient de tout doute et procédaient à la privatisation de la nature. Mais, dans un monde entièrement privatisé en conséquence d’actions accomplies de bonne foi, on ne peut rien exiger de tel.
Les partisans d’une justice redistributive à la Rawls ne peuvent donc prétendre que leur théorie est une version possible de ce qui est requis pour rectifier les usurpations passées car ils sont non seulement hors d’état d’établir qu’il s’agissait bien d’usurpations, mais ils sont surtout incapables d’établir que, aujourd’hui, les exclus de la propriété ont un titre à faire valoir sur les biens des mieux pourvus qui serait plus puissant que celui de ces derniers.
Sommes-nous convaincus ?
Ce raisonnement peut-il emporter la conviction ? Il serait tout d’abord honnête, de la part d’Eric Nelson, d’admettre qu’il n’est pas original car il figure déjà, presque mot, pour mot dans la palinodie de Spencer qui, après avoir défendu l’inappropriabilité de la terre dans le Social Statics de 1850, défend trente-deux ans plus tard, les droits de l’acheteur de bonne foi en invoquant cette même idée d’une ignorance invincible – au moment de l’acquisition – du principe qui rend une telle appropriabilité moralement suspecte8. Mais l’essentiel est ailleurs. Indépendamment de toute considération sur des usurpations passées, l’appropriation privée de la terre et des ressources naturelles confère à ceux qui la réalisent un pouvoir sur les exclus de la propriété parce qu’ils détiennent ce à quoi ces derniers ont absolument besoin d’avoir accès et parce qu’ils peuvent en conséquence imposer leurs conditions et exiger une rente qui leur permet de s’approprier une part du travail des tiers. Comme l’a montré Henry George dans sa réfutation de la palinodie spencérienne, la question ne porte ni sur ce que les appropriateurs ont fait dans le passé ni sur les moyens de rectifier des injustices antérieures mais sur un système dont l’iniquité présente est avérée9. Aucun argument tentant d’établir qu’il demeure possible que la propriété privée soit juste parce que les exclus de la propriété en sont, y compris aujourd’hui, les bénéficiaires, ne peut résister à l’intuition rawlsienne : derrière le voile d’ignorance, les partenaires choisiraient-ils un système qui mettrait l’existence de certains d’entre eux à la merci et sous la domination de la volonté des autres ? La réponse est non, et ce non n’est pas une réponse à la question de savoir si le monde est juste ou pas, mais une réponse à la question de savoir comment nous voulons définir l’équité dans nos relations mutuelles et selon quelle règle de justice nous voulons organiser nos institutions sociales.
Conclusion
Le livre d’Eric Nelson participe d’une vaste entreprise consistant, aujourd’hui, à jeter le doute sur des politiques et des convictions égalitaristes et redistributrices qui, pour les promoteurs de cette entreprise, ne sont pas en mesure d’étayer de manière solide leur affirmation selon laquelle la justice exige une répartition égalitaire des ressources10. Nelson se défend cependant d’être un anti-égalitariste car il existe, dit-il, d’autres raisons de vouloir une répartition plus égalitaire de la richesse sociale. En réfléchissant aux questions de démocratie et de représentation, on est en effet en droit de conclure qu’une autorité politique qui prend au sérieux l’autonomie et la dignité des personnes peut légitimement entreprendre de modérer l’inégalité grâce à la redistribution. On peut en effet invoquer à l’appui de cette conclusion des raisons non seulement pragmatiques (une inégalité excessive est incompatible avec la stabilité), mais aussi des raisons morales ( nous avons une obligation – imparfaite, car les pauvres n’ont aucun droit – de soulager la souffrance des autres lorsque nous pouvons le faire sans coût excessif pour nous-mêmes). Mais la grande erreur est de supposer qu’une distribution égale des ressources est rendue nécessaire par la justice distributive, soit parce que des avantages non-gagnés ou non-choisis sont injustes, soit parce que le caractère coopératif de l’entreprise sociale exige une division égale du produit social, soit encore parce que la terre a été donnée en commun à l’ensemble des hommes. En exhumant le débat sur la théodicée, affirme Eric Nelson, on comprend que le principe de la justice ne permet pas de trancher la question de la distribution dans un sens ou dans l’autre et que, dans l’incertitude, il vaut mieux laisser les choses où elles sont que de les redistribuer car la première attitude, à la différence de la seconde, ne risque pas de violer les droits de quiconque.
Mais la théorie de la justice distributive de Rawls ne suppose ni que des avantages non- gagnés ou non-choisis sont nécessairement illégitimes, ni que le caractère coopératif de l’entreprise sociale exige une division égale du produit social. Le premier de ces postulats supposerait en effet une prétention exorbitante à résoudre la question de la théodicée et Rawls ne s’y risque pas. Le second est encore plus étranger à la théorie rawlsienne car, nulle part, celle-ci n’affirme que la répartition égale des avantages est requise par le fait que nul ne pourrait produire quelque richesse que ce soit sans le concours de la société et de ses institutions. Rappelons-le, il s’agit d’une théorie politique et non pas métaphysique : elle ne se prononce pas sur la justice intrinsèque du monde ou de Dieu mais elle tente seulement de dégager la règle d’après laquelle voudraient vivre des individus qui auraient décidé de se considérer comme investis d’une valeur morale égale.
==================
NOTES
- John Rawls. A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith. Thomas Nagel, Editor. Harvard University Press 2009
[↩]
- Judith Shklar, ‘The liberalism of fear’ in Nancy L. Rosenblum ( ed.) Liberalism and the moral life (Harvard University Press, 1989[↩]
- Cf. M. Nussbaum, The cosmopolitan tradition : A noble but flawed ideal ( Harvard University Press, 2019) [↩]
- Nozick remarque cette incohérence quand il souligne que « the unexalted vision of human beings presupposed by Rawls’s theory can uneasily made to fit together with the view of human dignity it is designed to lead to and to embody » (cité in Nelson, p. 71) [↩]
- Nelson, op. cit., p. 132 : « Just because you can’t produce wealth without the state’s contribution, it does not follow that the state owns all the wealth that you have produced ».[↩]
- Cf. par exemple K. Widerquist, Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No (Exploring the Basic Income Guarantee) Ashgate publishers, London, 2013 [↩]
- Nozick, Anarchy, State and Utopia ( Blackwell, A974) p. 231 : « These issues are very complex and are best left to a full treatment of the principle of rectification. In the absence of such a treatment applied to a particular society, one cannot use the analysis and theory presented here to condemn any particular scheme of transfer payments, unless it is clear that no considerations of rectification of injustice could apply to justify it ». Or, il est possible que des considérations portant sur la nécessaire rectifications des injustices passées puissent justifier la théorie de Rawls.[↩]
- H. Spencer, Justice, being the fourth part of the Elements of Ethics ( Londres 1882), chapitres 11 et 12.[↩]
- H. George, A perplexed Philosopher, being an examination of Mr. Spencer various utterances on the land question, with some incidental references to his synthetic philosophy ( Londres 1893).[↩]
- Une entreprise à laquelle, comme nous l’avons vu, les libertariens honnêtes comme Nozick ne participent en rien parce que, étant convaincus de l’impossibilité de prouver que la structure actuelle des appropriations résulte d’un processus dans lequel les règles de l’acquisition légitime n’auraient jamais été violées, ils sont de même convaincus qu’il est impossible de prouver que les théories de la justice distributive ne sont pas la solution adéquate pour rectifier des usurpations dont on ne peut exclure qu’elles aient eu lieu.[↩]

Jean-Fabien Spitz
Jean-Fabien Spitz est professeur émérite de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
