L’intellectuel au pilori

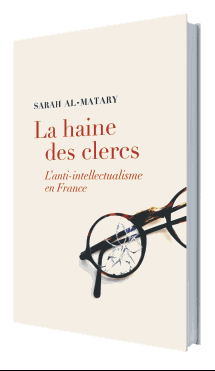
À propos de : Sarah Al-Matary, La Haine des clercs. L’anti-intellectualisme en France, Paris, Le Seuil, 2019.
Date de parution 14/03/2019
24.00 € TTC
400 pages
EAN 9782021048094
En intitulant La Haine des clercs le livre qu’elle a publié l’an passé aux éditions du Seuil, Sarah Al-Matary, qui enseigne la littérature à l’université Lumières-Lyon 2, et participe à La Vie des Idées comme rédactrice en chef, avait sans doute à l’esprit la célèbre Trahison des clercs de Julien Benda. Mais si Benda, dans son essai, reprochait aux hommes de lettres d’avoir apostasié l’idéal de l’intellectuel tel qu’il avait cristallisé au cours de l’affaire Dreyfus, les écrivains, penseurs, mais aussi militants, politiques, gouvernants, qu’étudie ou qu’évoque Sarah Al-Matary reprochent aux intellectuels… d’en être. Pour Sarah Al-Matary, si la France est un pays qui aime à se représenter, et qu’on aime à représenter, comme celui des intellectuels, c’est aussi bien le pays d’une longue tradition de critique, voire de rejet, de ceux-ci et de l’intellectualisme. C’est l’expression de cette critique, ou de ce rejet – dont de nombreux intellectuels furent et sont partie prenante – qu’elle étudie dans son livre.
Le discours qui les porte apparaît après la Révolution française, en pleine révolution industrielle. Selon Sarah Al-Matary, il est une résultante de l’émergence, à côté de celle des travailleurs de la main, d’une classe de travailleurs de l’esprit. Elle nous fait assister à sa naissance, au mitan du XIXe siècle, sous les plumes de Perdiguier et de Proudhon, qui questionnent la possibilité d’une alliance entre ces deux classes, à la gauche du spectre politique. Elle nous en fait suivre le développement, à la fin de ce siècle et tout au long du suivant, jusqu’au début du siècle en cours. Il a ses moments, comme l’affaire Dreyfus, la période de l’occupation et de la collaboration, la guerre d’Algérie ; il a ses figures : Vallès, Barrès, Péguy, Nizan, Drieu, Poujade, Michel Onfray. Il est l’apanage de groupes aussi différents que les maurrassiens ou les maoïstes. C’est un discours que l’on tient aussi bien à droite qu’à gauche, chez les conservateurs comme chez les révolutionnaires, aux marges de la vie intellectuelle et politique comme au sommet de l’État. Il peut être vindicatif, alarmiste, prophétique – parfois promotionnel. C’est un discours contre – mais où l’on entend l’aspiration à une autre société, le désir d’un idéal. Ce n’est pas fortuitement que reviennent, sous la plume de Sarah Al-Matary, les termes de médiation (refusée par les uns) et d’incarnation (voulue par les autres).
Mais que désigne, précisément, la dénomination d’intellectuel dans le discours qu’étudie Sarah Al-Matary ? Des figures qui viennent tout de suite à l’esprit : écrivains, philosophes, universitaires, savants ; et d’autres qu’il évoque sans doute moins spontanément : enseignants du secondaire, technocrates. Tous sont des cibles de la parole anti-intellectualiste, qui peut également s’en prendre, à l’occasion, aux « instruits » du peuple, mais dont l’instruction inaboutie se révélerait néfaste pour eux et pour la société ; ou aux « instruits » tout court qui, occupant une position inférieure à leur instruction, seraient animés d’un dangereux ressentiment. À l’aube de l’anti-intellectualisme, Proudhon ne retient pas ses coups à l’encontre des grandes figures du romantisme, dont « l’ethos prophétique reflète [le] paternalisme : or […] pareil surplomb est incompatible avec la démocratie, où l’intellectuel et l’artiste doivent se laisser éclairer par le peuple » (La haine des clercs, p. 31-32). Il s’en prend à Lamartine, chef du gouvernement provisoire issu de la révolution de février 1848, auquel il reproche d’être plus verbeux qu’efficient. Ce procès en rhétorique et belles paroles n’en finira plus d’être intentée aux intellectuels par leurs contempteurs. À la fin du XIXe siècle, les professeurs rejoignent le banc des accusés de l’esprit, au moment de l’affaire Dreyfus bien sûr, mais avant déjà, par exemple dans le roman de Paul Bourget Le Disciple, où ils apparaissent comme des agents de dissolution morale. Au début du suivant, Péguy vilipende les universitaires qui, à l’instar de Gustave Lanson, soutiennent une réforme de l’enseignement secondaire où les humanités gréco-latines ne seraient plus l’alpha et l’oméga du cursus lycéen, et se font ainsi les fourriers d’une modernité délétère. On atteint une forme d’acmé dans la critique des professeurs lors de la guerre d’Algérie, où certaines des flèches décochées contre les Mandouze ou les Marrou viennent du sommet de l’État. C’est également la période où l’anti-intellectualisme se découvre une nouvelle cible appelée à un bel avenir : le technocrate, ou l’expert. Avec le mouvement poujadiste, expression « d’une petite bourgeoisie ébranlée par les mutations d’après-guerre », « le rejet des intellectuels prend une coloration antitechnocratique », accentuée « par la création de l’École nationale d’administration (ENA) qui prépare des intellectuels généralistes à occuper les plus hautes fonctions » (p. 244) – et, plus tard, par « la fonctionnarisation du politique » (p. 257) opérée par le régime gaulliste.
Le discours contre les intellectuels ne vise pas que des groupes ou des catégories. Avec constance, il aime à dire du mal, tout le mal possible, d’une institution : l’École – et la fustiger, c’est aussi bien fustiger l’État républicain, vu la place que l’École y occupe. Les professeurs, on l’a vu, peuvent être accusés de porter atteinte à l’ordre social ; ils peuvent également l’être de contribuer à la consolidation d’un ordre social injuste. Ainsi, la critique maurrassienne de l’enseignement primaire laïcisé lui reproche de défaire la moralité populaire par excès d’abstraction : « Le peuple s’égarerait à mesure que les connaissances scientifiques prendraient le pas sur l’édification, que la lecture, l’écriture et le calcul remplaceraient l’expérience transmise, à la veillée, sous forme de contes et de légendes » (p. 144). Maurras craint la fabrication par l’École d’un homme qui, coupé des sources de la morale, sera bientôt mûr pour la révolution. À l’inverse, la critique anarchiste voit dans « le maître », « sciemment inféodé à l’État », le producteur en série de « suppôts du régime » (p. 134). La mise en cause de l’École a sa face constructive. Les anarchistes, par exemple, s’efforcent de concevoir et de mettre en œuvre, via leurs publications, des modalités différentes d’instruction, des pédagogies alternatives. Au sein de la CGT d’avant la Première Guerre mondiale, les rédacteurs du quotidien La Bataille syndicaliste, « contre l’Instruction publique, usine à bons petits soldats, voire à fusilleurs d’ouvriers », estiment qu’« il faudrait mettre en place, à l’issue du premier degré, une éducation mi-générale, mi-professionnelle, pensée pour les ouvriers » (p. 141). À l’extrême de la critique, on trouve le programme de démantèlement de l’École qu’un Drieu la Rochelle, traumatisé de « l’élitisme scolaire » (p. 220), expose dans son Journal comme une étape de la régénération fasciste de la France : « Supprimer Normale et Agrégation. Réduire l’enseignement secondaire, supprimer toutes les facilités d’examen, de bourse, de compensation. Transporter les grandes écoles et la Sorbonne en province. Supprimer plusieurs universités. Briser l’esprit de Polytechnique et de l’Inspection. […] Créer un ordre nouveau des instituteurs. Développer l’enseignement technique » (p. 229).
L’un des motifs récurrents du discours contre les intellectuels consiste à dénier leur autorité. Plus précisément, il consiste à récuser leur prétention à diriger, à gouverner, en raison de leur intelligence et de leur savoir ; à leur refuser, en particulier, d’être les interprètes et les guides du peuple. Dans l’histoire qu’en donne Sarah Al-Matary, l’anti-intellectualisme commence, je l’ai déjà rappelé, au milieu du XIXe siècle, avec l’alliance avortée du peuple et des intellectuels, emportée par la faillite révolutionnaire de 1848. Agricol Perdiguier, « l’un des rares ouvriers qui siègent à l’Assemblée en 1848-1849 », en ressort pourvu d’une « véritable méfiance à l’égard des élites savantes » (p. 21), qu’il appelle, depuis deux décennies, à reconnaître, à côté des leurs, le savoir et la culture propres des ouvriers – en particulier de ceux qui, comme lui-même, sont issus du compagnonnage1. Député en même temps que Perdiguier, Proudhon s’est quant à lui lancé « dès les années 1840 » dans une critique approfondie de la préséance accordée à l’esprit sur la main, à l’intellectuel sur le manuel ; il a écrit « une série de forts volumes où il montre comment le préjugé de l’inégalité potentielle des intelligences, né de la valorisation de l’âme au détriment du corps, a justifié l’oppression du peuple » (p. 29). La poursuite de sa réflexion sous le Second Empire l’amène à conclure que non seulement le peuple n’a rien à attendre des intellectuels pour sa libération, mais à renverser la hiérarchie des intelligences : « Proudhon affirme que le caractère extrêmement complet de l’intelligence sollicitée par les travailleurs rend les manuels supérieurs aux intellectuels » (p. 36). Plus tard, au sein du mouvement syndical, la pensée proudhonienne sera reprise et prolongée par un Georges Sorel, pour qui « la démocratie bourgeoise entérine la domination des manuels par les intellectuels, hiérarchie soutenue depuis l’Antiquité par une culture fondée sur le talent, qui minore la valeur matérielle du travail » (p. 108). Pour Sorel, l’avènement de la « modernité industrielle » (p. 109) doit avoir pour conséquence le renversement de cette hiérarchie : « L’intellectuel n’a plus de raison d’être au sein du monde « de la grande production » » (Ibid.).
Autre leitmotiv du discours contre les intellectuels, la critique de leur intellectualisme. Aux yeux de ses contempteurs, l’intellectuel pèche par abstraction ; par oubli, par déni, par mépris du réel, du concret, du particulier. Ainsi, à nouveau, Proudhon, qui reproche au gouvernement né de la révolution de 1848, « formé d’intellectuels et de politiciens », de faire disparaître dans le peuple abstrait « qui forme la nation » « le peuple vivant » (p. 33), et de négliger, par conséquent, ses revendications matérielles. La mise en cause de l’abstraction libérale ou républicaine n’est bien entendu pas l’apanage de la gauche du spectre politique français. À son autre extrémité, les voix de Barrès et de Maurras la formulent avec éclat, par exemple à l’occasion de l’affaire Dreyfus. Comme Bourget dans Le Disciple, Barrès, dans Les Déracinés, a dépeint le professeur de philosophie des lycées de la République sapant chez ses élèves, à coups d’intellectualisme kantien, les bases de la moralité – comme la conscience d’être d’une terre et d’une « race ». Dans la mobilisation des intellectuels pour l’innocence de Dreyfus, il voit une manifestation exemplaire de ce « travail de décomposition » qui conduit à faire prévaloir « la raison critique individuelle » sur « la raison collective » (p. 89), et donc à méconnaître la relativité du vrai aux intérêts de la communauté – en l’occurrence, de la nation, représentée par son armée. De la plume d’un écrivain comme Barrès à celle d’un polémiste comme Drumont, en passant par le crayon des caricaturistes, la figure de l’intellectuel dreyfusard circule et se fige en celle d’un être anormal, monstrueux par la tête, étranger au peuple – et l’anti-intellectualisme donne ainsi la main à l’antisémitisme. Pour ce qui est de Maurras, je renvoie à sa critique de l’École, mentionnée plus haut. Rappelons simplement que la critique maurrassienne de l’intellectualisme n’implique nul irrationnalisme, à la manière de Barrès, mais elle rejoint celui-ci dans la dénonciation de l’intellectuel, dont Maurras « assimile [l’idéalisme] à une idéologie allemande ou juive » (p. 118), comme étranger à la nation. Cet étranger, dépourvu du sens des réalités nationales, est aussi « dévirilisé ».
Pour les contempteurs de l’intellectuel, la nocivité de ce dernier est indissociable de la langue qu’il écrit, ou qu’il parle : langue scolaire, fossile, absconse – à l’opposé de leur propre pratique d’une langue « vraie », individuelle, vivifiée à la source du parler populaire. Ce fil langagier de l’anti-intellectualisme court de la littérature à la politique, de Vallès à Poujade et Le Pen. Vallès, dont Sarah Al-Matary rappelle que, « fils de professeur » (p. 38), il excella au lycée, reprend la dénonciation proudhonnienne du « beau parler » en politique, et cherche à se forger « un style qui détourne la rhétorique afin de toucher l’âme » (p. 47). « Fais-moi entendre comment tu parles, fais-moi voir comment tu écris, et je te dirai si tu sers le peuple, ou si tu le dessers » : telle est, en somme, sa pensée. Durant la Commune, il fustige ceux qu’il appelle les « jacobins », dont la langue formée par les humanités lui rappelle celle des « forts en thème » (p. 46) qui échouèrent en juin 1848 – les uns comme les autres héritiers d’autres « forts en thème », les « révolutionnaires de 93 », que Vallès qualifie d’« imitateurs » (p. 47) des Romains. Comme Vallès, Céline est une figure littéraire de l’anti-intellectualisme, et dont l’anti-intellectualisme se manifeste par la revendication d’une langue différente, et même radicalement différente, de celle que l’on pratique après avoir connu le lycée et l’université. Comme Vallès, Céline s’est retourné contre une culture littéraire et rhétorique qu’il possédait. Mais il a « [élaboré] sa propre définition de l’authenticité […] hors de toute revendication de classe et de tout optimisme révolutionnaire » (p. 207) – lesquels sont par contre bien présents dans les débats, contemporains de ses débuts, sur la littérature prolétarienne. C’est l’authenticité du créateur, qui a su retourner aux sources populaires de la créativité littéraire, pour produire « une langue incarnée, mâle », « une langue expressive », que « Céline […] oppose à celle de l’intellectuel, qu’il décrit comme un inverti soumis à la bourgeoisie juive » (p. 215). La littérature rejoint à nouveau la politique – et l’anti-intellectualisme l’antisémitisme (et l’homophobie). Écrire comme Céline, c’est lutter contre les ferments, juifs, de décomposition, de dévirilisation, à l’œuvre dans la société et la culture françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les discours d’un Poujade, puis d’un Le Pen, la « crudité » de l’expression, l’usage de « l’injure xénophobe et sexuelle » (p. 246), valent comme garanties de la véracité de leur parole face à celle, absconce et mensongère, des rivaux, des journalistes, des professeurs, des technocrates.
Mais le discours contre les intellectuels, comme je l’ai rappelé au début de ce compte-rendu, n’est pas qu’un discours « contre ». Il exprime également le désir d’une société différente de celle que l’on rejette en rejetant les intellectuels, le rêve d’un autre cours de l’histoire. Comme le laissent apercevoir les exemples mentionnés dans les développements précédents, ce désir, ou ce rêve, peuvent être de nature démocratique ou hiérarchique, révolutionnaire ou réactionnaire. Parfois, il semble que l’anti-intellectualisme manifeste, chez les intellectuels qui s’en font les hérauts, une sorte de recherche du salut dans le charnel, l’incarné – encore une fois, le mot d’incarnation revient fréquemment dans La Haine des clercs –, le réel, dont eux-mêmes seraient exilés. Il y a, chez certaines des figures dont Sarah Al-Matary analyse l’itinéraire, comme la quête ou la révélation d’une épiphanie. Ainsi voit-elle, dans la manière dont le normalien philosophe Robert Hertz, sur le front de la Première Guerre mondiale, vit son expérience de cohabitation avec des hommes des classes populaires, l’expression d’un « rêve d’intégration à la masse » (p. 155)2. Aux travaux du soldat, celui-ci se sent inférieur à ses compagnons moins lettrés, et se flagelle en flagellant ses semblables dans l’ordre du savoir, comme dans cet extrait d’une lettre à sa femme : « Plus que jamais je vois que l’hypertrophie de l’intelligence abstraite et discourante est un mal, qu’elle fait des hommes déséquilibrés, incomplets, et inaptes à la vie » (p. 153). Le vécu militaire de Robert Hertz nourrit, chez lui comme chez son épouse, l’espoir que sortira de la guerre « l’homme nouveau auquel il reviendra d’assurer aux générations futures une société plus complète que celle qui a mené à la guerre » (p. 156). Une cinquantaine de’années plus tard, de jeunes intellectuels révulsés par la famille, l’Université, les partis de gauche, et les syndicats, et qu’inspire la Révolution culturelle chinoise, vont au peuple en allant travailler en usine : ce sont les établis. Ils expriment « la satisfaction d’être maître[s] de [leur] destinée, le bonheur de concrétiser [leurs] engagements politiques, voire la conviction « messianique » que c’est au sein du peuple que se font les apprentissages décisifs » (p. 267). Avec une certaine ironie, l’un de ces établis, Jean-Pierre Le Dantec, que cite Sarah Al-Matary, écrit : « Nous désirions de toutes nos forces nous baigner dans l’idiotie et geler complètement notre esprit trop familier des gymnastiques intellectuelles pour que, enfin purifiés, il nous soit possible d’atteindre la transparence du monde » (p. 268 ; je souligne). Il ajoute : « Nous ne lisions plus rien ; ou plutôt si, nous lisions toujours le même livre, le même journal, les mêmes phrases sentencieuses, les mêmes histoires édifiantes » (Ibid.) – en somme, des sortes d’exercices spirituels.
Foisonnant d’événements et de personnalités, le livre de Sarah Al-Matary est une lecture passionnante à raison de son foisonnement. Pour le lecteur curieux de l’histoire intellectuelle et politique de la France, il ne manquera pas de mettre en lumière une figure ignorée ou bien méconnue de cette histoire (dans mon cas, par exemple, celle du traducteur de Dostoïevski Pierre Pascal) ; de révéler, ou de faire voir sous un jour nouveau, certains de ses aspects. Passionnant, et utile, ce livre l’est aussi et surtout parce qu’il fait émerger, au fil de son déroulement, les traits d’une attitude et d’un discours qui n’ont pas encore disparu de notre vie publique3 (et sont médiatiquement rentables, comme le rappellent, dans le dernier chapitre, les portraits en dyptique des deux Michel, Onfray et Houellebecq). Enfin, il est à sa manière un récit, un bon récit, de l’insatisfaction face au monde né des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle, et du début du suivant – et dont le nôtre est l’héritier.
==================
NOTES
- Perdiguier fut l’une des sources de George Sand pour son roman Le Compagnon du Tour de France (1840), qui traite justement de la valeur de la culture populaire, au regard de la culture lettrée.[↩]
- L’historien Nicolas Mariot a consacré, à Robert Hertz et son épouse, tout un livre : Histoire d’un sacrifice. Robert, Alice et la guerre, Paris, Le Seuil, 2017.[↩]
- N’y a-t-il pas, dans les propos récents de Jean-Michel Blanquer contre les universitaires « islamo-gauchistes », un écho de ceux de Manuel Valls, mentionnés par Sarah Al-Matary, contre les sociologues dont les travaux conduiraient à « excuser » le terrorisme ?[↩]

Jean-Baptiste Mathieu
Jean-Baptiste Mathieu est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm). Professeur agrégé de lettres modernes, il enseigne actuellement au Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Il est rédacteur en chef de la rubrique « Critiques » au sein de la rédaction de la revue Raison publique.
